
 Flux RSS
Flux RSS

Mickey, c’est une formidable porte d’entrée vers des bons sentiments, de l’aventure mais aussi des univers parfaitement différents mais en osmose avec le héros aux grandes oreilles. Glénat l’a bien compris en conviant quelques figures de proue du Septième Art, ayant de près ou n’ayant jamais touché à Disney, de s’essayer à poser leur marque sur la petite souris souriante. Et s’il vous fallait une ultime raison de vous plonger dans l’univers magnifique de ce duo d’orfèvre que forment Silvio Camboni et Denis-Pierre Filippi, la voilà, Mickey et l’océan perdu. Nous avons profité de la foire du Livre pour nous inviter dans la fraîcheur d’une jungle futuriste. Magique !
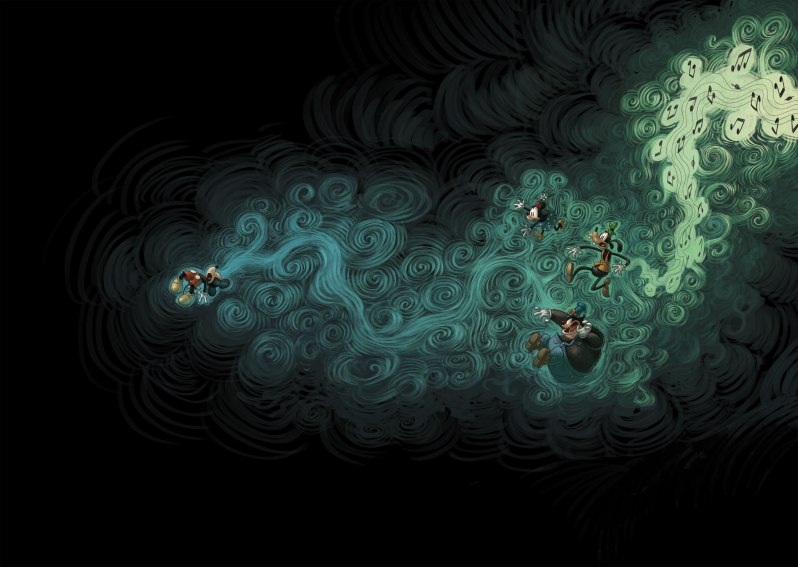
© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat
Bonjour Silvio, Mickey et vous, c’est une longue histoire ?
Déjà en tant que jeune lecteur, je l’achetais, je le collectionnais. Il faut dire qu’en Italie, le public pour Mickey est Disney est beaucoup plus large. Il y a Topolino pour lequel j’ai très vite eu l’occasion de collaborer. Vers mes dix-huit ans, je suis parti à Milan pour étudier et j’ai cherché du boulot dans le monde du dessin. La porte de Topolino s’est ouverte. C’était il y a trente ans.
Et là, cette fois, je reviens en quelque sorte chez moi par le côté franco-belge dans un grand format, plus élaboré.

© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat
Et avec une expérience et un univers qui ne dépareille pas !
C’est vrai qu’avec Glénat et Les Humanoïdes Associés, j’ai eu une expérience française qui a été riche. J’ai pu développer un style mêlant architecture, nature mais aussi un certain sens du merveilleux. Du coup, avec Denis-Pierre Filippi, on a croisé les univers, cet esprit « monde caché » avec un dessin peut-être un peu plus classique mais sans partir dans l’expérimental. Il fallait donner envie de lire tout en croisant les publics. De manière habituelle finalement, avec des rebondissements pour les enfants mais en allant chercher des thématiques dont les adultes pourraient se saisir.
Encore et toujours Denis-Pierre Filippi. Vous êtes inséparables, ma parole.
Notre duo est né dans l’amitié, la compréhension mais aussi l’amusement réciproque. On fait des rêves, on a des visions, alors on essaye de les faire parvenir aux autres.

© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat
Dans une collection qui continue d’aligner les maîtres.
Et passer après Loisel, mon dieu, quelle pression. En tant qu’amateur J’étais curieux de voir l’approche des autres, j’y ai repéré de la gentillesse, de la délicatesse. L’avantage pour moi, c’était que j’y avais déjà mis les pieds…
Avant vous, j’interviewais les auteurs de Spirou – Le triomphe de Zorglub et Alexis Sentenac me disait que certains auteurs s’étaient un peu égarés en emmenant Spirou dans des histoires qui n’étaient pas les siennes. Avec Mickey et son large spectre, c’est plus facile, non ?
Notez qu’on pourrait se tromper, faire quelque chose qui ne soit pas dans l’univers de Disney. Il faut garder une certaine marge. Après, je pense qu’au niveau du graphisme et de l’histoire, on peut trouver une façon de moderniser la façon d’utiliser les personnages. Ils sont forts et surtout capables.

© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat
Et vous finissez de nous enchanter en retournant le monde sur lui-même, en faisant sortir l’océan de son enclave pour qu’il prenne la place de l’air.
L’idée venait de Filippi. Mais entre l’idée et le papier, je n’ai pas eu l’illumination tout de suite. Ce n’était pas gagné de rendre ça compréhensible. Un océan qui vole, qui fait des nuages, qui garde sa physicité mais sans la pesanteur. C’était casse-tête jusqu’au jour où j’ai compris comment faire.
Cette histoire, auriez-vous pu la réaliser pour Topolino ?
Oui, je pense. Topolino est peut-être un peu adulte que le Journal de Mickey. Avec une certaine variété de tons, une richesse même si c’est du format pocket, il aurait fallu adapter l’espace.

© Camboni
Justement, comment travaillez-vous ?
Je suis passé au numérique, depuis un petit temps mais j’ai essayé de garder l’échelle de ce que je faisais en traditionnel, du 35-25. C’est rapide, efficace, on gagne en élasticité, et rien n’est irréversible par rapport au papier. On peut revenir en arrière tandis que sur papier, on peut facilement être amené à tout refaire. Il y a un effet miroir, c’est le même flux de créativité mais sans contrainte.
Après, il faut parvenir à garder le contrôle, éviter d’exagérer de jouer avec le zoom et le dézoom, de rajouter des détails. Éviter par-dessus tout de rendre le tout illisible.
Aussi, vous avez ajouté des chapitres.
Au début, ce n’était pas le cas, l’histoire se suivait d’une traite. Mais, j’ai vite senti qu’une division en chapitres s’imposait.

© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat
C’était naturel comme cette double-page où Mickey se réveille et se retrouve dans un monde qui a complètement changé. Comme mon héros, je me suis réveillé un matin et ce que je devais faire coulait de source, pour marquer ce passage de la vie précédente à la nouvelle. C’est venu tellement naturellement que ça en est bizarre.
Si vous ne racontez jamais deux fois la même histoire, on retrouve ce besoin de nature, luxuriant.
C’est mon plaisir, dessiner des arbres. On pourrait croire qu’ils se ressemblent, mais non, le monde est vaste et les arbres sont toujours différents les uns des autres. J’aime cette complexité naturelle, ce mouvement perpétuel

Un autre héros mythique de BD dans un univers de jungle comme les affectionne Silvio. Filippi/Camboni/Lofé/Glogowski chez Dupuis
Après, concernant mon trait, mas personnalité, je n’ai pas de repère, je ne sais pas où je me trouve par rapport à des maître comme Carl Barks ou Floyd Gottfredson, j’espère juste parvenir à mixer mon art avec l’aura internationale de Mickey. C’est de l’ordre du patrimoine mondial de l’humanité. Le monde entier connaît Mickey.
Comment expliquez-vous cette universalité et cette longévité ?
Disney, c’est finalement assez accessible. C’est rond, doux, on les reconnait directement et on les relie directement à la même famille. Après, au niveau des thèmes, on n’y voit pas de violence, pas de drogue, de mort ou de racisme. Ça doit certainement expliquer une partie de ce succès. Après, ça vient par hasard. Walt Disney n’a sans doute pas imaginé que ses personnages auraient un tel succès. Disney, c’est un rêve collectif, désormais.
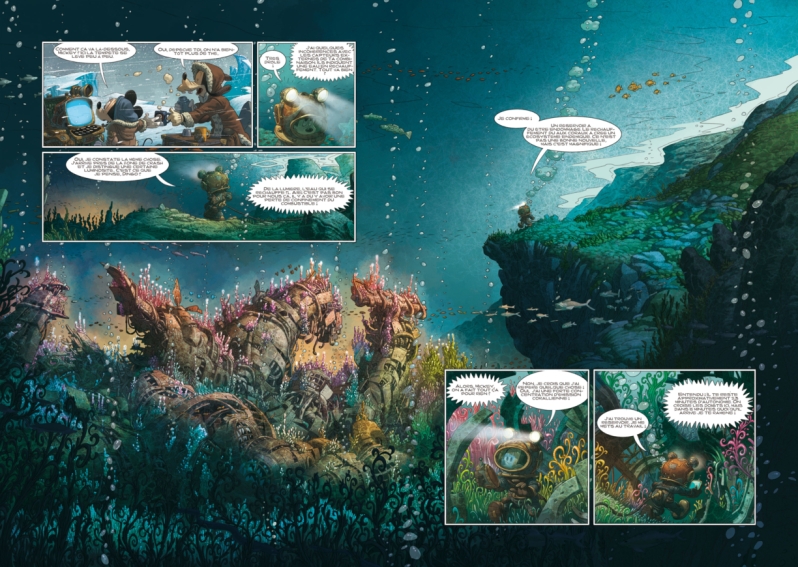
© Filippi/Camboni/Bodart/Yvan chez Glénat
On va continuer à rêver avec votre album, en tout cas. Merci et bonne continuation.
Propos recueillis par Alexis Seny
Titre : Mickey et l’océan perdu
Récit complet
Scénario : Denis-Pierre Filippi
Dessin : Silvio Camboni (Page Facebook)
Couleurs : Jessica Bodart et Gaspard Yvan
Genre : Aventure, Steampunk, Science-fiction
Éditeur : Glénat
Collection : Mickey vu par
Nbre de pages : 56
Prix : 15€

Avec son nouvel album, Barly Baruti nous plonge dans une jungle, pas forcément à l’abri de la noirceur des hommes mais à la recherche d’un singe incroyable. L’occasion de croiser en chemin des sujets bien plus brûlants que la quête assignée. Dans la jungle humaine qu’est la Foire du Livre de Bruxelles, nous avons croisé Barly pour un échange passionnant.

Barly Baruti (Photo © Jean-Jacques Procureur)
Bonjour Barly. Vous nous revenez avec Le Singe Jaune, mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ?
C’est vrai, ça aurait pu être un cheval rose (il rit). En fait, il fallait pour faire exister cette histoire, trouver quelque chose qui ne soit pas ordinaire pour susciter l’intérêt. Si j’avais annoncé des thèmes comme le métissage ou tous les problèmes abordés dans ce roman, on m’aurait rétorqué : « C’est ton problème! » Mais si j’intrigue le lecteur, que je lui propose une quête, il va se dire: « Un singe jaune, mais qu’est-ce que c’est que ça ? » Et, à partir de ce moment-là, je peux le balader.

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat
Avec Christophe Cassiau-Haurie.
Mon compère ! En fait, j’avais écrit le scénario de A à Z. J’en ai parlé à Christophe et ça l’intéressait d’en développer certains angles. Le côté aventure, la forêt. Du coup, il s’est glissé à l’intérieur de mon histoire. On a partagé.
Tout en faisant évoluer une journaliste, Paulette Blackman, qui a des similarités avec une autre, existant réellement : Colette Braeckman.
Cette journaliste, c’est avant tout une manière de personnifier le lecteur, de l’amener dans mon chemin. Après, je voulais aussi faire ressortir cette ambigüité, la relation fusionnelle entre la RD Congo et son ancien colonisateur, par voie de presse. Et Colette Braeckman (la vraie !) symbolise bien cette situation. En fait, c’est un hommage que je lui rends. Humblement.

© Barly Baruti
Mais c’est une arnaque monumentale qui l’amène au Congo.
Une pirouette, le type va vite être démasqué. Mais, vous savez, je pourrais dire que moi aussi il m’a arnaqué. Mais, encore une fois, l’important n’est pas l’objet de la quête.
Cette journaliste, en partant en quête de ce singe jaune, ne passe-t-elle pas à côté de son/ses sujet(s)?
E tout cas, elle est surprise par le cours des événements. Son supérieur voulait qu’elle traite l’affaire du singe jaune de loin. Elle les a bien emmerdés en voulant partir en Afrique, sur le terrain. Et elle va finalement se retrouver plus proche de ses aspirations. Elle n’obtiendra pas le scoop initial mais il y a d’autres réalités qui vont finir par la toucher. Jusqu’à un choc qui va lui permettre de mesurer la profondeur de la plaie. Elle n’est plus journaliste, elle est plus « humaine », plus sensible aux réalités. Il y a une vraie rupture.

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat
Et cette obsession salutaire : raconter les choses « de l’intérieur ».
Une évidence ! Mais il faut y arriver. Il me faut un levier pour y entrer tout en permettant à qui me lit d’adhérer à la démarche. Et ce Singe Jaune va me permettre d’investir le terrain même si, à la fin, personne ne se demande où il a bien pu disparaître. Si à la fin de la lecture le lecteur finit par oublier « le singe jaune », on aura gagné le pari !
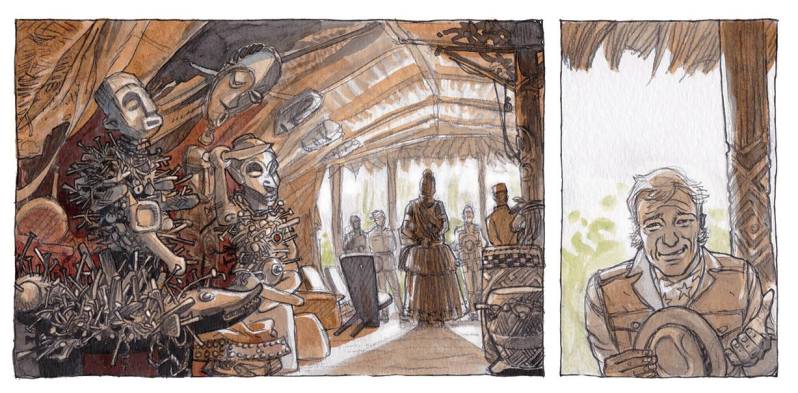
© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat
Avec l’importance du devoir de mémoire !
Sous l’angle du rapport humain. Ce n’est pas de l’histoire, je ne suis pas historien. Mais je veux pouvoir le ressortir, ce rapport humain, par tous les moyens ! Tout en ne trahissant pas la vraie Histoire. L’Histoire avec un grand « H ».
Mais le sorcier veille.
C’est le gardien des traditions, il a un pouvoir, est mystique et ne semble pas avoir d’âge. Il est aveugle mais s’il ne voit pas, il sent les choses. Et lui il va amener les gens dans nos croyances. Pourquoi pas ? Il y en a bien qui s’éclate avec la science-fiction, non ? (rires !)

© Barly Baruti
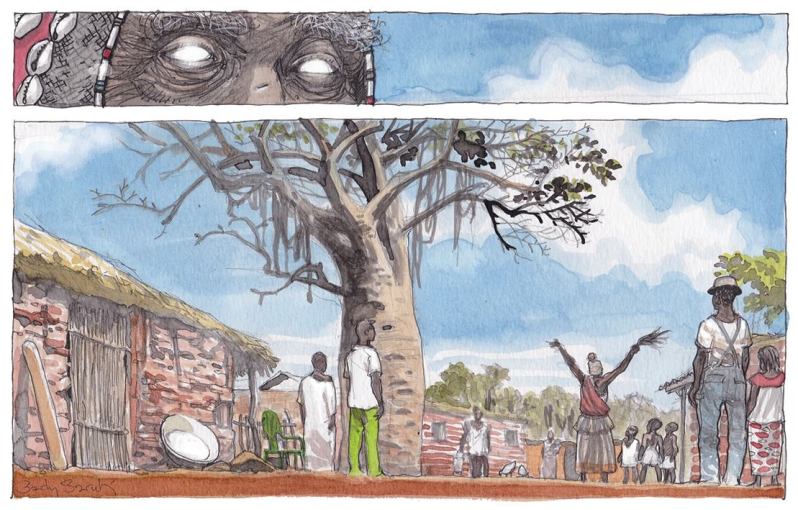
© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat
Et l’idée est de remettre un peu en perspective l’impact du rôle de la Belgique.
Il faut dire ce qui est. La Belgique a lâché le Congo pour mieux le contrôler. Retenez ce qu’avait dit le Général Janssens : Avant l’indépendance égal après l’indépendance. On l’a pris pour un fou mais ce qu’il s’est passé lui a donné raison. L’indépendance, c’était une façade, un subterfuge. Et dire qu’on a même dansé pour elle. « Indépendance Cha-Cha » ! Belle mélodie sur YouTube ! (Rires !)
En fait, je pense qu’on est en train de tourner en rond. C’est un peu le serpent qui se mord la queue, nous retournons sur nos pas, revenons sur notre passé avec l’obligation de l’affronter lui et nos démons.

© Cassiau-Haurie/Baruti
Belges et Congolais, on s’est loupés, pris en otage par les appétits gloutons des politiques des deux bords. Et ça continue ! Heureusement qu’il y a la BD…
Dans la fine équipe, vous nous faites rencontrer Anaclet, un personnage complètement perdu.
Complètement perdu, c’est le mot. Il cherche son père et il ne cesse de rater les rendez-vous. C’est bête, hein, son père aurait eu un portable, il aurait su répondre directement. Sauf qu’il est resté très colonial et qu’il a gardé un téléphone d’époque. Du coup, il arrive en retard pour décrocher. Entre sa cuite et le téléphone, il a été trop lent.
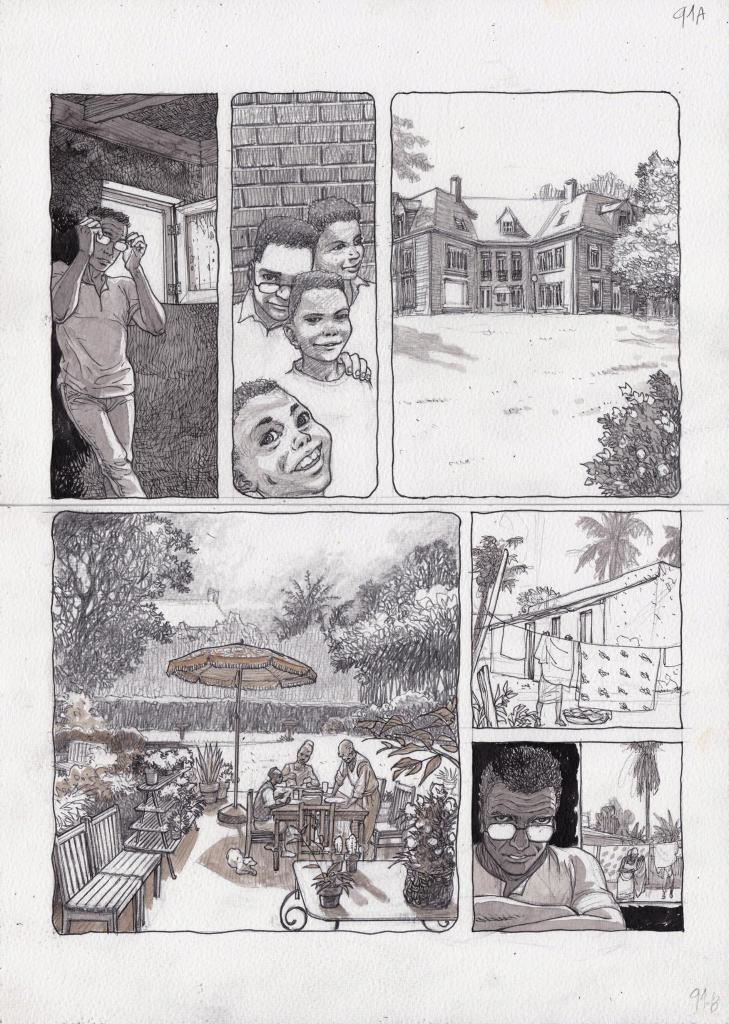
© Cassiau-Haurie/Baruti
On n’a jamais vraiment été au fond des choses en parlant du métissage. Ce n’est pas qu’une question de couleur de peau, on peut parler du métissage culturel. Anaclet, lui, est perdu, c’est comme si on touillait sa blessure qu’on lui ramenait son histoire. Et quand le sorcier lui dit: « ah, tu es revenu », il ne sait pas vraiment d’où il vient
C’est un ouvrage finalement très dense que vous nous proposez, empli de thèmes et de questions.
Et, en même temps, je laisse au lecteur le soin de deviner l’épaisseur des choses. Je passe à côté de certaines de celles-ci. Et j’ose croire que si le lecteur lit ça comme il faut, il ira sur le net. Toutes proportions gardées, je fais ça un peu à la manière des lanceurs d’alerte. (rires)

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat
Au niveau de la représentation de cette jungle dans laquelle vos personnages s’engouffrent, comment vous y êtes vous pris ?
Je connais le Bas-Congo mais je ne me suis jamais promené à l’intérieur. Mais je connais une autre région, similaire… J’ai passé deux ans de ma scolarité en internat à Lokutu (ex Elisabetha, pour les nostalgiques !), en pleine forêt, pas loin de Kisangani (Stanleyville, ma ville natale). Tout se faisait en forêt, se nourrir, les flirts, etc. Ces souvenirs sont ma documentation. Je connais l’odeur, le danger, la lumière de la forêt, la douce musique de la flore et sa faune…
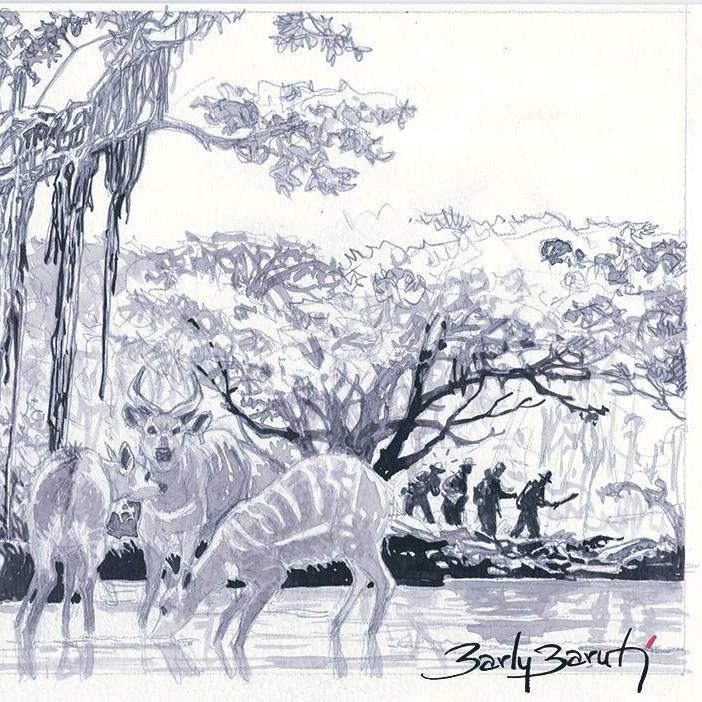
© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat
J’ai pris autant de plaisir à travailler la ville de Bruxelles, que j’aime beaucoup, que la forêt.
Est-ce vrai qu’on a toujours l’impression d’être épié ?
(Il rit) C’est pour amplifier la parano de la journaliste. Si je me sentais épié, ça ne m’a pas marqué. Ceci dit, on est toujours épié dans une forêt. Il y a tellement des vies invisibles qui te guettent : tu es chez eux, dans leurs zones !

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat
Vous parliez de lumière mais j’ai l’impression que l’ombre de Frank Pé plane aussi sur votre album, non ?
Je ne le remercierai jamais assez. C’est un ami et, grâce à lui, je pense que je dessinerai jamais plus les animaux de la même manière. Il m’a fait comprendre non seulement comment animer les animaux mais aussi leur donner une âme. À les voir vivants même quand ils ne bougent pas.

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat
Si on reste près des animaux, vous adressez aussi une pensée pour une personne bien particulière, Tim…
Je ne le connaissais pas. C’est en surfant sur le site de l’ICCN, l’institut congolais de conservation de la nature que je suis tombé sur cette « breaking news » commémorant la mort d’un ranger abattu alors qu’il gardait un parc. Ça m’a vraiment touché. Avant, les braconniers avaient peur de ces gardiens de la forêt. Aujourd’hui, c’est le contraire, ils ont du matos, ils sont presque aussi équipés que des groupes armés (on subodore le financement des multinationaux, quelque part…). Face à ça, les rangers sont des poids plume.

© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat
Sur ce petit monde, vous faites tomber une belle nuit, à plusieurs reprises dans cet album.
Avec Christophe, nous avions convenu de faire vivre cette aventure au jour le jour, mais de nuit aussi, en temps réel. Et parfois, en faisant l’impasse sur le texte, parce que les images suffisent.
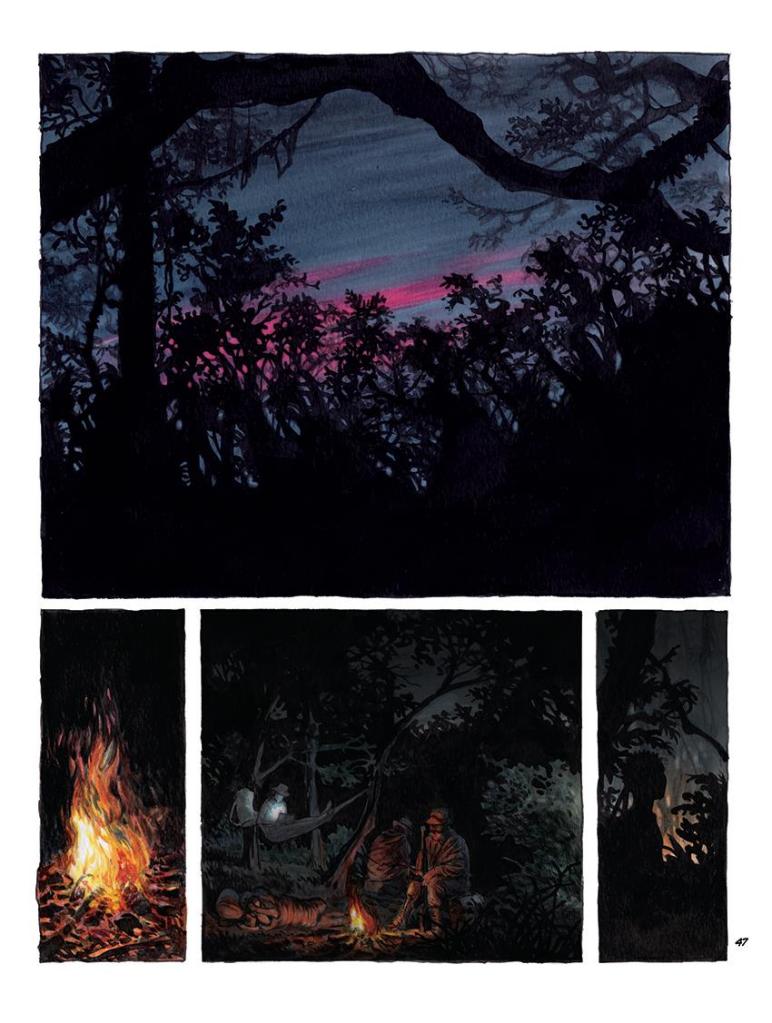
© Cassiau-Haurie/Baruti chez Glénat
J’ai vu aussi sur votre mur Facebook, une sélection de couvertures non-retenues.
Mais qu’est-ce qui peut-être assez fort ? C’est toujours la question. Du coup, Thierry Bellefroid a bien voulu s’amuser avec moi pour choisir la couverture finale. On s’y est mis toute une après-midi. Il y a toujours plus dans deux têtes que dans une, non ? Et Thierry avait le recul suffisant pour m’aider à faire mon choix. Moi, j’achète des albums, c’est important de faire une couverture qui me donnerait envie de l’acheter.
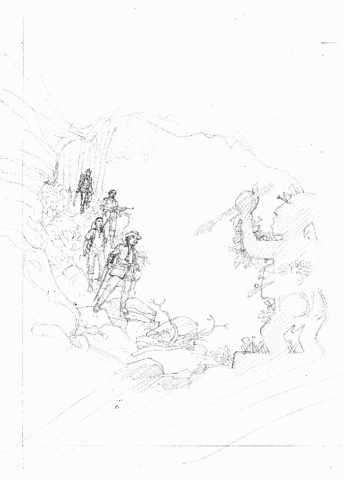
© Barly Baruti chez Glénat
Allez quittons un peu ces planches pour en rejoindre donc. Dites donc, il paraît que vous avez mis le feu lors de votre concert hier à la Foire du livre !
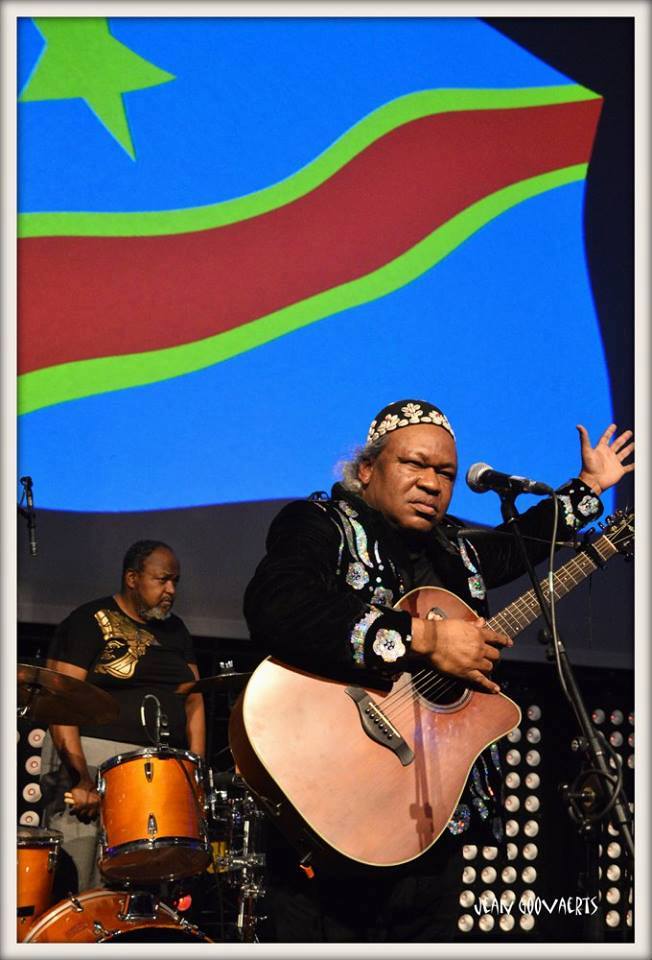
© Jean Goovaerts
Les concerts, la musique, c’est mon autre dada. Inviter les gens à danser, à garder la tête dans les nuages … et les pieds bien ancrés sur terre.
Et si vous deviez donner une B.O. à cet album ?
Si les lecteurs le peuvent, qu’ils écoutent de la rumba, Le Grand Kalle et l’African Jazz. Puis Papa Wemba! On était très lié, on a pas mal joué ensemble.
Quels sont vos projets, désormais ?
Rester dans les parages tant qu’on me supporte. J’ai tellement d’histoires, tellement de choses à raconter. À un moment, on ne peut s’empêcher de se demander ce qu’on a laissé au monde. Après, j’apprends en même temps, mais pourquoi ne pas partager tout ? De toutes les façons, je crois qu’il faut être honnête avec le lecteur. On peut le promener, l’emmener totalement dans la fiction, mais en gardant l’essence originelle quand on touche à l’histoire d’un pays, d’un peuple… Il ne faut pas prendre le lecteur pour bête, sous prétexte de le divertir !
Propos recueuillis par Alexis Seny
Titre : Le singe jaune
Récit complet
Scénario : Christophe Cassiau-Haurie et Barly Baruti
Dessin et couleurs : Barly Baruti
Genre : Aventure, Histoire, Drame
Éditeur : Glénat
Nbre de pages : 100
Prix : 22€

N’avez-vous jamais rêvé d’être un oiseau ? On avait fait une croix sur ce rêve fou avant de nous glisser dans les planches du Giant de Mikaël. Et, là, le miracle s’est opéré et on a même été pris de vertige, entre chute et ascension, les ruelles des non-dits et les toits sans limites de la vérité. Dans un premier diptyque contant le New York des années 30 sous toutes les coutures, rythmé par une radio conviviale et les Ratatatat Ratatatatat des marteaux pneumatiques. Ici, une ville a la folie des grandeurs et des hommes s’efforcent juste de s’élever un peu. Nous avons rencontré Mikaël.

© Giant
Bonjour Mikaël. Si votre premier tome nous filait la peur du vide, avec ce deuxième tome, c’est le goût de la vitesse, et d’un rythme efficacement maîtrisé que vous nous offrez. Avec pas mal de planches muettes, du moins dans les mots.
Le but, c’est d’essayer d’avoir une alternance de séquences. Certaines avec beaucoup de dialogues, chargée de ce que peut-être la vie des ouvriers mais aussi de leurs échanges, comme quand on se retrouve entre amis. D’autres séquences marquent les errances, un côté contemplatif, avec des cases muettes. L’idéal pour que le lecteur se projette et brode en fonction de sa sensibilité, de son vécu. C’est important de lui laisser de la place.

© Mikaël chez Dargaud
En matière de BD, c’est la première fois que vous cumulez le rôle de scénariste et celui de dessinateurs, c’était le moment ?
Une affaire de sensibilité, ça me permettait de voir venir, de faire converser les deux facettes pour pouvoir sentir au mieux cette chronique, cette approche du quotidien à cette époque-là.
L’intérêt de raconter cette histoire, c’était le dessin. Dès le départ. C’était une histoire personnelle, avec un but, des personnages que je voyais venir à moi, qui coulaient de source.
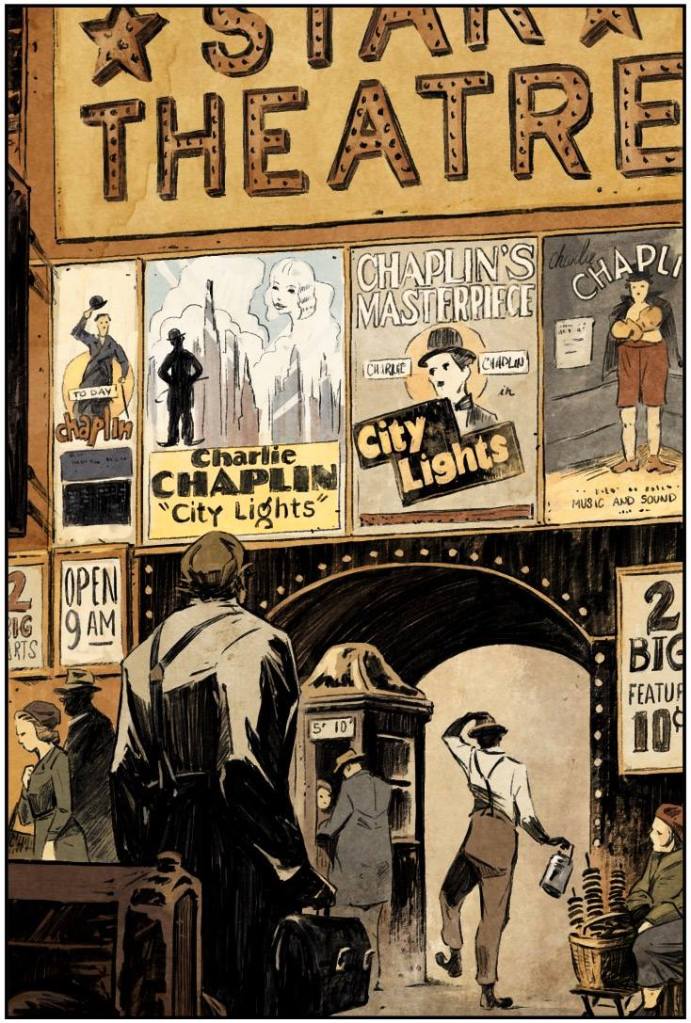
© Mikaël chez Dargaud
Pourquoi, cet affect personnel ?
Parce que New York me fascine et que je voulais absolument traiter cette ville. L’immigration, je l’ai connue, de la France au Canada. Certes, ça n’a rien de comparable avec les années 30 ou la guerre mais je peux au moins l’évoquer, je sais de quoi je parle, toutes proportions gardées. Il me fallait trouver la bonne manière de l’aborder.

© Mikaël chez Dargaud
Ce départ au Québec, c’était finalement ma manière de vivre le rêve américain… mais en français. Tout en pouvant monter dans un immeuble comme celui construit par Giant et ses compagnons. Je pense que je n’aurais pas réalisé cette histoire de la même façon si j’étais resté en France. Aujourd’hui, je suis baigné dans cet univers nord-américain, les camion-pompiers sont les mêmes au Canada ou à New York.
Dans le premier tome, c’est Dan Shackleton qui nous permettait d’approcher Giant. Cette fois, sans entremetteur, c’est Giant qu’on suit de bout en bout.

© Mikaël
Mais avant ça, il fallait permettre de mieux le connaître. Comme avec cette photographe qui enquête et apprend quel est l’homme qui se cache vraiment sous la carrure de Giant. Puis, il se raconte à Mary Ann, par besoin?

© Mikaël
Le thème de Giant se dévoile vraiment à la fin. Un cheminement qui mène à faire son deuil, à entrer en résilience. Giant, il a fui et s’est laissé enfermer, une fois loin de ce qu’il fuyait. Sa force physique compense la force morale qu’il n’a pas. Alors que Mary Ann, elle, elle va de l’avant. Et encore faut-il l’avoir, cette force.

© Mikaël chez Dargaud
Sous les pieds de vos héros, le drame se joue, de six pieds (et même plus) sur terre à six pieds sous terre ?
Tout le monde a en tête cette photo de lunch des ouvriers du ciel en tête à tête avec les oiseaux. Giant, lui, ça l’arrangerait presque s’il pouvait tomber. En Irlande aussi, il a voulu se jeter de la falaise mais il a fui. Alors, du coup, il côtoie la mort… et celle qui y a survécu.
Pour Giant, j’ai tiré les fils des photos spectaculaires documentant ces grandes constructions périlleuses, pour me retrouver dans les années 30’s. Et mine de rien, c’est une époque qui est fertile, propice en sujets contemporains. Une belle porte d’entrée.
Et vous n’avez pas eu le vertige en dessinant vos planches ? Nous, on l’a eu en les lisant !

© Mikaël
En fait, j’ai le vertige ! Enfin, pas quand je suis à l’intérieur, qu’il y a des baies vitrées pour me protéger. Mais cette hauteur, c’était une manière de créer une ambiance, de faire exister ce New York en émergence.
Et vous n’avez pas fini de le faire exister. La suite, c’est Bootblack.
Le vrai personnage de cette série de diptyques, c’est New York. Le deuxième récit est plus sombre, moins dans la chronique sociale. Je mets la ville à échelle humaine, pour sentir la crasse, les brumes mais aussi les mouvements dans la rue. Certains personnages secondaires des différents récits ne se télescopant pas pourront néanmoins se croiser. Comme Frankie, le mafieux que le lecteur a pu rencontrer à la fin du tome 1. Giant ? Pour le moment, il ne passe pas dans Bootblack, mais peut-être se décidera-t-il à passer à un coin de rue.
En tout cas, dans ce premier récit, vous désamorcez sans créer de manque toute baston pouvant éclater entre Italiens et Irlandais?
Je voulais être plus vraisemblable, au-delà de l’image d’Épinal. Tous n’étaient pas armés. Puis, s’il y avait des conflits entre gangs, ce n’était tout de même pas comme dans les films. Je voulais être mesuré, pouvoir retenir Kid Anderson qui voulait se venger des Italiens. Ses comparses vont vite lui faire comprendre qu’il n’a pas le calibre.

© Mikaël
Si on sort de ses rues, on peut faire des allers-retours d’une côte à l’autre de l’Atlantique. Vous avez choisi la relation épistolaire pour (dés)unir Giant et Mary Ann. Un challenge?
Quand j’ai choisi la posture d’une correspondance écrite, je n’ai pas voulu regarder ce qui avait été fait, j’ai voulu avoir mon résonnement personnel. Et j’ai choisi de mettre ces lettres en pleine page puis de découper des petites bulles disséminant certains passages dans la planche suivante. Je voulais qu’en lisant la lettre de l’un, ce soit le quotidien de l’autre qui soit illustré.

© Mikaël chez Dargaud
Et puis les retrouvailles !
Ils devaient se retrouver, les masques devaient tomber. Le tout était d’arriver à faire tourner les pages au lecteur, placé dans une attente angoissée. Le lecteur sait des choses, le tout était de réussir à repousser le moment des révélations, de la scène d’aveu. Je l’ai d’ailleurs beaucoup recherchée, cette manière de faire avouer le secret. Avant d’opter pour ces trois planches avec des décors blancs. Tout va disparaître pour laisser les personnages mettre les choses au point. Jusqu’à ce moment où Mary Ann est interpellée, qu’elle se redresse et que la ville réapparaît, avec le tramway, les roues qui crissent. Il fallait arriver à exprimer l’état de malaise. Je m’y suis repris à trois fois. C’était le challenge.

© Mikaël chez Dargaud
Le langage du bruit, aussi.
Oui, notamment via les marteaux pneumatiques que les gars utilisaient sans casque. Certains témoignages faisaient le parallèle entre le boucan de ces outils et celui des mitraillettes Thompson chères à Al Capone.
Puis, la radio qui ouvre et referme le récit.

© Mikaël chez Dargaud
J’ai longtemps hésité à la mettre. À cette époque, la radio et la presse écrite étaient les seuls médias par lesquels les médias se tenaient informés. Ils se regroupaient tous autour des matchs des Yankees ou de la boxe. La radio était l’objet par excellence au coeur des vies des citadins. L’intégrer à l’album était un moyen d’amener quelque chose d’authentique, une touche de décor supplémentaire dans lequel le narrateur, moi déguisé, espère que le lecteur va passer un bon moment.

© Mikaël
La couleur est aussi un outil narratif. Je voulais un jaune un peu froid, combiné avec un encrage très nerveux, faisant tache d’encre et créant le malaise.
Ce New York made in 30’s, vous auriez voulu y vivre ?
Je préfère quand même mon époque. Mais les années trente, c’est la période idéale pour raconter des histoires. Mais mieux valait être riche dans cette insalubrité qui donnait quand même un côté romantique à la ville. Nostalgique, je ne le suis pas. Mais c’est fou comme on a l’impression que les 30’s-40’s sont lointaines alors que comme nous ces gens étaient dans une logique métro-boulot-dodo avec des migrants, une crise économique, etc.

© Mikaël chez Dargaud
En partant au Québec, avez-vous découvert des auteurs québécois.
Oui, dont certains comme Jacques Lamontagne que je ne pensais pas être Québécois. Il y a aussi Djief, François Lapierre. Puis les auteurs de La Relève, La Pastèque, Pow Wow. Des structures qui font un boulot admirable. Même si la publication d’auteurs ne leur permet pas de vivre. Ils doivent multiplier les publications.
Merci pour ce beau voyage, Mikaël.
Propos recueuillis par Alexis Seny
Titre : Giant (Page Facebook)
Tome : 2/2
Scénario, dessin et couleurs : Mikaël (Page Facebook)
Genre : Drame, Chronique sociale
Éditeur : Dargaud
Nbre de pages : 56
Prix : 13,99€
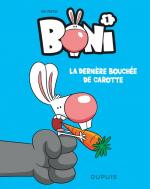
Il a appris de son aïeul, Boni. Il n’est pas en retard, en retard, mais arrive juste à point pour dynamiter un peu l’esprit Spirou de sa carotte a priori inoffensive. Boni, c’est un lapin blanc bien sympathique créé par Ian Fortin, il y a près de dix ans, et qui a attendu son heure pour arriver en albums. Alors qu’il a laissé plus que des crottes dans le Journal Spirou, le personnage au nez rose répond qu’il va y avoir beaucoup de neuf, docteur ! En 2018, pas moins de quatre albums sont prévus, alors que la série de capsules d’animation continue de faire les beaux jours de Télétoon. Mais, c’est la tête sur les épaules (quoiqu’arrivé en Bonimobile, comme vous le verrez), que Ian Fortin a répondu à nos questions.
Bonjour Ian, vous publiez ces jours-ci le premier album de Boni, un petit lapin auquel on s’est très vite attaché, dans Spirou notamment. Mais ce Boni, il n’est pas né de la dernière pluie, n’est-ce pas ?
Ce personnage, je l’ai créé en 2009. Par la suite, j’ai publié une première BD au Québec, aux Éditions Premières Lignes, une coopérative. J’ai repris tous les droits par après. Neuf ans après sa création, Boni est toujours là.
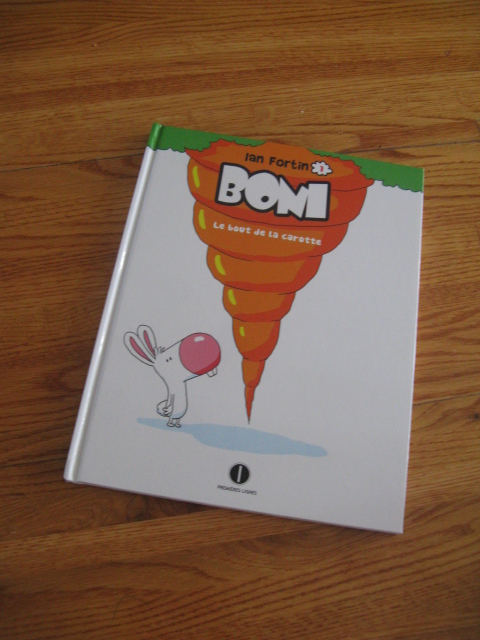
© Ian Fortin
Et 2018 sera son année.
Oui, c’est vrai, il y aura trois albums, soit 360 strips, gags. Je prépare le quatrième. Et j’ai encore beaucoup de versions et de croquis sous le pied.
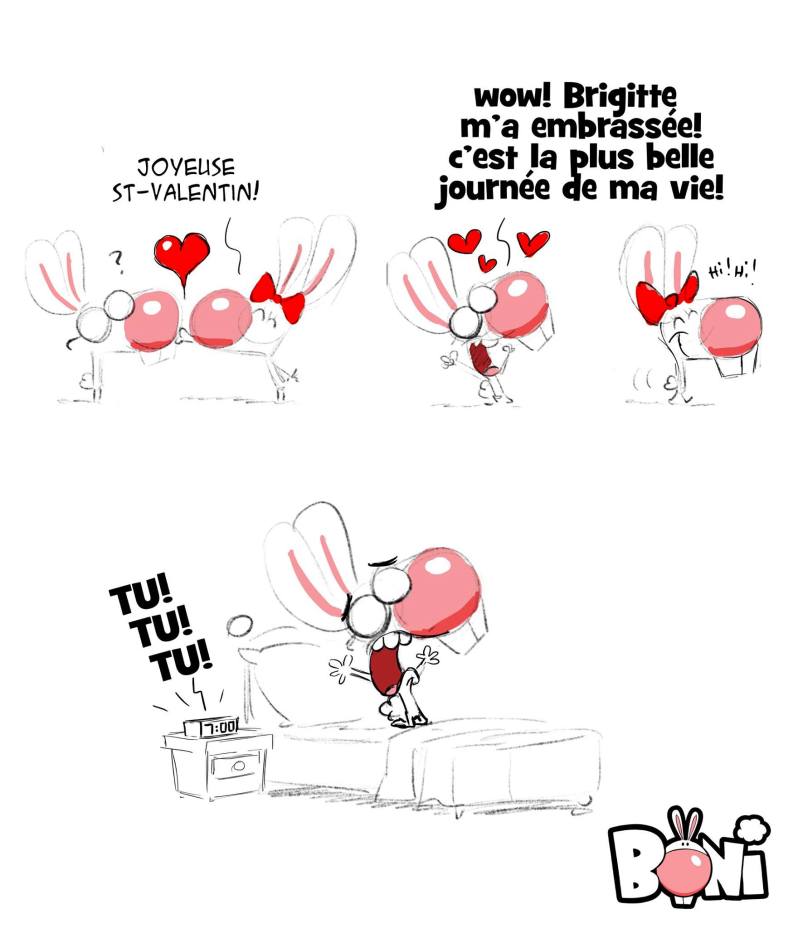
L’esquisse d’un gag pour le tome 4 © Ian Fortin
Mais pourquoi le monde des lapins ?
Parce qu’ils amènent un côté différent. Mine de rien, il y a beaucoup de héros qui sont des êtres humains. Moi, j’avais envie d’animaux. Dans ce monde, on voit aussi pas mal de chiens, de souris, de chat, plus rarement des lapins. Plus loin, je voulais essayer de garder le modèle des strips à l’américaine, en trois cases, tout en l’amenant vers ce qu’on fait en Europe. Et le fait d’imaginer des lapins avec des gros nez, l’idée m’a attiré graphiquement.
Des lapins héroïques, il en existe quand même quelques-uns: Bugs Bunny, Roger Rabbit…
J’ai des atomes crochus avec Roger Rabbit, je l’ai vu plusieurs fois au cinéma. Après, c’est différent, ce sont des personnages d’écrans, de cinéma ou de télévision. À la différence, je n’avais pas vu beaucoup de héros de BD qui étaient des lapins. Mon choix était donc fait.
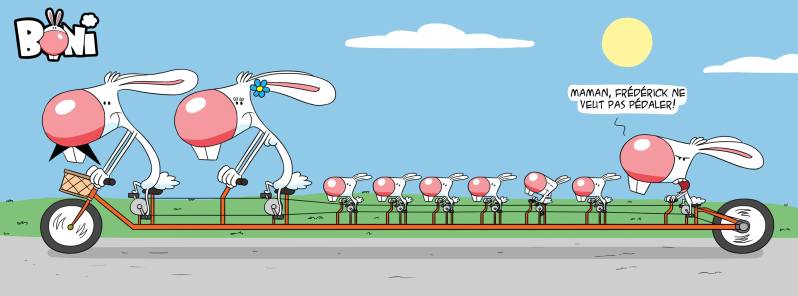
© Ian Fortin chez Dupuis
Enfin, des lapins qui vivent des situations très humaines, finalement,non ?
Oui, ce sont des scènes qui peuvent être reliées à notre quotidien, assez réaliste mais permettant le mouvement, la caricature…
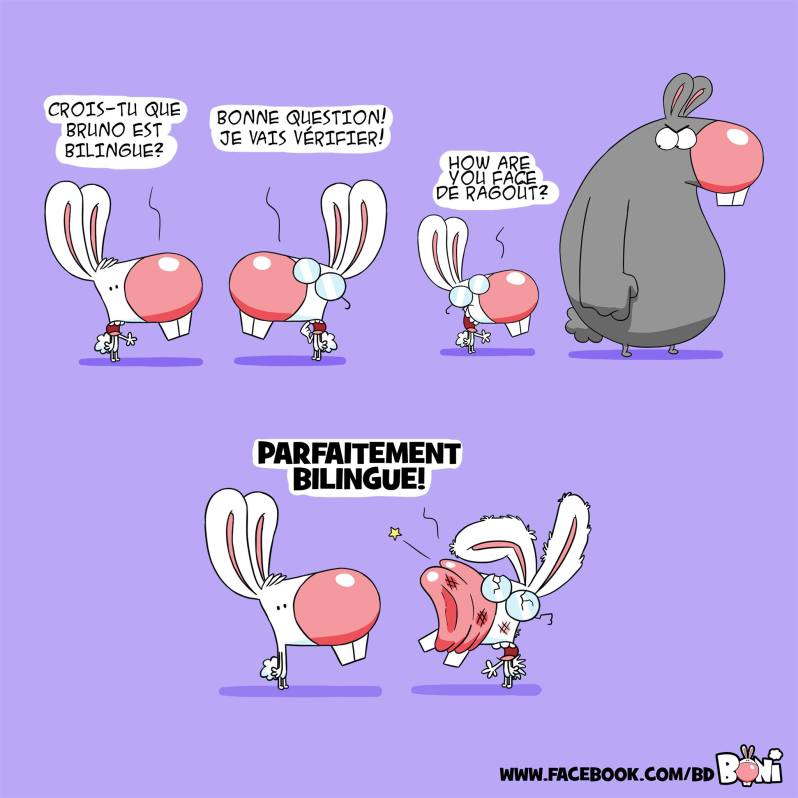
© Ian Fortin chez Dupuis
… et toujours en trois cases… enfin, on verra dans votre album que c’est plus subtil que des cases… en trois images, disons.
Une histoire en trois gags, ça m’est probablement plus facile à réaliser que trois pages. Sur une histoire en longueur, je pense que je me perdrais, et les lecteurs avec. Je ne suis pas sûr d’avoir le talent.
Pour un gag, j’imagine Boni dans une mise en situation avant de me demander comment finir sur une note drôle. Je retourne le problème dans tous les sens.

© Ian Fortin chez Dupuis
Dans tous les sens, c’est ce qui est arrivé à la mise en page de vos gags, au fil des années dans Spirou, sur votre page Facebook mais aussi, désormais, dans l’album.
On a fait le test dans Spirou. Sur quatre strips avec des nuages pour séparer les cases. C’était attrayant mais le nouveau format trouvé pour l’album se rapproche du dessin, amène quelque chose d’épuré, permet d’examiner. Sur Facebook, après, j’ai testé les lecteurs, pour voir par quoi ils étaient le plus attirés. Sur deux versions d’un même gag, j’ai eu trente j’aime contre 3000. Une différence flagrante. Ils n’étaient pas contre le côté plus artistique, avec très peu de décors, quelque chose d’épuré. C’est peut-être de la paresse. Cela dit, même s’il y a les albums, la parution dans Spirou va continuer sur la même formule.
Puis, vous êtes aussi capable de paysage et décors fourmillant de décors.
Oui, mais il faut que je prenne le courage !
Pour traverser l’océan, Boni a-t-il dû faire un travail sur son langage.
J’ai travaillé ma manière de formuler les phrases. Il est évident que si je ne faisais pas attention et que je parlais en Québécois, vous ne comprendriez rien. Tout comme, à l’heure où je vous parle, mes camarades du Québec se demanderait quel jeu je joue en vous parlant de la sorte. (rires)
Si Boni était, seul, il y aurait fort à parier qu’il s’ennuierait. Par chance, il est accompagné d’un casting bien fourni.
La première chose que j’ai faite avec ce lapin au drôle de nez,c’est le mettre face à un bonhomme de neige en me demandant ce qu’il pourrait faire. Bien sûr, il mangerait la carotte.

© Ian Fortin
Après quoi, j’ai ajouté des personnages à la famille. Un grand-papa gentil, au début, mais auquel il manquait des couleurs. Il était plus comique de le faire caustique et pas très sympathique avec son petit-fils. Après, d’autres sont plus stéréotypés, comme on en trouve dans pas mal d’autres BD’s, comme le petit intello. Je ne m’en suis pas caché.
Un autre personnage me plaît bien, la gardienne complètement à contre-emploi.
Un monde de brute, finalement !
Oui, cynique, brutal, mais contrasté par ce lapin positif. Comme son nom l’indique.

© Ian Fortin chez Dupuis
Cela vous dirait d’amener dans cet univers d’autres animaux ?
Pour le besoin d’un gag, je ne dis pas, pour un élément humoristique. Il faut voir.
Cela dit, vous aimez déguiser Boni en Popeye, ou en Avengers.
Ahah, vous avez retrouvé ça ? C’était une façon de séduire la fan page. Beaucoup de publications ont été supprimées depuis. Mais à chaque fois, qu’un nouveau film marquant sortait, je jouais sur le côté viral des choses.

© Ian Fortin

© Ian Fortin
Tout comme ces produits dérivés que vous élaborez et qui verront ou ne verront pas le jour.
Oui, j’ai élaboré un flipbook pour le Festival d’Angoulême, il est très beau ! Puis, il y a un jeu vidéo dans les tuyaux, j’y travaille tranquillement. J’aime exploiter toutes les facettes.
La BD est limitée en soi, c’est intéressant de décliner un personnage dans différentes versions. Comme les 52 capsules animées créées pour Télétoon.
Justement, de la BD à l’animation, quelles sont les différentes.
La BD, c’est plus long, il faut être patient, image par image même si on peut jouer au marionnettiste avec un personnage créé à l’avance.
En animation, il faut mettre trois cases en soixante secondes, parvenir à rendre le gag punchy tout en restant dans les temps.
Quel a été votre déclic en matière de BD ?
Je dessine depuis tout petit. Je décalquais les héros qui avaient du succès au Québec : Gaston, Lucky Luke, Tintin. Au bout d’un moment, je me suis dit que je ferais bien la même chose, créer mes personnages.

© Ian Fortin
Après, le dessin animé m’a fasciné aussi. Le mouvement ! C’est d’ailleurs, cette recherche qui a primé un certain temps. J’ai travaillé comme illustrateur pour des jeux vidéo, pour des dessins animés, comme publiciste.
Qu’avez-vous aimé comme BD au Québec ?
Garfield, Astérix puis Soda, un ange trépasse.
Des auteurs Québécois ?
Delaf et Dubuc, pour leur dessin, leur manière de coller à l’actualité, de mettre dans des gags des textes très réfléchis. Leur sens de la perception.
Quelle est la suite pour vous ?
Beaucoup de Boni, vous vous en doutez. Il y a bien d’autres personnages, mais ils sont très éphémères. Alors, je me concentre sur le quatrième album de mon lapin. Si je sens une évolution depuis le premier gag, je ne sais pas. Peut-être dans l’humour ? Il faudrait voir.
Propos recueuillis par Alexis Seny
Série : Boni
Tome : 1 – La dernière bouchée de carotte
Scénario, dessin et couleurs: Ian Fortin
Genre : Humour, Gag
Éditeur : Dupuis
Collection : Jeunesse
Nbre de pages : 128
Prix : 9,90€

Pourvu que la magie des boîtes à musique et des boules à neige dure éternellement, aurait-on pu souhaiter à Noël. Le rêve s’est réalisé quelques jours plus tard avec la parution du premier tome de La boîte à musique et l’invitation, qu’on a eu vite fait d’accepter, de découvrir Pandorient et ses habitants magiques et étranges. Gijé y a été happé et a pu ainsi découvrir le monde de la BD, lui qui l’observait jusque-là de bien loin. Nous avons rencontré ce jeune auteur très prometteur, dont le dessin ne reste jamais longtemps figé et rappelle les splendides créatures de Pixar.
Bonjour Gijé, c’est avec un fameux premier album que nous faisons votre connaissance. Si mes informations sont bonnes, la bande dessinée, ce n’était pas la voie la plus évidente.
Gijé : En effet, avant, je travaillais dans l’animation, dans un studio pour lequel je faisais des storyboards, j’avais des casquettes différentes. Avant de faire une formation en animation traditionnelle avec un BTS (brevet de technicien supérieur) au Luxembourg, j’avais suivi trois ans d’illustration à Saint-Luc Liège. Je faisais de la peinture, j’apprenais à raconter une histoire en une image mais sans formation spécifique en termes de BD.

© Gijé
Peut-on dès lors dire que vous êtes un touche-à-tout ?
Gijé : Ça me convient ! En tout cas, j’aime être polyvalent. La raison première, c’est ce milieu artistique dans lequel il est bien difficile de trouver du travail. Alors, pour moins galérer, mieux vaut avoir plusieurs cordes à son arc. Mais la BD, j’y suis vraiment arrivé par surprise !

© Gijé
C’est-à-dire ?
Gijé : Un dessin posté sur les réseaux sociaux. Un gâteau d’anniversaire sur une table et que se partageaient un père et sa fille. Et sur le mur, le portrait d’une femme. L’imagination nous faisait dire que c’était la femme de cet homme, la mère de cette petite fille, trop tôt disparue. Les partages aidant, cette illustration est tombée dans les mains de Bénédicte, alias Carbone. Elle était de Perpignan, moi de Paris, on ne se connaissait pas du tout.

© Carbone/Gijé chez Dupuis
Mais son imagination a été titillée et il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle me contacte avec un projet BD. Sur un monde fantastique. J’ai réalisé quelques essais, on a monté un dossier de présentation à quelques maisons d’édition et Dupuis s’est montré très intéressé et enthousiaste. Ensuite, tout a été vite, le contrat et la réalisation de l’album. J’avais encore un pied dans l’animation, j’ai eu du mal à l’en retirer. J’ai continué à mi-temps au studio avant de me consacrer intégralement au dessin, les derniers mois. Là, j’ai encore un pied dans chaque monde, avec quelques missions quand j’ai le temps.
Laurence : C’était le début d’une grande aventure. Quand Carbone – à qui j’avais refusé un projet – m’a envoyé ce projet avec les illustrations de Gijé, j’ai complètement craqué, tout de suite. Mes maîtres ultimes en matière d’histoires, c’est Pixar, avec ces fables à double-lecture, des thèmes très forts où émerge la poésie. Et ça rejoint l’ADN de Dupuis, de ce qu’on considère être du tout public. Et cette histoire correspondait à ça. Il y a du Pixar chez Gijé, c’est beau mais il garde sa vivacité. Et c’est renforcé par sa technique particulière sans encrage.

© Carbone/Gijé chez Dupuis
Gijé : Je ne fais pas d’encrage, je ne sais absolument pas en faire. Du coup, j’ai trouvé la parade et j’utilise le storyboard comme un repère pour placer mes formes et mes couleurs quand je peins. Après quoi, je supprime mon calque storyboard pour qu’il ne reste que la couleur, au final. J’esquive les problèmes mais, finalement, ça me permet d’être plus spontané dans ma mise en couleur. Ça me donne aussi l’impression que le dessin est plus vivant. Aussi par ces imperfections ou son imprécision.
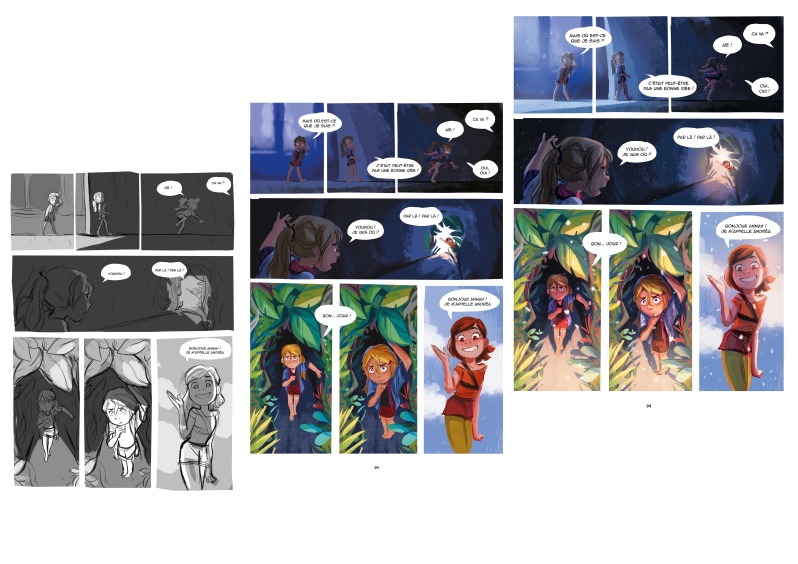
© Carbone/Gijé chez Dupuis
Et la transition ?
Gijé : Ce sont des modes de fonctionnement totalement différents. Réaliser une BD, je ne m’en sentais pas du tout capable. Ce n’est pas mon milieu, ni mes codes et références. Mais, finalement, le passage s’est fait en douceur et je me suis rendu compte que certaines tâches, je les réalisais déjà dans l’animation. Le storyboard, c’était un peu le découpage, finalement. Pareil pour les couleurs, les ambiances. J’avais le bagage pour que la transition s’opère délicatement.
Et votre dessin ne demande qu’à s’animer !
Gijé : Ah, c’est gentil ! Mais, il y avait une constante, j’avais tendance à trop découper les planches, comme si des petits fantômes d’animation me hantaient, des tics face à un dessin condamné à se figer.

© Gijé
Se figer, mais pas de trop. Avec des traces de cinéma dans la gestion des plans. Dans cette alternance de grandes illustrations et de plein de petites cases.
Gijé : C’est sûr, j’éprouve beaucoup de plaisir à imaginer des grandes images, ce qui permet de bien les travailler. Comme la séquence où le lecteur découvre l’herboriste de Pandorient dans son atelier, une jungle emplie de plantes et papillons. C’est certain, je bosse plus sur ces rares cases pour leur donner de l’expression, du mouvement, que le rendu soit « impressionnant ». Après, j’ai essayé de faire un chemin de cases, de plans, pour aider au maximum le lecteur à entrer dans ce monde parallèle.

© Carbone/Gijé chez Dupuis
Et dans votre dessin, vous gardez les échafaudages, les traits de construction. On voit le boulot.
Gijé : Oui, puis, je me suis souvent vu reprocher lors de mes études de ne pas toujours être propre et précis. Avec cet album, je voulais faire ce que je voulais, sans contrainte et cultiver quelque chose d’un peu crado, de spontané en tout cas. D’éloigner la perfection.
Avant d’entrer un peu plus dans l’histoire de cet album, que vous évoque le terme « boîte à musique » ?
Gijé : De la poésie. C’est le genre d’objet dont se dégage une musique mélodieuse, un peu triste peut-être. Et je trouve que Carbone a vraiment trouvé un nom qui corresponde bien à l’histoire, un côté triste mais aussi une douceur, une légèreté, du merveilleux.

© Carbone/Gijé chez Dupuis
Et une manière d’évoquer des sujets graves et parfois vus comme tabous pour les enfants en jeune âge.
Gijé : Et, finalement, ce n’est pas une mauvaise chose de les aborder. Il faut juste trouver une manière de raconter qui change le rapport face à ses sujets sensibles et en adéquation avec l’âge du lecteur.
Vous avez parfois dû freiner pour ne pas être entraîné dans quelque chose de trop sombre ?
Gijé : Pas tant que ça, c’est resté très spontané avec, comme je le disais, l’objectif que tout ne soit pas tout brillant, tout propre. Qu’il y ait un côté crasseux, une patte.
Après, c’est sûr que Pandorient, ce n’est pas juste un monde magnifique. Même si les plus moches ne sont pas forcément les plus méchants.

© Gijé
Le fantastique, c’était déjà votre dada avant cette histoire ?
Gijé : C’est l’un des thèmes qui me parlent le plus, j’ai grandi avec ces histoires. C’est ce que j’aime le plus : créer des personnages atypiques, étranges. Des animaux avec des corps humains. Ne pas rester terre à terre.

Au Pays d’Eden, fresque réalisée pour un centre de soins pour enfant à Redange au Luxembourg ©Gijé

Au Pays d’Eden, fresque réalisée pour un centre de soins pour enfant à Redange au Luxembourg © Gijé
Et ça a influencé l’histoire de Carbone ?
Gijé : Disons qu’à la base, Pandorient devait être une copie du monde réel, sans rien de fantastique. J’ai donc proposé à Bénédicte d’y allier un côté fantasy. Elle ne s’en sentait pas capable mais au final, elle y a réussi.
Avec un côté Alice qui, il me semble, fait son grand retour dans pas mal de récits ces derniers temps, non ?
Gijé : Je ne sais pas. Mais, cela s’explique sans doute, notamment, par le fait que tout le monde aime se rappeler les contes, les premiers rêves. Ça fonctionne sur moi en tout cas. Après, en dessiner une histoire, c’était un coup de poker. Mais les retours sont bons donc je suis encore plus content.

© Carbone/Gijé
Et le fait d’avoir fait du charac-design, ça aide dans la création et les mouvements des personnages de BD ?
Gijé : Assurément ! Quand je crée un personnage, mes réflexes d’animateur reviennent à la charge. Il ne s’agit pas juste de savoir si un personnage sera gentil ou méchant. C’est plus profond. J’ai ce besoin de les enrichir même si ça ne sautera pas aux yeux dans la bande dessinée ou même que ça ne se verra pas. Mais je dois creuser et créer leur personnalité. Un personnage méchant qui, au fond de lui, est en réalité gentil, je pars du fait que cela doit se voir au fond de lui, dans son regard, ça manière de bouge.

© Gijé
Vous remerciez Laurence, votre éditrice, pour son optimisme, c’est-à-dire qu’il y a eu des passages plus compliqués ?
Laurence Van Tricht (l’éditrice): Gijé maîtrise son art. Mais le plus dur fut de respecter les délais. Il a cru qu’il n’y arriverait pas.
Y’a-t-il pour autant eu des frustrations, une fois arrivé dans la BD ?
Gijé : Non, bien au contraire. Ce travail me correspond. Dans l’animation, on a beau faire partie intégrante du processus, on est membre d’une équipe, et le travail final n’est pas complètement nous. Ici, le résultat du travail, du dessin, de la couleur, même s’ils sont figés, c’est nous.

Travail de charac-design du balayeur pour le court-métrage Long live New York de Cédric Witz pour la sensibilisation au don d'organe © Gijé
La force de la BD ?
Gijé : L’imagination à laquelle elle donne toute sa puissance. La musique de la Boite à musique, par exemple, elle est cent fois plus belle en bande dessinée, même sans le son. On joue avec les codes, le lecteur comprend qu’elle magnifique et ne risque pas d’être déçu puisqu’il va imaginer la plus belle mélodie qui soit. Le langage est différent. Ce qu’on décide ou pas de montrer, également.
Autre grande première, le festival d’Angoulême !
Gijé : Ah oui, une grande première pour le tout neuf auteur de BD que je suis. Mon regard s’enrichit dans un milieu que je ne connais pas vraiment. Maintenant que je suis rentré dans cette chaîne, j’apprends plus qu’autre chose, ce monde s’ouvre à moi.

© Carbone/Gijé chez Dupuis
Laurence : Gijé est bien trop modeste pour le dire, mais face à de gros concurrents, c’est La boîte à musique qui a fait les meilleures ventes du stand Dupuis. On y croit beaucoup, tout fonctionne et on a envie d’aller loin.
Et votre culture bd, alors, de quoi se compose-t-elle ?
Gijé : Des mangas de ma jeunesse, par exemple, les Dragon Ball qui furent mes premiers livres. Urasawa et ses découpages magnifiques. J’essaie d’apprendre par les grands maîtres, en fait, tout en étant un peu en oppositions, l’efficacité de certains passe par la simplicité, moi, j’ai l’impression de toujours devoir rajouter énormément de choses pour faire passer tout ce que je veux.

Illustration © Gijé
Quelle est la suite, maintenant ?
Gijé : Le tome 2, en novembre. Avec ce besoin d’être plus ambitieux : il y a des promesses à ne pas trahir.Le lecteur va en savoir plus sur Pandorient.
Y’a-t-il déjà un nombre de tomes prévus ?
Gijé : Il y a du travail, en tout cas, et je me laisse aller. Il y aura des fins ouvertes et ambigües, laissant la porte ouverte. Carbone a déjà des idées pour le tome 6, en tout cas. Pour le reste, on verra, cela dépendra du succès de la série.

© Carbone/Gijé chez Dupuis
Avec déjà une réimpression, c’est plutôt bien parti !
Gijé : C’est incroyable, on ne s’y attendait absolument pas.
Laurence : Mais on y croyait dur comme fer, Dupuis était à fond derrière le projet, avec un gros boulot marketing, un suivi dès les work in progress. Notre carte de voeux, c’était la Boîte à musique. C’est génial et mérité face à un auteur qui s’émerveille de tout et possède autant de fraîcheur par rapport à d’autres qui, après pas mal d’albums, ont tendance à ronchonner.
Propos recueillis par Alexis Seny
Série : La boîte à musique
Tome : 1 – Bienvenue à Pandorient
Scénario : Carbone
Dessin et couleurs : Gijé (Page Facebook)
Genre : Aventure, Fantasy
Éditeur : Dupuis
Nbre de pages : 56
Prix : 12 €

Il cause de plus en plus, il fume mais il flingue aussi, en roi de la gâchette des meilleurs westerns ou des polars incisifs qui font son monde, Philippe Chanoinat. Regorgeant de projets, mêlant BD et cinéma sans modération et partant toujours de plus belle à l’aventure, celle qui mène aux frontières du réel et de l’horreur parfois, Philippe Chanoinat est aussi un auteur patrimonial, un défenseur sans peur et sans reproche qui s’attaque cette (nouvelle) fois à Pagnol et à Belmondo, en bons mots et en caricatures.
Bonjour Philippe, une nouvelle fois, c’est dans le cinéma de papa que vous nous emmenez à travers deux albums revenant sur l’art de Belmondo et celui de Pagnol. Caricatures à l’appui. Vous n’en aurez donc jamais fini de parler de cinéma ? Trouverez-vous toujours plus à dire sur le cinéma d’autrefois que celui d’aujourd’hui ?
Tout d’abord bonjour et merci de vous intéresser une nouvelle fois à mon travail et à celui de mes complices. Je n’aime pas cette expression « cinéma de papa » car elle a été employée par un aéropage de nuisibles pour critiquer le cinéma populaire. D’ailleurs, on ne parle plus de ces cons prétentieux alors qu’il n’y a pas une semaine où un film de Georges Lautner ne passe à la télévision. J’ai la prétention d’être un homme ouvert et s’intéressant à beaucoup de choses, mais je dois avouer qu’aujourd’hui le cinéma ne me procure que très rarement du plaisir. Heureusement qu’il y a un nombre infernal de supers séries. Comme je suis passionné par le cinéma, oui, j’ai toujours envie d’en parler, et encore plus de la musique.

© Chanoinat/Borot chez Glénat
Qu’est-ce qui fait le cinéma de Pagnol et celui de Belmondo ? Que vous évoquent ces seuls deux noms ?
Le cinéma de Pagnol est très atypique, c’est le sud de la France qui est à l’honneur, avec sa truculence et sa roublardise bonne enfant. Quant à Belmondo, c’est un physique, une voix, une manière de bouger, de s’exprimer, c’est plusieurs dizaines de films que j’adore. Un talent énorme.
Quelle a été votre porte d’entrée sur ces univers ? Le premier souvenir qui vous vient ?
Le clan des siciliens que j’ai vu à sa sortie avec mon papa, mon oncle Bernard et mon grand-père. Un souvenir chargé d’émotion, mon père et mon grand-père n’étant plus là. Ce jour-là, le petit garçon que j’étais est tombé raide dingue de ce film et de ses acteurs. Ensuite, j’ai découvert tout le reste. Avant ce grand moment, je peux parler de séries télé comme Au nom de la loi ou Thierry la fronde et des films d’Errol Flynn ou de Gary Cooper que je voyais aussi à la télévision et que j’adorais.
Pagnol, Belmondo, mais aussi tous ceux qui les entourent, ce sont des membres de votre famille ?
Belmondo, oui, sans hésiter, il est pour moi l’un des plus grands artistes français et je peux voir et revoir ses films toujours avec le même bonheur. Pagnol c’est différent, c’est la culture du sud et ce n’est pas la mienne. Par contre, j’aime son œuvre et je me régale en revoyant certains de ses films. Ma famille, c’est Georges Lautner, Michel Audiard, Henri Verneuil, Gilles Grangier, Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon, Bernard Blier et beaucoup d’autres, pour la France. En ce qui concerne le cinéma étranger, Il y a John Wayne, Richard Widmark, John Ford, Raoul Walsh, Charles Bronson, Sergio Leone et là aussi il y en a tellement !!!!
Comment expliquez-vous qu’ils soient devenus des monstres sacrés ?
Le talent et le charisme, ce n’est pas plus compliqué.
Jean de Florette
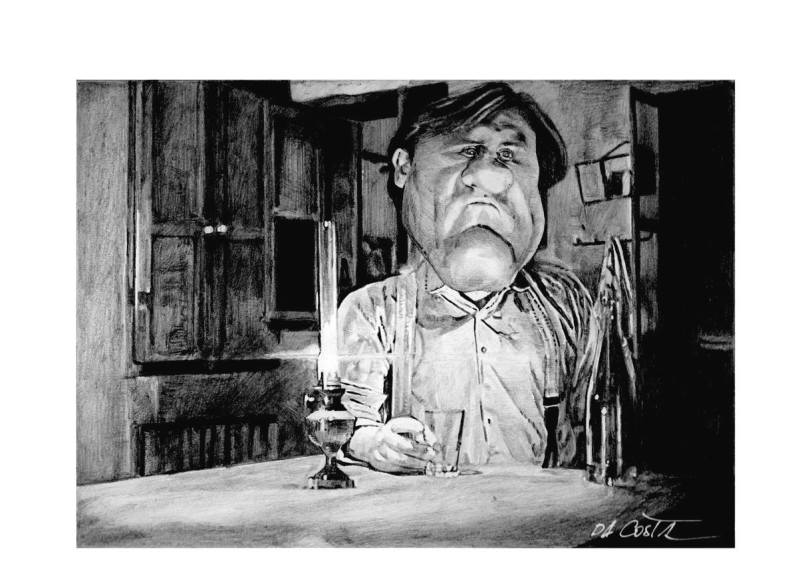
© Chanoinat/Da Costa chez Glénat
Finalement, ces deux monstres sacrés ne se sont jamais rencontrés. Un rendez-vous manqué ? Belmondo n’aurait-il pas eu sa place dans l’univers de Pagnol ? Aurait-ce été le cas si Pagnol avait vécu un peu plus longtemps ?
Belmondo a tellement de talent qu’il est capable de tout jouer, alors pourquoi pas dans du Pagnol. La rencontre ne s’est pas faite, mais il y a tellement de choses qui n’ont pas vu le jour, j’aurais adoré une rencontre entre Belmondo et John Wayne.

© Chanoinat/Borot chez Glénat
Les fréquenter, c’est aussi une manière de nous mettre en contact avec d’autres comédiens de légende. Raimu, Fernandel, Ventura, Rochefort mais aussi des « oubliés » comme Pierre Brasseur, Pierre Larquey ou Pierre Fresnay. Le temps est ingrat et sélectif. Ces acteurs ne méritaient pas d’être oubliés, n’est-ce pas ?
Ce n’est pas moi qui vais te dire le contraire, j’adore tous ces gens dont on ne parle plus, mais je sais que nous sommes encore nombreux à les apprécier et à regarder leurs films. Aujourd’hui, la télévision est un désastre, avec la télé-réalité où on montre des décérébrés vulgaires en train de s’insulter, des émissions avec des donneurs de leçons, les procureurs du politiquement correct, tout ça me file la gerbe. On vit une époque où la censure n’a jamais été aussi traumatisante depuis que je suis né. L’apologie de la bêtise, de la médiocrité et de la méchanceté sans humour.
Puis, il y a Minos, Adalbert-Maria Merli dans Peur sur la ville, dont vous dites que c’est l’un des psychopathes les plus effrayants du cinéma français ! Pourquoi ? Vous nous en parlez ?
Il suffit de regarder le film Peur sur la ville, ce mec est effrayant ! C’est un tueur en série complètement possédé par sa quête destructrice. C’est un assassin qui ne possède aucune pitié, persuadé d’avoir raison, un fou dangereux. Henri Verneuil, en réalisant son film, a su tirer le meilleur de son comédien, ça ne doit pas être simple de se glisser dans la peau d’un tel psychopathe.
Pour vous accompagner dans ce parcours chronologique des œuvres les plus marquantes de ces deux ténors de la pellicule, vous avez fait appel à deux compagnons de route : Borot pour Belmondo, Da Costa pour Pagnol. Comment cette collaboration s’est-elle passée ? Étiez-vous directif sur les images et représentation de scènes emblématiques que vous évoquiez ? Le style de Da Costa était une évidence pour dessiner Pagnol & CO ? Pareil pour Borot et Belmondo ?
Tout d’abord, avec Jean-Marc Borot, on s’est rencontré il y a quelques années et nous avons sympathisé, il avait entendu certaines conneries sur moi et n’en n’a pas tenu compte et nous sommes devenus amis. Il a comme moi un caractère bien trempé et, pourtant, notre collaboration se passe très bien. Nous ne nous sommes pas encore entre-tués. C’est un vrai plaisir de bosser avec lui, talentueux, efficace, concerné, motivé et ami fidèle. Nous préparons un album sur les Tontons Flingueurs que nous allons éditer nous-mêmes. Comme ça, on fera ce livre comme nous voulons vraiment.

Le professionnel © Chanoinat/Borot chez Glénat
Par respect pour les albums que nous avons fait et notre longue collaboration, je ne dirais rien sur Da Costa, mais le Pagnol, à moins d’un miracle, était le dernier que nous faisions ensemble.
Qu’est-ce qui fait qu’après tant d’années vous pouvez (et vous n’êtes pas le seul) revoir les films de ces deux as toujours avec autant de plaisir ?
Le plaisir toujours intacte, inaltérable !
Certains films sont parfois recolorisés, cela vous gêne-t-il ? Ou cela apporte-t-il un plus ?
Oui, ça me gêne qu’on restaure les films. C’est génial. Par contre qu’on les recolorises, c’est juste de la merde ! Un manque de respect à ceux qui ont fait ces films ! Vous allez me dire que certains n’avaient pas le choix à cause des budgets…

Marius © Chanoinat/Da Costa chez Glénat
… ou que la technologie ne le permettait pas ?
Oui, certes, mais ils ont été tournés comme ça et je ne vois pas l’intérêt de changer, tout ça pour plaire à des branleurs incultes qui ne supportent pas le noir et blanc.
Certains chroniqueurs, critiques ont dégommé sans prendre de pincettes certains films que vous revoyez sans modération ? Vous leur répondez en bonne et due forme, avec la verve qu’on vous connait, sans mâcher vos mots ! On ne vous changera pas ?
Mais pourquoi voudriez-vous que je change !!! Il n’en n’est pas question, j’ai certainement évolué en vieillissant, changé d’avis sur certaines choses, mais globalement, je reste celui que je suis et ça me va très bien. Je suis connu pour avoir une grande gueule et être ingérable. Ma version à moi est différente, je suis un mec cool mais je n’accepte pas qu’on me fasse croire que la merde à le goût du chocolat et vive versa. (rires)

La gloire de mon père © Chanoinat/Da Costa chez Glénat
Je remarque qu’on n’aime pas les gens qui disent les choses et ne se laissent pas casser les pieds, alors pour les dénigrer, on essaye de les faire passer pour des types infréquentables, ingérables, un peu cons. Faut savoir que les gens qui pensent ça de moi sans me connaître sont des imbéciles et qu’ils ne courront jamais aussi vite que je les emmerde. D’ailleurs qu’ils viennent me dire ça en face qu’on rigole.
On vit une époque où les les faux culs sont rois. La médiocrité et le nivellement pas le bar, c’est pratique de rendre les gens abrutis, ils sont plus faciles à diriger. Et pour finir là-dessus je dirais que j’ai plein de gens autour de moi qui m’aiment et m’apprécient et c’est le principal.

L’héritier © Chanoinat/Borot chez Glénat
Cela dit, avant vous, Jean-Paul Belmondo s’était fendu d’une « Lettre aux coupeurs de têtes » face à des journalistes unis qui avaient achetés une demi-page de pub dans Le Monde pour dire, en substance, que L’as des as volait ses spectateurs au film de Demy, Chambre en ville. Fallait pas le fâcher Bébel, hein ?
Belmondo n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pompes. À une époque, il aimait coller des bourre-pifs à ceux qui lui pétaient les noix. Quant à cette triste affaire, c’est encore une fois le fait d’une bande d’incapables qui se sont crus très malins, mais Bébel les a renvoyé au terminus des prétentieux.
Cela dit, vous n’êtes pas tendre non plus envers la production cinématographique actuelle. Rien ne vous a donc séduit ces dernières années dans le cinéma français ?
Pourquoi je serais tendre avec des nombrilistes suffisants qui, avec nos impôts, font des films sociaux où l’on passe son temps à cracher à la gueule des gens « normaux » en faisant l’apologie de Che Guevara en pâte à modeler, de dealers et autres parasites. Ou alors des comédies débiles qui feraient passer Max Pecas pour Georges Lautner.

Le doulos © Chanoinat/Borot chez Glénat
Après, il reste parfois des choses vraiment bien, comme ce que fait Dupontel. Ou Olivier Marchal. Et quelques autres. Dans le cinéma américain, il reste plus de bonnes choses, mais beaucoup moins qu’avant. J’adore le cinéma anglais, par contre.
Voyez-vous quand même certains comme dignes successeurs/héritiers de Pagnol ? Et de Belmondo ? On parlait beaucoup de Jean Dujardin, tout un temps.
Non, chaque artiste a sa propre personnalité et son propre talent et personne ne peut prétendre à remplacer qui que ce soit, après il peut y avoir des filiations.
Attention, ça se corse ! Si vous ne deviez ne choisir qu’un film de Pagnol et Bebel ?
Ben non, je ne te demande pas à choisir entre ta femme et un de tes enfants ! Hahahaha !

Manon des sources © Chanoinat/Da Costa chez Glénat
Et le pire film ?
Pour quoi faire ? Concernant ces gens je ne préfère ne parler que de ce que j’aime, j’ai trop de respect pour eux pour les dénigrer sur un ou plusieurs films, même si ces derniers existent certainement.
Dans cet album, vous sélectionnez Pierrot le fou, mais pas par goût personnel. Pourquoi ?
Nous étions deux à concevoir cet album plus le directeur de collection, j’ai tenu compte de leurs avis, même si je n’étais pas enthousiaste. J’ai essayé de trouver ce que je pouvais aimer dans les deux films de Godard.
Belmondo peut tout jouer, vous l’affirmez haut et fort. Mais, pour vous, quel fut son rôle le plus inattendu ?
Pour moi aucun, comme je le disais plus haut, il est capable de tout jouer, après c’est vrai qu’en curé dans Léon Morin, on est loin du Bébel virevoltant, mais c’est aussi pour ça que je l’aime.

100 000 dolars au soleil© Chanoinat/Borot chez Glénat
Aussi, ce n’est que tard qu’il a tourné avec votre second papa, Georges Lautner. De quoi donner cinq films mémorables. Pourquoi ne se sont-ils pas rencontrés plus tôt ?
C’est une bonne question, mais je n’ai jamais abordé le sujet avec Georges, donc je ne répondrais pas, pas envie de dire une connerie ou de raconter n’importe quoi.
Quel est pour vous le réalisateur qui a tiré le mieux profit de Belmondo ?
Il n’y en a pas un mais plusieurs, Melville, Verneuil, Lautner et d’autres.
Belmondo faisait ses cascades seul, des anecdotes là-dessus ? J’imagine qu’en ce temps-là, c’était nettement moins sécurisé et plus dangereux que lorsqu’un Tom Cruise fait ses cascades seul dans les années 2000 et 2010, non ?
Il y avait beaucoup de sécurité autour des scènes de cascades et des types comme Rémi Julienne étaient des vrais professionnels, mais il y avait quand même une part de danger. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’effets spéciaux, donc beaucoup moins de risques. J’aime bien l’acteur Tom Cruise, Il a joué dans de très grands films.

Le magnifique © Chanoinat/Borot chez Glénat
« Amuse-toi, ça empêche de mourir », une phrase issue de Cartouche qui est devenue votre devise ? Vous nous la recontextualisez ?
J’ai passé ma vie à essayer d’être heureux, parfois avec succès. Aujourd’hui, je me sens bien, je côtoie le bonheur et, malgré plein de choses qui m’énerve, je suis heureux. Je ne me suis jamais pris au sérieux et j’ai toujours abordé les choses avec humour, même les plus dures. Il y a quelques moi, à l’enterrement de mon Papa, j’ai dit aux croque-morts de le surveiller dans son cercueil pendant la cérémonie, car le connaissant, il était capable de se faire la malle. Ma façon à moi de combattre la tristesse qui s’était infiltrée à l’intérieur de mon cœur et qui me rongeait.
Votre album se termine sur l’Inconnu dans la maison, sorti en 1992. Les films de Belmondo sortis après n’ont pas trouvé grâce à vos yeux pour ce livre ? Moins intéressants ?
D’autres films auraient pu figurer dans ce livre, mais c’est un manque de place. Après L’inconnu dans la maison, il y a de belles choses.
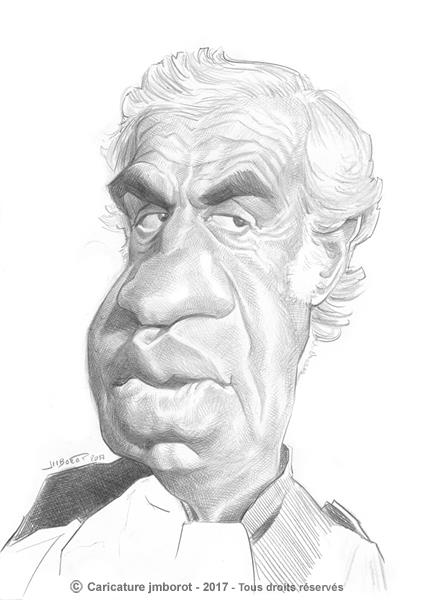
L’inconnu dans la maison © Borot
Comme ?
Je dirais Une chance sur deux de Patrice Leconte, le plaisir de retrouver Bebel et Delon ensemble. Certainement pas le meilleur film de Leconte (j’adore ce réalisateur) mais j’ai passé un bon moment. J’aime bien aussi Les Misérables de Lelouch et Les Acteurs de Blier.
Il se murmure que Jean-Paul Belmondo jouera un dernier rôle chez Fabien Onteniente. Excité ou plutôt horrifié ?
Pour l’instant, je ne détiens aucune information, et puis si les murmures de ceux qui murmurent dans un murmure s’avèrent exactes, on jugera sur pièce. Onteniente fait du cinéma grand public et, dans sa filmographie, il y a quelques trucs sympas.
Dans un autre genre, vous avez signé, sur le même principe, Il était une fois Sergio Leone, sorti en octobre dernier. Que pouvez-vous nous en dire ? Le western, c’est aussi votre dada ?
C’est tout simplement mon genre cinématographique préféré. Le Leone est un album superbe et hors éditeur classique. J’en suis très fier, mais apparemment il n’intéresse pas grand monde. Ce n’est pas grave, au moins il fait plaisir à quelques fans de ce grand réalisateur et c’est le côté positif de la chose, mais je suis déçu.
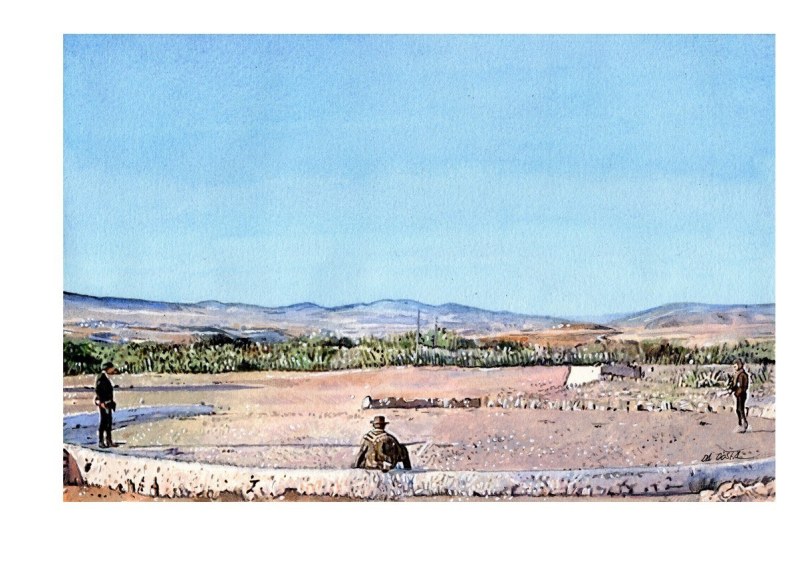
Le bon la brute et le truand © Chanoinat/Da Costa aux Éditions Bourguet-Gachon
Quitte à pousser l’amusement plus loin, vu votre amour pour le cinéma, n’avez-vous jamais voulu passer sur grand écran ? Réaliser un film ?
Bien sûr, mais c’est trop compliqué. C’est un milieu très fermé, je n’ai pas le bon carnet d’adresses, je ne suis pas comme certains prêts à baisser mon froc et à accepter n’importe quoi. Et puis, aurais-je le talent pour le faire ?
Aujourd’hui, au cinéma, on peut tout faire avec les effets spéciaux ! L’avantage de la BD c’est qu’on peut aussi tout faire… mais avec un tout petit budget.

© Chanoinat/Da Costa aux Éditions Bourguet-Gachon
En attendant, les films vous les réalisez en BD. Il y a eu trois tomes de Raoul Fracassin, Le réseau Mirabelle, des séries en stand-by malgré leur succès. Qu’est-ce que c’est que cette affaire ?
Je n’ai pas la langue de bois, mais pour l’instant j,e ne dis rien, j’attends des réponses et quand je les aurai, crois-moi, tu seras prévenu. Je n’aime pas les polémiques inutiles, là il y aurait beaucoup à dire mais j’attends. Je peux juste te dire, pour l’instant, que quoi qu’il arrive, il y aura un Fracassin 4. Nous bossons déjà dessus et nous le publierons nous-mêmes si on ne nous laisse pas le choix.

© Chanoinat/Loirat aux Éditions Jungle
L’actu immédiate, c’est cette immersion dans l’univers de Verne pour Deux ans de vacances. Jules Verne, ça c’est encore un univers passionnant, non ? Pourquoi cette histoire ? Pour ce faire, avec Frédéric Brrémaud, c’est un nouveau venu qui va poser ses dessins sur vos mots : Hamo. Pourquoi lui ? Comment vous êtes-vous trouvés ?
C’était un vieux rêve d’adapter ce roman de Jules Verne, c’est fait et je suis très content. J’ai reçu le tome 1 et je dois avouer que Glénat a fait du bon boulot au niveau de la maquette. Tu vois, je sais aussi dire les choses quand je suis content et j’aimerais que ce soit tout le temps comme ça. C’est Fred Brremaud qui a vendu le projet chez Glénat et le directeur de collections nous a proposé Hamo, choix judicieux. C’est un dessinateur talentueux et je suis content de son travail. Son style convient vraiment bien avec Deux ans de vacances. Hamo a su parfaitement retranscrire notre scénario et le livre de Verne. Un dessin à la fois moderne, tout en restant classique !
Face à un tel roman, que fait-on ? On essaie de moderniser un peu ? Ou, au contraire, la matière première est toujours autant moderne et ne vieillit pas ?
Fred et moi avons respecté l’esprit de Verne et avons apportés notre griffe à son roman. Son roman est toujours aussi moderne, mais sa manière de décrire les choses pendant des pages n’était pas envisageable en BD. Même en 3 tomes. Alors nous avons fait comme on le sentait.
Sinon, l’avenir s’annonce radieux et fourmillant de projets avec Jean-Marc Borot, Bob Garcia, Philippe Loirat, l’éternel complice Frédéric Marniquet, Fabrice le Henanff, David Verdier, Pascal Badré, l’insolent Djony Rubio… Ça en fait du boulot. Il va être question, je vous cite : « de tontons, de mystère à L’île d’yeu, de zombis, de flingueurs qui jouent les revenants, de disparus à St Agil, de Sherlock Holmes etc…! » Vous nous en dites un peu plus ?
Oui, beaucoup de projets, dont une grosse partie sera auto-produite : c’est de plus en plus compliqué de signer chez les éditeurs et comme nous avons envie de bosser sur des choses qui nous plaisent, on va faire comme ça. Comme je disais un Fracassin 4, un album sur Sherlock Holmes avec trois nouvelles, dont deux seront traitées en BD, ce sera un beau bouquin sur l’univers de Holmes.
Une BD d’aventure sur l’Île d’Yeu dans l’esprit Tif et Tondu ou Gil Jourdan, un one shot d’horreur avec des zombies sur une île au large de la Bretagne, un polar dans le Berry avec un tueur au rasoir.
Et avec votre pote Thierry Olivier vous avez toujours votre « Rocker Lycanthrope sous le coude ». Kezaco ?
Une BD qui se passe dans les années cinquante avec un bad boy qui se transforme en loup-garou, il est accompagné par une femme-vampire qu’il trimballe dans un cercueil à l’arrière de sa Cadillac, on va y croiser une horde de zombies, des tueurs, des chasseurs de vampires, etc. Ça va dépoter ! Le projet est chez un éditeur et on attend sa réponse.
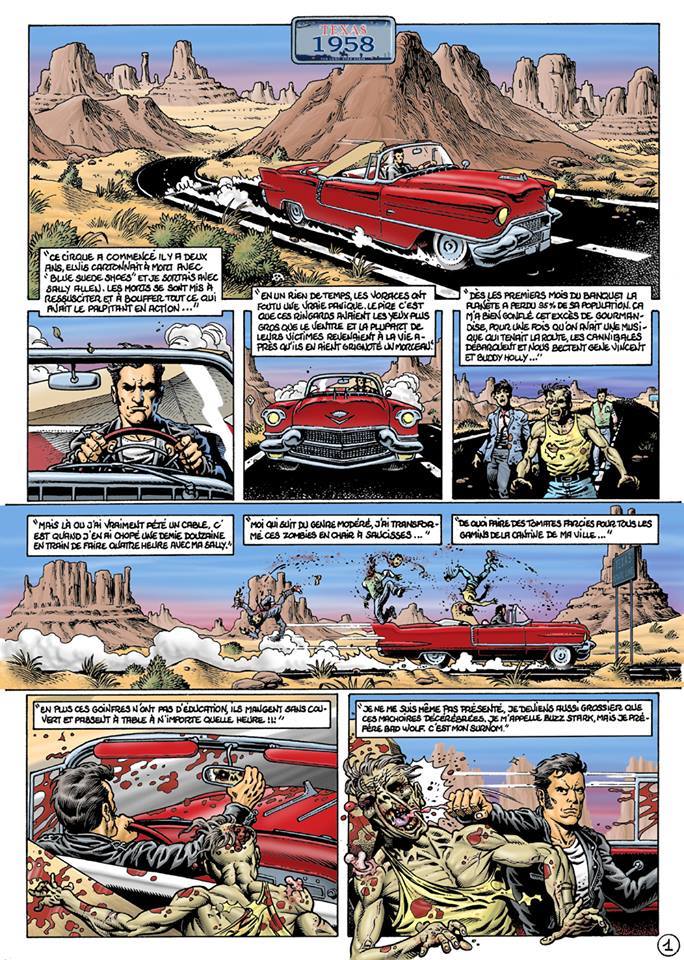
© Chanoinat/Olivier
Il y du Pierre Very (L’assassinat du Père Noël, Les disparus de St Agil) dans l’air, aussi ?
Noël Very son fils doit venir à la maison quelques jours en février pour que nous parlions d’adapter certains romans de son papa en BD. Il est emballé et, moi, c’est un rêve, en particulier Les disparus de Saint-Agil ! j’ai proposé ça à un directeur de collection qui m’a répondu que pour lui ce n’était pas culte. Du coup, au lieu de perdre mon temps, je vais trouver un moyen de l’éditer moi-même.
Et, cerise sur le gâteau, un (premier) roman ? Sur quoi ?
Un polar très violent, dans mon style, avec des dialogues malfaisants, une charge contre le politiquement correct sur fond de réseau pédophile. Mais, là, il va falloir être patient car j’en ai pour un moment.
Bon ben, on va vous laisser travailler à tout ça, alors! Au boulot !
Propos recueuillis par Alexis Seny
Titre : Pagnol fait son cinéma
Recueil, Anthologie
Textes : Philippe Chanoinat
Dessin : Charles Da Costa
Genre : Cinéma, Caricature
Éditeur : Glénat
Nbre de pages : 64
Prix : 15€

Cinq branches de coton noir, ça peut paraître bien maigre pour tenir la route dans une histoire qui fait des kilomètres, traverse des décennies et fait couler le sang. Car l’héroïsme en est fait, malheureusement. Et celui que nous content avec brio Yves Sente et Steve Cuzor dépasse de loin le simple but d’un être humain mais celui d’une nation qui continue de s’éparpiller malgré la guerre qui exigerait que tout le monde soit soudé. C’est une aventure qui dépasse aussi le simple courage et la mortalité que nous propose le duo. Rencontre dans l’ombre du Stars and Stripes. Le tout premier du nom.
Bonjour à tous les deux. Avant toute chose, face à un nouvel album de BD, deux choses nous saisissent, la couverture et le titre. Et pour le coup, le titre que vous avez trouvé est fameux, énigmatique et pourtant si symbolique des 150 planches dans lesquelles nous allons nous immerger.
Yves Sente : Pourtant ce n’était pas mon premier titre. Le premier fut refusé. Sur le chemin du retour à Bruxelles, j’ai eu cinq heures et, sous la pression, j’ai accouché de ce deuxième titre, et sa symbolique, notamment l’esclavage. Je suis content de l’avoir trouvé.
Et le premier titre, quel était-il ?
Yves Sente : Un titre plus coup de poing : l’étoile nègre, par analogie à l’étoile juive pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ça n’est pas passé auprès de l’éditeur qui avait peur des procès d’intention que feraient les lecteurs en voyant le livre et sans même prendre la peine de l’ouvrir.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
Et malheureusement, tout aussi formidable le titre soit-il, on ne peut que comprendre ces craintes à l’heure de l’emporte-pièce et du tohu-bohu polémique reposant souvent sur trois fois rien.
Yves : Mais ça ne m’a pas dérangé de changer, je ne voulais pas la jouer provoc’ et n’ai pas eu de regret. Pour tout dire, Il s’appelait Ptirou n’était pas non plus mon premier titre. Les premiers titres ne sont pas toujours les meilleurs !
Comment vous êtes-vous rencontré tous les deux ?
Steve Cuzor : Un scénario qui est tombé dans ma boîte mail, envoyé par Reynold Leclercq, éditeur chez Casterman. Ça m’a très vite parlé et on s’est fixé un rendez-vous en Bretagne, à Rennes, où Reynold et Yves ont débarqué.

© Cuzor chez Dupuis
Rencontre qui, quelques années plus tard, donne lieu à ce pavé. Pas moins de 150 planches. Vous n’avez pas voulu séquencer ?
Steve : C’était ce qui était prévu : deux tomes. Mais ça me gênait, il me semblait que cette histoire tenait en un souffle, un volume. D’autant plus que, quand on regarde le monde de la BD, les lecteurs sont très vite demandeurs d’une intégrale. Alors, au moment de signer chez Dupuis, on est parti sur le format one-shot. Ce qui fut, mine de rien, un marathon de 150 pages, avec un dessin exigent. Mais, c’est tombé à un moment où je pouvais me le permettre.
Après, du Washington de 1776 ou de la Seconde Guerre Mondiale, je n’avais traité aucun de ces sujets jusque-là. Il a fallu que je m’immerge, avec un gros boulot documentaire. De la part d’Yves aussi, j’ai trouvé mon écriture à travers les documents qu’il m’a fait parvenir. Après, le début est toujours plus long , il faut découvrir et apprendre à connaître ses personnages. Arrivé dans les Ardennes, j’étais super détendu. Je pense que j’aurais moins appris si j’avais dû faire trois volumes de cinquante planches.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
Et les dernières dizaines de planches, c’est un sprint non.
Steve : Pas que l’histoire s’accélère mais j’ai trouvé mon rythme, je ne me pose plus de question et je sais où on va. Cela dit, si ces scènes avaient ouvert l’histoire, je me serais peut-être planté. Mais là, je n’avais plus que la neige comme décor, le brouillard, le froid. La fin, j’y rentre comme une libération. Je n’ai plus qu’à penser à bien faire, mais en le faisant efficacement. Il faut lâcher les chevaux.
D’ailleurs, loin des planches, vous avez une carrière dans le rodéo, vous en avez retiré quelque chose dans votre métier d’auteur ?
Steve : En tout cas, à ne jamais stresser, surtout en période de négociation de contrat. Je ne lâche rien et je défends chèrement mon morceau. C’est mon côté maquignon. Mais sinon, ce sont quand même deux univers qui n’ont rien en commun.
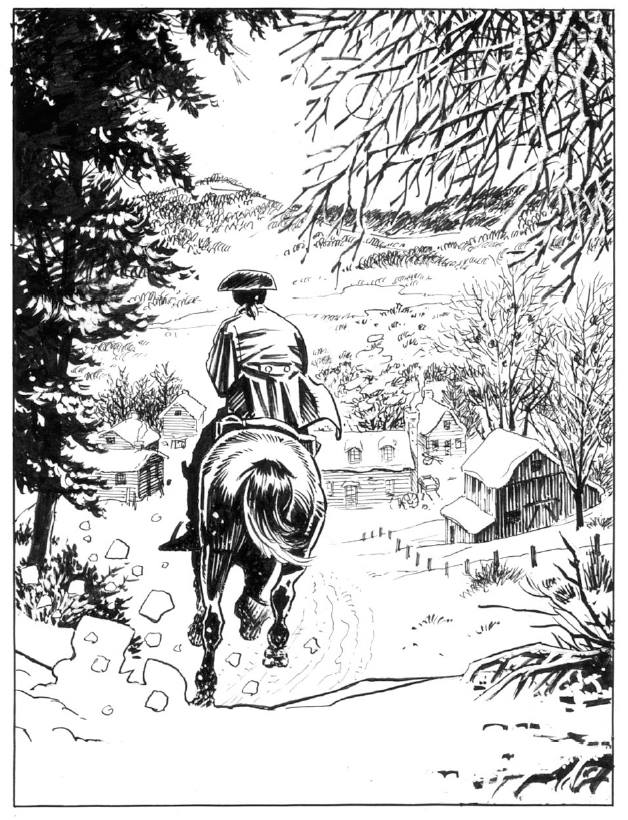
© Sente/Cuzor chez Dupuis
Un récit de guerre, c’est une première dans votre bibliographie, Yves !
Yves : C’est parti de Grzegorz Rosinski qui voulait que je lui écrive un récit de guerre. Il a changé d’avis en cours de route mais avait réussi à mettre mon cerveau en ébullition. Ce qui n’est pas dur, vous savez à quel point tout scénariste de BD veut un jour réaliser une histoire sur la guerre ou un western. Mais, dans le récit de guerre, quoiqu’on fasse, on a toujours des points de comparaisons avec d’autres oeuvres. Avec Cinq branches de coton noir, ce fut les Monuments Men qui ont connu leur succès au cinéma, dans le film de George Clooney, deux ans après que j’aie mis un point final à mon scénario. Forcément, quand ce genre de chose arrive, nous, scénariste que nous sommes, avons toujours peur qu’un autre ait utilisé le filon avant nous. Heureusement, ce n’était pas le cas. Puis, il faut dire que parmi mes sources, j’avais utilisé le livre de Robert M. Edsel dont est tiré le film.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
En fait, pour mon histoire de quête du premier drapeau américain par des soldats afro, j’avais besoin d’un alibi pour que mes personnages soient libres dans le cadre de la guerre, qu’ils ne soient pas enfermés dans un régiment dont ils auraient dû suivre faits et gestes. Le tout sans les priver de passer par l’incontournable lieu du débarquement : Omaha Beach. Et les Monuments Men étaient cet alibi, peu importe qu’ils n’aient jamais compté de chasseurs de trésor noirs parmi leurs membres.
Et une envie: être irréprochable face aux historiens.
Yves : Oui, plus que dans un XIII ou un Blake et Mortimer, c’est un plaisir, un jeu de faire en sorte que ce que je raconte soit crédible, béton. Je recherche à plonger dans un trou de l’Histoire avec un grand H mais tout en respectant ce qui entoure ce trou. De façon à ce que personne ne puisse vérifier que c’est une fiction.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
Mieux, de façon à ce que si je disais que tout est vrai, personne ne serait capable de prouver le contraire. Comme dans Fargo, le film des frères Cohen, qui s’ouvre sur un bandeau annonçant : « Ceci est une histoire vraie. Ces événements ont eu lieu dans le Minnesota en 1987. À la demande des survivants, les noms ont été changés. Par respect pour les morts, le reste est décrit exactement comme cela s’est déroulé. » Pourtant, on a du mal à y croire, tout part tellement en vrille, c’est incroyable mais c’est un très bon moment. Puis, sur les bonus du dvd, je suis tombé sur l’interview d’Ethan et Joel qui racontaient, à la question d’un journaliste, que non, du tout, ce n’était pas une histoire vraie. Quel culot, dire que tout le monde avait regardé ce film aussi loufoque soit-il en pensant qu’il était véridique. Ce jour-là, j’ai pris une leçon. Comme je n’ai jamais compris pourquoi le Da Vinci Code de Dan Brown avait reçu des mauvaises critiques disant qu’il racontait n’importe quoi. Mais c’est un roman génial, une fiction, c’est normal !
Ici, avec la dimension populaire de notre album, on voulait apporter un gage de qualité. Et des trucs énormes peuvent se passer, uniquement grâce au contexte, crédible. Ici, dans cette fiction, il y a cette quête d’une poignée de Noirs qui n’ont pour convaincre et recouvrir une certaine dignité.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
Le tout sans prendre position. Vous laissez ce boulot-là au lecteur.
Steve : Ce n’est pas le but de donner la leçon, de faire la morale sur quoi que ce soit. Le constat, les États-Unis le font à chaque mandat. Puis, quand on écrit une histoire comme la nôtre, on est toujours sûr de rattraper la réalité. Regardez, le Ku Klux Klan qui réapparaît, c’est hallucinant. Il y a, aux USA, un mouvement constant d’aller-retour. C’est dingue à quel point on peut être fasciné par un pays qui est tout aussi agaçant. Il serait difficile et aberrant de dicter une morale. Ce qui m’intéresse, c’est ce côté paradoxal des frères ennemis. Quand il s’agit d’une question de couleurs, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Pourtant, à la naissance, ils sont tous étrangers. Mais ils sont restés bloqués sur cette question. Leur étoile noire, persistante, c’est notre étoile jaune.
Vous savez, une guerre, c’est une crise, un conflit. Et si certains anciens, une fois la guerre finie, se sont assis autour d’une bonne bière à trinquer pour oublier ce qui étaient déjà des mauvais souvenirs; c’est le fatalisme, l’ennui qui amène le conflit. C’est dans un conflit qu’on se remet en question, qu’on recommence à réfléchir, à créer. À l’extérieur mais aussi à l’intérieur : notre positionnement par rapport à l’héroïsme, au dégoût de nous-même, les faiblesses, les qu’aurais-je fait. C’est de l’ordre de la théorie de comptoir mais c’est bizarre de constater que quand tout va bien, on s’emmerde et on n’a qu’une envie : que ça recommence. Le conflit nous ressemble, comme un miroir.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
Ce n’est pas parce que c’est la mode de montrer des gens qui meurent mais un récit de guerre interroge qui on est au sein d’un conflit. Et c’est riche.
Yves : Nous ne sommes pas militants, pas donneurs de leçons. Mais, par notre petite expérience en Amérique, on veut montrer ce qu’on a ressenti, le fait que le racisme n’a pas de camp. Qu’il y a des noirs racistes, aussi. La connerie humaine n’est pas à sens unique, et faire du racisme à sens inverse, c’est contre-productif. Il ne s’agit pas de donner le rôle du méchant à un blanc pour se déculpabiliser de ce qu’on a commis. Dans ce Stratego proposé par l’Histoire, en filigranes, il y a cette idée qu’il y a des imbéciles dans tous les camps.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
Puis, la réalité est bien plus complexe que les livres d’Histoire. Regardez Obama. Il n’était sans doute pas le Président dont la majorité de la population afro rêvait : il était éduqué, avait fait de prestigieuses études… D’ailleurs, les blacks ont voté pour Trump, un homme qui parle comme dans la rue, qui tweete comme tout le monde.
Venons-y à ce tout premier drapeau prétendument créé par Betsy Ross et disparu dans la nature! Quand on sait à quel point les Américains tiennent à leurs symboles et aiment les mettre en scène, il est incroyable qu’aucun auteur ou réalisateur ne se soit emparé de ce sujet romanesque par excellence !
Yves : C’est ce que je me suis dit : « pas possible, ça a déjà dû être fait ! » Je me suis mis à taper dans toutes les langues sur Google mais rien n’est sorti à part l’histoire de cette Betsy Ross. C’est dingue, parce que le Stars and Stripes, c’est un objet hautement symbolique. Beaucoup plus que chez nous !

© Sente/Cuzor chez Dupuis
Pour l’anecdote, à mes 18 ans, j’ai fait une seconde rhéto aux États-Unis. Profitant de la vie là-bas, j’avais été invité à une soirée. Et, à un moment, je suis tombé sur le père de mon hôte. En discutant, il a appris que j’étais un étranger et il m’a dit d’attendre et qu’il avait quelque chose pour moi. Une fois revenu, il m’a tendu un drapeau américain. D’un coup, il n’était plus saoul et, en me regardant droit dans le blanc des yeux, il m’a fait promettre une chose : que si le drapeau devait un jour toucher le sol, je le brûlerais ! Je trouve cet exemple tellement évocateur de l’attachement des Américains à leur drapeau. Leur Constitution prévoit même une série d’articles réglementant ce qu’on peut faire ou ne pas faire avec un drapeau.
Steve : Nous, en France, on a du mal à comprendre tout ça, ce patriotisme de base n’est pas forcément bien interprété. Nous n’avons pas la même histoire, non plus. Notre drapeau, il symbolise une histoire dont nous ne sommes pas toujours fiers, non plus.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
Eux, leur drapeau, c’est l’histoire et toute la symbolique de ce regroupement d’étrangers et de toutes leurs richesses. Vous ne pouvez imaginer ce qu’est le bonheur de recevoir pour la première fois ses papiers américains.
Dans cet album, la météo joue son rôle, changeante et baignant des scènes historiques mais aussi d’autres. Qui fait la météo dans votre duo ?
Steve : Pour le coup, c’est moi. L’histoire n’était pas pensée en termes météorologiques mais au profit de l’action, des personnages. Du coup, je me suis demandé ce que je pouvais apporter. La météo pourrie se justifiait, bien sûr, pour le débarquement : on a tous en tête ces images de mecs gelés.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
Au-delà de ça, certaines séquences du scénario manquaient de merde, d’un côté pourri qui plaquerait une ambiance au sol, qui créerait des flaques, permettrait de jouer avec des valeurs de gris, des hachures… Puis, dans certaines planches que je trouve trop linéaires, où je ressens le manque de quelque chose, il m’arrive de provoquer la pluie.
Mais qu’est-ce qui fait votre passion pour l’histoire ?
Yves : C’est venu par la lecture de beaucoup de choses. Puis, parfois, en regardant la télévision, une idée fait mouche. Et si nous voyions ce que donnerait ce thème s’il était poussé jusqu’à la fiction ? Le Blake et Mortimer sur Shakespeare, c’est ainsi qu’il est venu. Je ne connaissais rien sur Shakespeare et, dans une émission d’Arte, je me suis rendu compte que, depuis des années, des chercheurs s’interrogeaient sur l’identité du dramaturge, se demandant même s’il avait réellement existé. Alors, j’ai lu et j’ai découvert plein de choses.
Avec Cinq branches de coton noir, je ne pensais pas que je repartirais jusqu’en 1776. C’est en cherchant une quête que je m’y suis retrouvé. Une chose est sûre : on n’invente pas à partir de rien. Même les récits ancestraux comme l’Odyssée, ils résultent de la tradition orale, de récits similaires qui étaient partagés par les voyageurs.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
Steve : En tout cas, ça m’inspire plein de trucs. Avec ce projet, j’ai découvert certains sites recensant des photos d’époque, village par village, permettant d’écouter la radio de l’époque. Nous, en France, on a un gros problème avec nos archives, on ne peut que les consulter sur place, à Paris, sans pourvoir les emporter. Et elles ne sont pas sur Internet. Alors, oui, j’ai été surpris de trouver ces sites. Je ne pensais pas que de telles photos existaient, elles ont été prises par des centaines, des milliers de soldats américains lors de leur progression sur le sol français. Proportionnellement, je ne m’en suis pas tellement servi. Mais elles ont permis d’instaurer l’ambiance du projet.
Cette documentation, elle me permet de savoir que je suis sur le terrain, de le ressentir, d’être habité de plein de choses. À moi, à ce moment-là, d’être le créateur.
Et vous, Steve, pourquoi revenir sans cesse à l’Amérique ?
Steve : Parce que c’est toujours mieux de parler de quelque chose qu’on connaît. En tout cas, pour moi. J’ai vécu ces relations entre les Blancs et les Noirs, capables de s’aimer mais aussi de se haïr. En France, j’ai adoré Il était une fois en France de Fabien Nury et Sylvain Vallée. Mais il fallait que ce soit fait par des gens ancrés dans la culture parisienne. Moi, je n’aurais pas su quoi y mettre. Dans un projet, j’aime savoir quel est mon rôle et pourquoi je suis là. Si je n’ai pas la réponse à ces deux questions, je déserte.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
La couleur est particulière dans cet ouvrage, avec à chaque fois une couleur qui prend la prédominance.
Steve : Le choix de départ était de mettre en avant le noir et blanc. Les couleurs ont été un vrai sujet de discussion au départ. Mes potes me disaient découvrir réellement mon travail en exposition, face aux planches encrées. Il s’agissait de mettre en avant la première écriture dans ce qu’elle a de puissant et parlant mais sans la dénaturer, sans rien d’autre pour la codifier.
Il y a aussi ces photos d’archives, des diapositives poussiéreuses. Comme, en pages 82 et 83. Comment vous y êtes-vous pris ?
Steve : Il n’y a rien de pire que de dessiner, dans une case, un écran. C’est carré, comme une case. Il ne faut pas se planter et trouver un bon cadrage. Pour arriver à cet effet, j’ai bossé directement sur papier, ai encré puis scanné avant de rebosser sur Photoshop pour amener un effet flou. J’ai réimprimé sur une vieille imprimante avant de coller ces cases sur la planche. L’impression finale a fini de créer la perte, d’effacer tout code de la bande dessinée.
Des films de guerre qui vous ont marqué ?
Yves : Gamin, j’en ai vu des pelletées. Mais celui que je revois encore volontiers à chaque fois qu’il est diffusé à la télé, c’est le Patton de Franklin J. Schaffner avec George C. Scott. Il m’a marqué. Et c’est peut-être lui qui m’a donné envie de situer une partie de mon action dans les Ardennes.
Après, il y a bien sûr Il faut sauver le soldat Ryan, Band of Brothers, Lettres d’Iwo Jima mais aussi Un taxi pour Tobrouk.

© Sente/Cuzor chez Dupuis
Et en matière de guerre, quelle est la force de la BD par rapport au cinéma qui a les effets spéciaux pour lui.
Yves : En BD, par le texte, le dessin, le découpage, on peut jouer avec le rythme de lecture, avec le temps, avec l’importance de chaque scène. On peut rester trois secondes de plus sur une image. Au cinéma, on ne sait pas empêcher la bobine de tourner… même à l’ère numérique.
Quelle est la suite pour vous maintenant ?
Steve : J’écris une histoire complète, seul et également pour Aire Libre. Mais je préfère garder la surprise… aussi parce que j’ai trop peur qu’on me pique l’idée (rires).
Merci à tous les deux !
Propos receuillis par Alexis Seny
Titre : Cinq branches de coton noir
Récit complet
Scénario : Yves Sente
Dessin et couleurs : Steve Cuzor
Genre : Guerre, Drame, Aventure
Éditeur : Dupuis
Collection : Aire libre
Nbre de pages : 176
Prix : 24 €

Malheur aux vaincus et bonheur aux lecteurs ! Alors qu’on le présente de moins en moins, le duo fatal composé par Vincent Brugeas et Ronan Toulhoat (à l’origine, s’il ne faut en citer qu’un, du Roy des Ribauds) met la Sicile, carrefour des cultures et des caïds, à feu et à sang en compagnie de ce diable de Robert Tancrède. Un héros qui ne fait pas dans le détail et dont la vengeance se dessine peu à peu au bout de sa lame. Rencontre avec ces deux as du récit épique et historique.

© Brugeas/Toulhoat chez Dargaud
Bonjour à tous les deux, c’est la première fois qu’on vous reçoit chez Branchés Culture. Un petit retour en arrière s’impose, donc, comment s’est formé votre duo éclatant ?
Vincent Brugeas : On a commencé ensemble au lycée. En voyant que l’un adorait dessiner et que l’autre adorait écrire, on a vite compris qu’on pouvait faire de la bande dessinée ensemble, dès 2003.
Avec Ira Dei, vous nous revenez, pour changer, avec un récit de guerre. Vous aimez varier les décors tout en tournant autour de ce genre qui permet de mobiliser plein d’éléments, non ?
Vincent : La guerre met, en tout cas, tout de suite dans une situation qui permet pas mal d’histoires. Il s’agit moins de la guerre que du conflit, vecteur de péripéties entre des groupes antagonistes ayant un objectif commun ou pas.
Ronan Toulhoat : C’est un univers qui amène des récits fort dynamiques. La guerre entraîne des récits, des personnages dans des situations qu’on ne voit nulle part ailleurs avec une faculté à faire évoluer les personnages. Puis, les conflits charrient également différents types de narration.
Après, beaucoup d’autres genres m’attirent, le drame, le polar, les récits de piraterie, le western… Des types de récits qui m’ont bercé.
Justement, le dynamisme, c’est votre dada ?
Ronan : Oui, c’est ma définition du dessin, une recherche de puissance, de l’image qui claque, parvenir à en extraire le charisme. Cela passe par plusieurs jeux de contraste, le choix des couleurs. Mais, il m’est arrivé d’en jouer parfois avec exagération. Je me suis calmé un petit peu. Mon but, c’est que le lecteur ne s’ennuie jamais tout en évitant d’en faire trop pour ne pas lessiver le lecteur à la fin de l’album. Il faut parfois arriver à calmer le tempo. Mais mon dessin est, de base, nerveux, alors, forcément, ça s’en ressent globalement.

© Brugeas/Toulhoat chez Dargaud
Dans Ira Dei, c’est une foule de personnages qu’on retrouve au four et au moulin. Avec l’obligation de ne pas perdre le lecteur ?
Vincent : Personnellement, je n’ai pas de problème à connaître et reconnaître mes personnages. À partir du moment où la période a été fouillée, quand je sais où je vais, je connais intimement mes personnages. J’en fais une présentation dense pour me débarrasser de tout doute.
Ronan : Pour moi, la gageure était de créer des personnages sans retomber sur des tics d’auteur. Je contourne donc cette difficulté en m’inspirant d’un rôle d’un acteur dans une série ou un film. Ainsi Robert, au début, il ressemblait à Jared Leto, beau mais avec quelque chose de flippant dans le regard. Après, cela va sans dire que mon personnage se dégage de ces inspirations. Je ne veux pas qu’il soit le portrait d’un acteur, cela entraînerait un risque de rigidité et n’en ferait pas un vrai personnage de BD.

© Brugeas/Toulhoat
Puis, c’en est ainsi sur toute la palette de personnages. Le prêtre Étienne, il lorgne du côté d’Evan Peters, l’acteur d’American Horror Story qui joue Quicksilver dans les derniers X-Men. Pour Harald le Viking, j’ai évidemment été voir du côté des acteurs de la série Vikings.
Vincent : C’est vrai qu’il faut garder le lecteur à l’esprit, mettre tout en oeuvre pour qu’il ne perde pas de vue les personnages. Et pour ça, notre éditeur a veillé au grain, nous obligeant à faire attention, à prendre du recul.
Il y a aussi deux femmes, et non des moindres.
Ronan : On dit que les auteurs ont tendance à créer des personnages qui leur ressemblent. Alors des personnages du sexe opposé quand on est un homme. Il importait, une nouvelle fois, que ces héroïnes soient réalistes, humaines avant d’être des personnages, avec des parts d’ombre et des forces. Elles sont un peu le pendant de Robert et Étienne. Dans un contexte majoritairement masculin, elles devaient apporter autre chose, tout en s’évadant des archétypes et en les faisant évoluer. Marie, la soeur timide et secrète d’Étienne va s’émanciper. Côté viking, il y a cette espionne, manipulatrice qui révélera aussi ses faiblesses. C’est de l’ordre du jeu d’acteur.

© Brugeas/Toulhoat chez Dargaud
Un personnage au-dessus de la mêlée : le Normand Tancrède. C’était ce personnage et pas un autre qui allait mener l’histoire ?
Vincent : Mieux que ça, il est à l’origine de la série avant de convier d’autres personnages qui allaient lui donner du répondant. Après avoir trouvé la date sur laquelle on allait se poser, j’ai brodé, fait appel à la mythologie et fait jouer la petite et la grande histoire. Tancrède n’existe pas en tant que tel, il est fictif, mais il possède un lourd passé en tant que Robert.

Recherche de couverture © Brugeas/Toulhoat
Et dans la dynamique, je lui ai adjoint Étienne, le prêtre qui l’accompagne, qui, pour le coup, est totalement inventé.
Le décor, lui, est de choix. La Sicile…
Vincent : … comme une évidence, bordée par la Méditerranée et au carrefour des peuples comme point d’échanges mais aussi d’affrontements et de partages de cultures. L’île s’est imposée d’elle-même, entre terre et mer et de quoi offrir à Ronan l’occasion de s’amuser. C’est un fameux terrain de jeu comme l’Histoire sait en offrir. Il faut juste bien les chercher et on tombe parfois sur des mines d’or.

© Brugeas/Toulhoat chez Dargaud
Et sous ce soleil de feu, il n’y aura pas que des amabilités qui seront échangées.
Vincent : C’est plus une question de dynamisme et de tension que de violence, en fait. Il nous importe de maintenir le lecteur sur le pied de guerre, sur la corde sensible. J’ai envie qu’on soit dans un duel de western, comme quand les héros se fixent yeux dans les yeux. Maintenir cette impression tout au long du récit est mon leitmotiv.
En ajoutant une difficulté supplémentaire : le jeu des flash-back.
Vincent : Il faut à la fois qu’ils tombent aux bons moments et qu’ils lâchent une info importante et nous éclairent sur le passé non-connu des héros. Il faut les choisir avec attention, c’est vrai, mais c’est comme une recette de cuisine. Un peu d’instinct, d’intuition pour savoir quand il faut sortir le gâteau du four.
Le feu a lui aussi son rôle à jouer, il est omniprésent !

© Brugeas/Toulhoat chez Dargaud
Ronan : Oui, au-delà de la dominance chaleureuse, on voulait faire ressentir le fait que tous les personnages ont une part de diable en eux. Puis, c’est la couleur de la fureur.
Et il y a quelques scènes de choix pour l’exprimer. Vous entretenez la flamme pour des héros bien badass comme il faut. Mais l’apparence ne suffit pas, il faut travailler la psychologie, non ?
Vincent : Exact. Je pars toujours du principe que le voyage n’a pas d’importance pourvu qu’on aime les personnages et qu’ils soient charismatiques. J’y apporte un soin très particulier, ils doivent être les moteurs, que ce soit conscient ou inconscient, de l’histoire plutôt que de la subir ou d’en être écrasés.

Ex-libris pour BDFugue © Brugeas/Toulhoat chez Dargaud
Puis, il faut aussi faire attention à ce que le texte ne répète pas ce qui est dit par le dessin. C’est pour ça que nous travaillons, Ronan et moi, le storyboard en un bloc, durant un mois entier. On travaille l’histoire, la manière de la mettre en scène, on fait évoluer les dialogues quand le dessin fait l’impasse sur un élément. Au fil des expériences, on est convaincu que c’est la bonne méthode. Puis, plus loin, ça continue à évoluer, parfois un mot est changé de justesse pour être plus juste.
L’avantage de la proximité géographique pour les échanges.
Vincent : Avant, oui, plus maintenant, j’ai déménagé. Donc, on se skype, on est toujours connecté puis à force de s’être fréquenté, on se connaît.
L’une des scènes marquantes de ce premier album, c’est ce bombardement avec des oiseaux incendiés. Too much, non ?

© Brugeas/Toulhoat chez Dargaud
Vincent : Notre éditeur, Yves Schlirf, l’a pensé fort aussi en nous demandant de revoir cette scène. Je lui ai alors dit que c’était la seule chose que j’avais trouvée écrite noir sur blanc. Interloqué, il nous a dit de foncer, alors ! En fait, cet épisode se trouve dans l’épopée d’Harald le Viking qui apparaît d’ailleurs dans cet album. Bon, c’est un récit plus mythologique que réaliste mais ça me suffisait.

© Brugeas/Toulhoat
Ronan : Je n’avais aucune base, aucune référence pour créer cette séquence, alors, je me suis basé sur la logique et m’imprégner de la peur pour la mettre en scène et la rendre la plus impressionnante possible. Donner l’impression que tout le ciel s’enflammait.
Dans une vidéo publiée par votre éditeur, on vous voit avec un gant.
Ronan : Exact, il vient de la pratique et de la technique des auteurs travaillant numériquement et sur tablette. Ce gant évite de rayer l’écran. Moi, je l’ai adopté pour éviter de suer, de faire des taches et de salir les planches sur lesquelles je travaille.
Mais entre la couleur et le noir et blanc, comment préférez-vous vos planches ?
Ronan : Je suis un grand fan de noir et blanc, ce qui correspond à ma première réflexion. Mais comme je fais moi-même mes couleurs, je sais à quel point celles-ci vont venir appuyer l’encrage, le compléter, le terminer. En tant que dessinateur, je trouve que le noir et blanc explore une autre facette. Ce sont deux plaisirs, vraiment.

Extrait du tome 2 © Brugeas/Toulhoat
Dans les remerciements, c’est Emmanuel Herzet que vous citez, Vincent.
Vincent : Je l’ai connu sur un autre projet, une série en cours de réalisation. On se skype une fois par semaine avec, pour but, de s’améliorer mutuellement. Emmanuel, c’est un coup de foudre professionnel comme rarement cela arrive. Il y en a eu un avec Ronan et celui avec Emmanuel. C’est lui qui, le premier, a lu le scénario d’Ira Dei, son retour est toujours intéressant.
Récemment, Vincent, avec Thomas Legrain, vous signiez le premier tome de The Regiment qui revenait sur l’histoire du SAS. Finalement, d’où vous viennent cette passion et cette envie de visiter l’Histoire à différentes époques, dans des contextes variés ?
Vincent : En lisant énormément de livres d’Histoire, depuis tout petit, je me suis rendu compte à quel point elle était génératrice d’histoires, parfois folles. C’est là que j’ai appris que la réalité dépasse toujours la fiction parce qu’elle s’en fiche d’être crédible… là où le scénariste, le conteur essaie toujours de l’être.

Extrait du tome 2© Brugeas/Toulhoat
Ronan : Vincent y est venu plus tôt que moi. Je m’y suis vraiment intéressé et m’en suis passionné sur le tard… quand j’ai rencontré Vincent.
Quels sont vos projets ?
Continuer un peu sur Ira Dei. Puis, on donnera certainement un nouveau cycle au Roy des Ribauds.
Merci à tous les deux. Entre-temps, on a appris que vous seriez aussi à la tête d’une aventure de Conan le… Cimmérien, en mai chez Glénat.
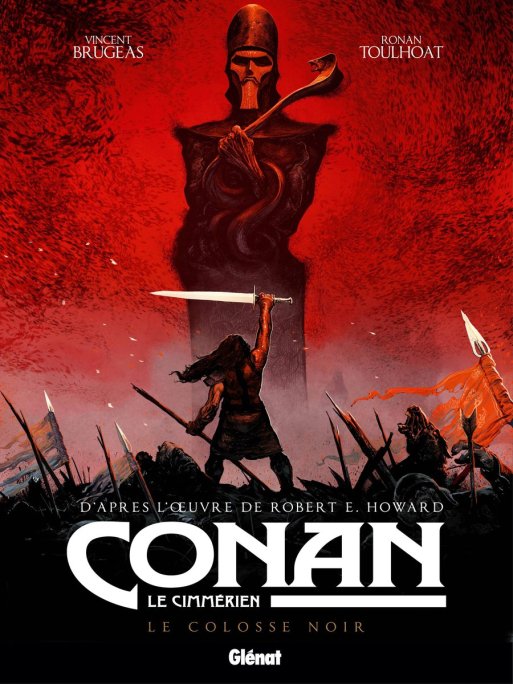
Propos receuillis par Alexis Seny
Série : Ira Dei
Tome : 1 – L’or des caïds
Scénario : Vincent Brugeas
Dessin et couleurs : Ronan Toulhoat (Instagram)
Genre : Guerre, Médiéval, Aventure
Éditeur : Dargaud
Nbre de pages : 64
Prix : 13,99€

Certains détails passent inaperçus pendant des années avant de resurgir comme des évidences. Si l’on connaît bien Spirou et que sa popularité ne faiblit pas, on était loin de s’imaginer qu’il avait un « aïeul » qui ne fit malheureusement pas long feu sur les ponts d’un paquebot en route et à flot vers le nouveau continent. Il s’appelait Ptirou, ou peut-être pas d’ailleurs, mais Yves Sente et Laurent Verron y ont vu un héros parfait pour un one-shot étonnant où la véracité des faits laisse place à l’imagination et à la fiction, à la grande aventure en habit de groom. Interview avec les deux auteurs. Embarquement immédiat.
Bonjour à tous les deux. Avec Il s’appelait Ptirou, vous proposez ce qui est sans doute, jusqu’ici, l’album le plus inattendu de cette série/collection «Vu par ». D’ailleurs, en fait-il partie ? Sur la couverture, rien n’en témoigne ?
Yves Sente : Non. Il ne fait bien sûr pas partie des « Spirou de… » pour la simple et bonne raison qu’il ne s’agit pas d’un récit mettant en scène le personnage de Spirou mais bien le récit du personnage de Ptirou… qui a inspiré Spirou.
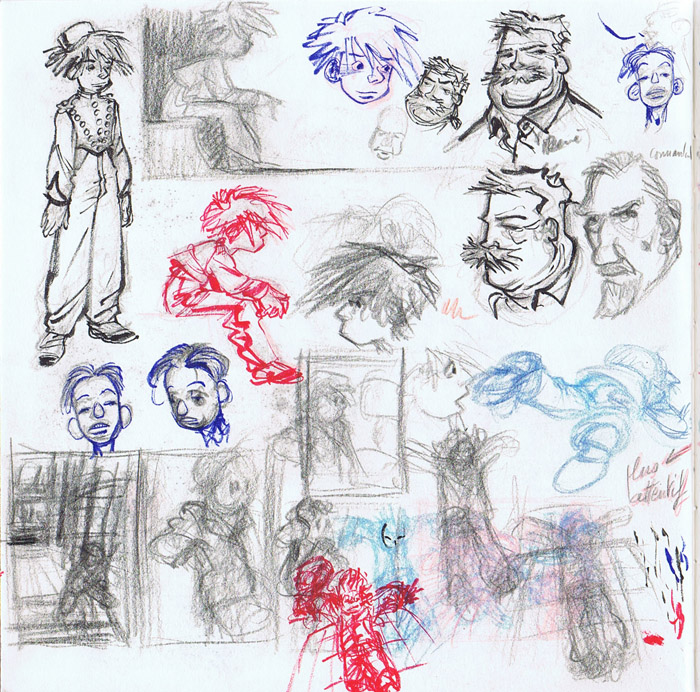
© Laurent Verron
Par ailleurs, quel est votre regard sur cette collection ? Qu’y avez-vous aimé ? Et l’évolution de Spirou et son univers, plus généralement, qu’en pensez-vous ?
Laurent Verron : Le principe est sympathique et l’interprétation de chaque auteur du personnage de Spirou est intéressante. C’est marrant, on est dans une période qui ressemble un peu au tout début des années 1980 où Dupuis voulait faire dessiner Spirou par plusieurs équipes. Ce qui était très décrié à l’époque…
Yves Sente : Personnellement, quand j’ai été en âge de découvrir les nouveautés de Spirou, c’était Fournier qui était aux commandes. Aaahh… « Du Glucose pour Noémie » ! Bien sûr, par la suite, j’ai découvert les merveilleux albums de Franquin, puis de Tome et Janry et leurs successeurs. J’ai plus récemment découvert avec le même bonheur les « Spirou vu par » de Bravo, Yann et Schwartz, Le Gall… Pas mal de pépites dans tout cela.

© Sente/Verron chez Dupuis
La période Rob-Vel de Spirou, que représente-t-elle pour vous ?
Laurent Verron : La préhistoire de Spirou. Je n’ai même pas tout lu Rob-Vel. C’est vrai que c’est très éloigné de la BD d’après guerre et encore plus de celle d’aujourd’hui.
Yves Sente : Une période « très historique », plus proche de « Bécassine » que de la BD d’après guerre des journaux Tintin, Spirou, Pilote… C’est très intéressant sur le plan historique mais c’était quand même déjà fort éloigné des canons de lecture de ma jeunesse.

© Rob-Vel © Dupuis
Quel est votre rapport à ce héros au calot ? Quel est votre « âge d’or » le concernant ? Pourquoi ?
Yves Sente : Gamin, j’ai découvert la BD avec Tintin au Congo à l’âge de 6 ans. Je ne savais pas encore lire. Ce fut un choc. Après, toute BD qui me passait dans les mains était littéralement dévorée, qu’elle vienne de n’importe quel journal ou de n’importe quelle «école». Spirou fut évidemment un des premiers personnages qui a suivi Tintin dans mes assuétudes.
Laurent Verron : Spirou, pour moi, ça a été d’abord un journal que je lisais avec avidité. J’y ai découvert Gaston et Le Trombone Illustré, ce qui m’a amené à Franquin. C’est alors que je me suis mis à lire ses Spirou, assez tard finalement. Ses albums restent mon « âge d’or » de Spirou.

© Laurent Verron
On a tous en tête cette célèbre planche de la naissance magique de Spirou de la main de Rob Vel, mais j’ignorais totalement ce qui avait pu inspirer à l’auteur ce personnage devenu emblématique. Qu’est-ce qui vous a mis sur la piste de ce groom de paquebot ?
Yves Sente : Un témoignage de Rob-Vel lui-même issu du livre « La Véritable histoire de Spirou » de Christelle et Bertrand Pissavy-Yvernault. Quelques lignes qui m’ont fait l’effet d’un choc et dans lesquels Rob-Vel raconte que c’est un mousse de sonnerie (origine véritable de cet uniforme rouge à bouton doré), qui avait mortellement chuté dans une cale lors d’une traversée sur un paquebot où il était steward, qui lui a inspiré l’apparence de Spirou lorsque, des années plus tard, Paul Dupuis est venu a Paris lui proposer de créer le personnage. Le drame semblait avoir beaucoup affecté Rob-Vel. Pour moi, c’était clair : je devais à tout prix raconter l’histoire de ce mousse anonyme.

© Sente/Verron
J’imagine, Laurent, que dans votre volonté de ne plus faire de reprise, vous n’étiez pas spécialement partant ! Qu’est-ce qui a changé la donne ? Qui vous a séduit dans cette histoire ?
Laurent Verron : C’est vrai que, lorsqu’Yves m’a téléphoné pour me proposer de faire un Spirou, je n’étais pas « chaud ». Mais dès qu’il m’a raconté qu’il s’agissait du véritable groom qui avait inspiré Rob-Vel, j’ai été enthousiasmé. Nous n’étions pas sur le personnage de bande dessinée mais sur un personnage réel dont on ne sait rien. Là, nous étions dans de la création pure et c’est ça qui m’a plu.

© Laurent Verron
C’est aussi votre premier album chez Dupuis, peut-être encore plus étonnamment pour Laurent. Que représente pour vous cet éditeur ? Et pour vous Yves qui avez été éditeur ? Vous sentez une évolution éditoriale chez Dupuis ? L’audace et la revalorisation de son patrimoine (Tous les « vu par », les reprises…) sont-elles compatibles ?
Laurent Verron : En effet, cela me fait tout drôle d’être publié chez Dupuis, moi qui étais beaucoup plus « Spirou » que « Tintin ». Je suis chez l’éditeur de mes lectures de jeunesse ! La valorisation de leur patrimoine éditorial est la bienvenue, les dossiers de ces intégrales sont très bien faits et on y apprend plein de choses.
Yves Sente : Les reprises ont toujours existé dans la BD. Tout le monde semble l’avoir oublié mais Franquin était lui-même un « repreneur », tout comme Jijé. Cela n’enlève rien à la qualité de leur travail. Nous essayons de poursuivre honorablement (et pour le plaisir des lecteurs en plus du nôtre) cette tradition, tout comme l’éditeur.

© Sente/Verron
Mais entrons dans le vif du sujet avec cette histoire sur deux niveaux, entre cette veillée de Noël 1959 et cette croisière transatlantique de 1929. Pourquoi ce Noël 1959 ?
Yves Sente : 1959, parce que c’est l’année de la première apparition de Boule et Bill dans le Journal Spirou (le 24 décembre). C’était un clin d’œil de Laurent qui ne me gênait aucunement puisque je voulais installer « notre Oncle Paul » vers la fin des années 50.

© Sente/Verron chez Dupuis
Avec une utilisation des couleurs à contre-courant de ce qu’on voit habituellement dans les flashbacks. Tant qu’à parler de couleurs, Laurent, sur vos crayonnés, vous utilisez du noir, du rouge, du bleu. Pourquoi cette diversification ? Que vous permet-elle ?
Laurent Verron : Cela me permet de ne pas saturer mes dessins : je mets en place les personnages et les phylactères dans les décors avec le bleu ou le rouge puis je précise les attitudes avec une autre couleur et les expressions et certains détails avec une troisième . (Souvent, je termine avec le noir.) Lorsque plusieurs éléments se superposent, c’est plus clair pour moi.

© Sente/Verron
Elles sont présentes au début du processus mais aussi au final. Vous signez les couleurs de cet album, ça faisait longtemps que ça ne vous était plus arrivé ! Le plaisir est intact ?
Laurent Verron : Oui, c’est un plaisir de mettre en couleur ses planches. Et puis, j’y suis allé un peu à l’improviste et il aurait été difficile d’expliquer à une ou un coloriste ce que je voulais.
Le personnage qui nous ouvre la voie à cette histoire aux bases réelles mais au déroulement fictionnel n’est donc nul autre que l’Oncle Paul ! Que vous évoque-t-il, ce personnage ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de le faire revenir ? N’a-t-il pas ouvert la voie d’une certaine BD du réel? Y’a-t-il d’autres personnages dont vous vous êtes inspirés dans cet album ?
Yves Sente : Il y a beaucoup de gens qui s’appellent Paul et le « nôtre » porte une barbichette. De plus, il a une petite nièce en plus de deux neveux. Ce n’est donc pas celui du Journal… mais il est évidemment là pour y faire penser ! (Rire) Mais, puisque j’avais décidé de triturer l’univers du Journal Spirou, autant y aller à fond. Les fans de Spirou ont droit, dans cet album, à un vrai second degré de lecture.
En tout cas, certains personnages ne dépailleraient pas dans des vieux films noirs ! Comment les avez-vous campés, tous ces personnages ? À quoi doit-on penser dans leur création ?
Laurent Verron : Dans le scénario d’Yves, chaque personnage est décrit avec précision et moult détails sur sa personnalité. Cela me convient car je peux ainsi m’appuyer sur de bonnes bases pour créer graphiquement les protagonistes de notre récit. Je tiens à ce que chacun soit bien différent tant au niveau de la silhouette, de la physionomie, du visage, bien sûr, mais aussi dans sa façon de bouger. C’est très important que le lecteur ne les confonde pas lorsqu’il croise l’un ou l’autre personnage.

© Sente/Verron chez Dupuis
L’oncle Paul, un personnage-clé pour nous emmener vers d’autres époques, nous voilà donc en 1929. Dès les premières cases, on s’y croit, dans l’ambiance, les costumes, les bâtiments et, plus tard, les voitures, l’avion et le bateau. Quel travail de reconstitution, Laurent, non ? Comment vous y êtes-vous pris ? Beaucoup de documentation ?
Laurent Verron : Yves m’a fourni beaucoup de documentations. De même que mon ami et scénariste Yann m’a prêté un formidable bouquin sur les paquebots d’avant-guerre et j’ai aussi trouvé des photos sur internet. Mais il y a eu des moments où j’ai dû inventer, surtout en ce qui concerne certaines parties du navire et de l’hydravion car je ne trouvais rien qui puisse m’aider ! Mais nous ne faisons pas un récit documentaire ou purement historique. L’essentiel est que le lecteur ait l’impression que tout est cohérent et crédible et qu’il s’imagine parcourir les coursives ou les salles des machines du navire.
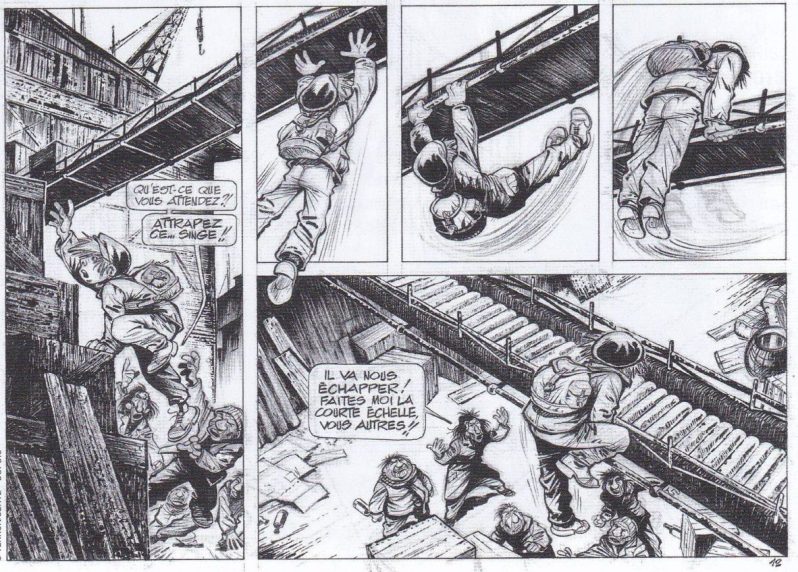
© Sente/Verron
Puisque la majorité de cette histoire se passe sur un genre de Titanic (le mot est lâché, il y a de ça chez vous, non ?), comment vous êtes-vous approprié la vie à son bord ?
Laurent Verron : Yves et moi trouvions intéressant de montrer la vie quotidienne à bord par des cases muettes. Ce sont les photos d’époque récoltées plutôt que le film « Titanic » qui m’ont servi de références pour cela.
Yves Sente : Pour être sincère, le film qui a traversé mon esprit n’était pas « Titanic » mais bien « La Légende du Pianiste sur l’Océan » dans lequel la vie des cales est beaucoup plus présente… et qui ne se termine pas en film catastrophe (ce qui n’était pas notre propos).
Ça a dû vous dépayser de Boule et Bill ? C’était le bon moment pour passer à autre chose ? Vous a-t-il fallu un temps pour sortir des réflexes Bouleetbillesques ?
Laurent Verron : Yves est tombé pile au bon moment avec ce projet de Ptirou. Je commençais à me lasser de Boule & Bill et j’avais cette envie de faire des choses plus personnelles. Perdre les réflexes Boule&Bill était- est- toujours un de mes objectifs pour essayer de progresser et actualiser mon dessin.
Entre le vertige du cirque (dans lequel un drame va changer la vie de Ptirou) et le mal de mer à bord, je me suis vraiment senti en immersion. Y’a-t-il eu un travail graphique particulier pour veiller à ça ou vous êtes-vous approprié les flots et leurs mouvements de manière assez naturelle ?
Laurent Verron : Je travaille avec la même motivation et le même enthousiasme sur toutes les scènes. L’immersion est naturelle au fur et à mesure de l’avancement des séquences. Mais c’est vrai que la mer est difficile à dessiner. J’ai dû trouver des solutions pour résoudre certains problèmes graphiques et faire ma « petite cuisine ».
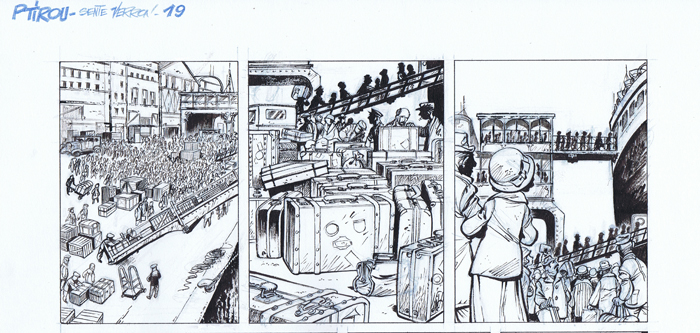
© Sente/Verron
L’histoire vraie de Ptirou, qu’en sait-on ? Pas grand-chose ? Ce qui vous permettait du coup d’agir en totale liberté ? Plus que dans un Thorgal ou un Blake et Mortimer qui sont pourtant des séries totalement de fiction ? C’est paradoxal, non ?
Yves Sente : Liberté totale ! C’était notre envie et la condition (immédiatement acceptée) posée auprès de Dupuis. Tout est inventé sur base de cette anecdote qui m’a inspiré mais dont on ne sait quasiment rien. Comment s’appelait ce gamin ? Mystère. Était-il roux ? Boule de gomme. Nous nous sommes donc absolument tout approprié.
Laurent, certaines de vos envies ont-elles été intégrées au scénario ?
Laurent Verron : Je me suis permis certaines modifications dans le découpage et la mise en scène d’Yves. J’ai même rajouté une séquence dans l’histoire. Toujours en commun accord avec Yves. Ce fut une très agréable collaboration.
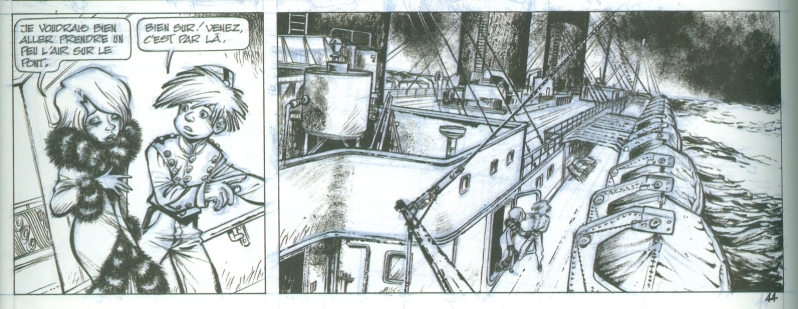
© Sente/Verron

© Sente/Verron
On l’a vu, Rob-Vel a été fortement influencé pour créer Spirou par cette rencontre sur un navire. Et vous, ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens que vous avez mis (ou auriez bien mis) en BD ?
Yves Sente : Non. Pas personnellement.
Laurent Verron : En ce qui concerne les personnages secondaires et les « figurants », il m’arrive d’intégrer des gens que j’ai « croqués » dans la rue ou ailleurs. Ces croquis pris sur le vif sont nécessaires pour renouveler l’inspiration et pour créer de nouvelles physionomies.
Notons que les faits avérés sont très dramatiques : le groom dont Rob-Vel s’inspirera meurt sur ce bateau. Jusqu’au bout, vous brouillez les pistes. Ptirou connaîtra-t-il le même sort, le doute est permis ! Comment avez-vous choisi la fin de cet album ?
Yves Sente : Secret de fabrication. Joker !
Toujours est-il que, dans un cas comme dans l’autre, il n’y aura pas de suite… du moins pas avec Ptirou mais peut-être bien avec… Juliette (cette jeune fille accablée par une maladie qui va se prendre d’affection pour votre groom), c’est ça que vous entendez avec « la suite une autre fois »?
Yves Sente : À la place de la petite Marie, je voudrais aussi connaître la suite. Attendons Pâques 1960. Nous verrons bien…
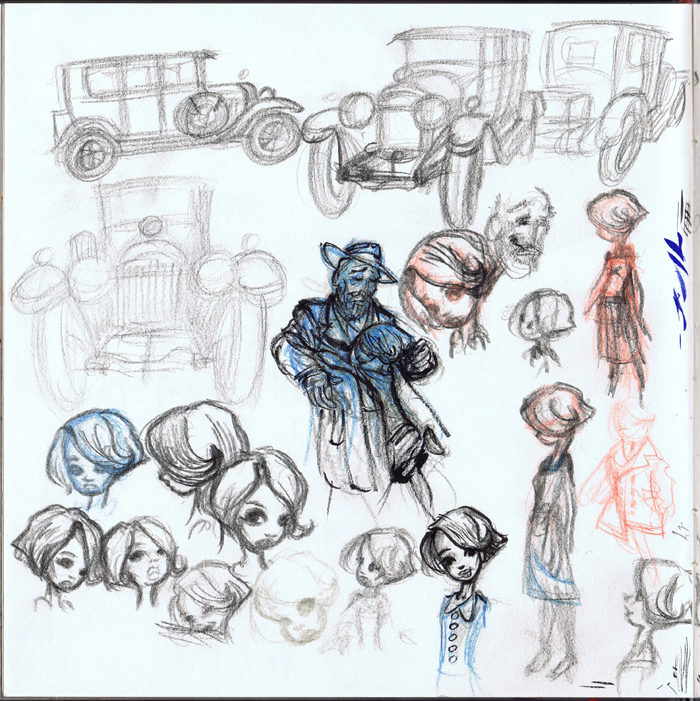
© Laurent Verron
Oui, mais qui est cette Juliette, au final, un personnage ayant existé avec un destin fabuleux ?
Yves Sente : Patience, patience…
Vous ne changeriez rien à votre duo pour cette suite ?
Laurent Verron : Surtout pas !
Yves Sente : Vous savez, si on change ne fût-ce qu’une personne d’un duo, il ne reste rien du duo… J
D’autres projets ? En tout cas, Yves, vous n’en avez pas fini avec Dupuis puisque sort, d’ici quelques jours, Cinq branches de coton noir. Qu’est-ce que ça racontera ? Vous collaborez avec Steve Cuzor, une belle rencontre, là aussi ?
Yves Sente : Une belle rencontre également, nous en parlerons.
Avec plaisir et à très vite pour découvrir le destin de Juliette, alors !
Propos recueillis par Alexis Seny
Titre : Il s’appelait Ptirou
Récit complet
Scénario : Yves Sente
Dessin et couleurs : Laurent Verron
Genre : Drame, Aventure, Histoire
Éditeur : Dupuis
Nbre de pages : 80
Prix : 16,50€

Au journal des bonnes nouvelles, Dodo et Cha ont éclipsé le gore et la terreur des actes du Grand Khalifat (vous l’aurez reconnu) pour en garder l’absurdité et l’emmener faire un tour dans un trip halluciné du côté de la Syrakie. Finies les décapitations, place au décapant humour de ce tandem réuni pour la première fois aux côtés de trois héroïnes attachantes qu’elles soient intrépides, faibles, barrées, femmes tout simplement dans un monde d’hommes décérébrés. Ou quand le rire réfute la peur et que la triste actualité et le désœuvrement humain qui croit aux pires des sottises s’en vont se balader dans un récit d’aventure à couper le souffle. Interview avec les deux auteures autour du Voile noir et de l’exposition que propose le Centre Belge de la Bande Dessinée.

© Dodo/Cha/Drac/Takaku chez Casterman
Bonjour à toutes les deux. C’est un tandem jusqu’ici inédit que vous formez pour cette aventure tonitruante en… Syrakie. Comment votre duo s’est-il créé ?
Dodo : Les éditions Casterman avaient envie de travailler avec moi et sont venues me chercher pour que j’écrive une histoire d’aventure. J’ai cherché un petit temps avant le déclic. Ce sont les attentats de Charlie Hebdo qui m’ont mis la puce à l’oreille et m’ont aiguillé vers ce sujet des jeunes partis combattre en Syrie. Est-ce que je pouvais aborder cette thématique de manière décalée ? Casterman m’a dit Go ! Et c’est parti ainsi.
Après, si je voulais collaborer avec un jeune auteur, je ne savais pas qui allait pouvoir dessiner ça. Casterman m’a bien fait quelques propositions de dessinateurs, sans parvenir à me séduire. Ça ne m’emballait pas, je ne voyais pas mon histoire selon le graphisme de ces potentiels auteurs. Le déclic est arrivé un an tout juste après les attentats de Charlie Hebdo. Un 7 janvier sur la place de la République. On s’est laissés portés jusqu’à un bistrot où était attablée l’équipe de Fluide Glacial. Au fil de la discussion, Pixel Vengeur m’a dit : « Mais c’est Cha qu’il te faut »! En effet, je ne vois pas qui d’autre aurait pu, ça collait vraiment.

© Dodo/Cha
Le voile noir, qu’y a-t-il derrière ce titre ?
Dodo : Deux choses. D’abord, le fait d’être aveuglé, de se lancer même si on ne voit rien. Deuxièmement, parce que dans le pays dont on parle, la majorité des femmes portent ce voile noir.
Puis, mine de rien, ces trois mots anodins, je trouve, laissent un parfum d’aventure planer, un peu de mystère, non ?
Dodo : Je vois ce que vous voulez dire ! Un peu comme si on avait fait Le voile noir… et le secret de la licorne. C’est mystérieux, ça, non ? (Rires)

© Dodo/Cha
Et vous, Cha, dans des décors qui ne sont pas les vôtres, d’habitude, il y a eu des craintes ?
Cha : Oui, par le sujet, c’était délicat, j’avais un peu peur. On en a discuté avec Dodo et on s’est vite rendu compte qu’on était totalement en phase par rapport au traitement. Pour le reste, l’écriture coulait toute seule, je n’ai pas eu à me prendre la tête pour mettre cette histoire en images, c’était très instinctif.
Dodo : Ça me désolait de savoir le si grand nombre de jeunes qui étaient partis faire le djihad. Je voulais m’adresser à ces adolescents avant tout. Mon humour, il n’est pas méchant, il est caustique, il n’avait pas besoin de limite, ça venait comme je le sentais.

© Dodo/Cha/Drac/Takaku chez Casterman
Cha : C’est de l’humour avant tout. Je trouvais ça gonflé de traiter avec humour un tel sujet. Nous ne voulions pas faire un reportage BD, il y en avait déjà ou des similaires. Par contre, cette aventure humoristique au-dessus de la thématique dure nous permettait d’amener quelque chose de nouveau dans le spectre des ouvrages traitant des départs en Syrie.
Justement, comment êtes-vous entrées en collision avec cette thématique qui hante nos actualités depuis un bout de temps déjà.
Cha : Entrer en collision, c’est le mot. C’est avec les événements de Charlie Hebdo que c’est devenu très concret. Je n’aurais jamais pensé faire une BD là-dessus. Du coup, pour recréer ces décors, pour capter ces ambiances, j’ai regardé énormément de documentaires. Je voulais que les gens que nos héros fréquenteraient dans la rue soient au plus près de la réalité. Je voulais savoir comment se passait leur vie.
Après, pour documenter tout ça, j’ai ingurgité tant de vidéos, d’images… et forcément des choses beaucoup moins plaisantes quand on s’intéresse à Raqqa : des décapitations, etc.

© Dodo/Cha/Drac/Takaku chez Casterman
Une violence qui, si elle est présente et sous-entendue, n’est pas représentée.
Cha : Oui, il s’agissait de suggérer plus que de montrer, ne pas être gore, ne pas faire dans la violence inacceptable. Avec Dodo, on s’est vraiment bien entendue, aussi lorsqu’il a fallu établir le pré-découpage. Dodo a aussi beaucoup documenté la maison des femmes et a pas mal utilisé le livre d’une dame partie en Syrie et qui en est revenue difficilement… mais revenue quand même. Tout cela a parsemé le récit.

© Dodo/Cha
Avec des choses difficiles à représenter ?
Cha : Une scène a peut-être posé plus problème que d’autres. Malgré la grosse banque d’images dont je disposais, je ne pouvais pas savoir à quoi ressembleraient la maison des femmes et la cave de celle-ci. Il restait des choses à inventer donc, j’ai essayé d’être dans la continuité, de trouver une architecture typique.

© Dodo/Cha/Drac/Takaku chez Casterman
Et ce trio aussi bien assorti que mal assorti composé de deux amies et d’une tante complètement barge, comment est-il né ?
Dodo : Je ne voulais pas faire une reporter qui part dans un pays pour documenter ce qu’il s’y passe. Je voulais une nana jeune et une seconde héroïne plus âgée. Après, j’ai un peu pensé, sans aucune prétention d’égaler ce qu’a fait Hergé, à Tintin et, surtout, au capitaine Haddock. Je voulais que ce personnage féminin soit complètement loufoque, foldingue.
Le troisième personnage, ça aurait pu être un homme. Mais ce fut une autre fille. Je me suis notamment servi du témoignage d’une fille partie en Syrie et qui m’a raconté son enfermement. Mon but était guidé par cette envie de montrer la vie des femmes dans ce milieu.

© Dodo/Cha/Drac/Takaku chez Casterman
En Syrakie, donc. Mais pourquoi avoir choisi un pays fictif ?
Dodo : Ça bouge tellement vite. Qu’allait-il se passer à Raqqa d’ici à la publication de notre livre. Choisir la Syrakie comme destination, c’était un moyen d’être intemporel de coller à l’actu sans y coller vraiment.
Finalement, vos copains de Charlie d’ici ou de l’au-delà, ils s’y seraient retrouvés dans votre aventure. Vous prouvez, si besoin était encore, qu’on peut rire de tout !
Dodo : Résolument, on peut rire de tout mais tout dépend de la façon de faire. Puis, on a vu tellement de reportages différents, on devait choisir un autre angle d’attaque.

© Dodo/Cha
Cha, près de deux ans et demi sont passés entre votre précédent ouvrage et Le voile noir. Qu’avez-vous fait pendant ce temps ?
Cha : J’ai travaillé pour différents magazines. Comme AAARG! avec un article illustré sur Cuba. Deux punks qui, à l’époque où le sujet était totalement méconnu, en totale ignorance, s’étaient injecté le virus du sida pour être admis dans un sanatorium et être nourris et logés. Il y a eu des histoires courtes aussi.
Puis, pour Topo, j’ai consacré un reportage de 25 pages, en compagnie de Sara Roumette encore à Cuba.

© Dodo/Roumette
Cuba, vos héroïnes du Voile Noir pourraient aller y faire un tour, non ?
Dodo : Pourquoi ne pas continuer avec les mêmes personnages. Même eux nous ont confié qu’ils aimeraient bien repartir. C’est Tante Alice qui nous l’a dit
Cha : Peut-être pas à Cuba, pourtant. Dodo a d’autres idées de sujets « faciles » en lien avec l’actu. Comme les réseaux de prostitution africains.
Et quels sont vos autres projets ?
Dodo : Une histoire corse, avec Glen Chapron. Un récit de 130 pages, cette fois dénué d’humour et basé sur des faits réels, dans les années 80 et avant, entendus lorsque j’étais gamine – je suis Corse. Ça parlera de mafia, de FNLC (Front de libération nationale corse), d’omerta mais aussi, et surtout, d’une jeune fille d’origine corse qui, un jour, va être prise en voiture par un homme qui va prétendre être son demi-frère. Ce qui est impossible pour elle.
Sinon, j’ai une autre histoire d’humour couillon avec Ben Radis pour Fluide Glacial. Ça s’appelle « Bienvenue sur la planète Terre » et cela conte les aventures de deux extraterrestres qui ont tout pour eux sur une superbe planète, idyllique. Problème : ils s’emmerdent et décident donc de partir faire de l’humanitaire sur une planète en détresse: … la Terre.
Cha : Je vais refaire un reportage pour Topo avec un autre journaliste sur le problème des attaques de requins à La Réunion.
Pour terminer, votre actualité immédiate, outre la sortie du Voile Noir, c’est l’exposition de ses planches au Centre Belge de la Bande Dessinée de Bruxelles (jusqu’au 4 mars).
Cha : Oui, 27 planches originales sont exposées. Ça fait du bien, mine de rien, d’autant plus que quand je réalise une planche, tout me semble brouillon. Les voir exposer, c’est aussi intimidant. Pas désagréable du tout, pourtant, ça fait plaisir.
Merci à toutes les deux et longue vie à Pauline, Gina et Tante Alice !
Propos recueillis par Alexis Seny
Titre : Le voile noir
Récit complet
Scénario : Dodo
Couleurs : Drac, Reiko Takaku
Genre : Aventure
Éditeur : Casterman
Nbre de pages : 48
Prix : 13,95€
 |
©BD-Best v3.5 / 2024 |