
 Flux RSS
Flux RSS

Véritable curiosité des réseaux sociaux et de plus en plus de salons, Laurent Zimny dépeint un monde de héros (pas que super, d’ailleurs, car il y en a pour tous les goûts) à sa façon et en dessin vectoriel totalement assumé. Réinventions haute en couleurs, les créations toutes personnelles de cet artiste sur le tard (mais qui n’a, au vu de ses oeuvres, pas à le rattraper, le retard) font leur chemin, entre vintage et futurisme, tout en nous ramenant en pleine face ces personnages mythiques de la BD, du cinéma ou, plus généralement, de la pop culture en pleine figure. Même pas mal ! Interview avec ce génie naissant lors de son passage à la Fête de la BD d’Andenne.

© Jimmy Hublet

Popeye © Laurent Zimny
Bonjour Laurent, cela fait finalement très peu de temps qu’on vous voit souvent passer sur les réseaux sociaux avec vos relecture graphique de super-héros (et d’autres).
C’est vrai, ça fait un an et demi, deux ans. J’étais architecte, avant. Mais, quand j’étais jeune, je voulais faire de la BD, je devais avoir quinze ans, mes parents ont refusé.
Du coup, j’ai passé un bac technique, je l’ai raté avant de le repasser avec la certitude de ne pas rester dans ce milieu. J’ai donc opté pour un compromis : l’architecture. Ainsi, je pouvais dessiner et mes parents considéraient que c’était « un métier ». En tant qu’architecte, je me suis spécialisé dans la 3D et la perspective.

© Laurent Zimny
J’ai ensuite créé avec des amis plusieurs structures d’architecture et donc fait mon métier d’architecte jusqu’il y a quatre ans quand on a dû déposer le bilan. J’étais à vide, avec du temps, plus de boulot, pas d’argent mais plus rien à perdre et aucun manque du monde de l’architecture. Je suis retombé dans mes premiers amours. J’ai repris des encres, des acryliques et surtout le… dessin vectoriel.
En un mois, j’avais dessiné une trentaine de personnages et, notamment, un Surfeur d’Argent qui a fait mouche sur les réseaux sociaux.

Le surfeur d’argent © Laurent Zimny
À ce moment-là, les gens se son mis à me demander de dessiner des personnages. Sur ces mêmes réseaux, j’ai commencé à avoir des commentaires m’incitant à faire une exposition. Je n’en voyais pas l’intérêt à l’époque. Mais j’ai tenté l’expérience quand même et la première exposition a eu lieu au Caf&diskaire de Lille dont un des patrons est fan et lecteur de comics, ça tombait bien, j’adore leur programmation et leur bistrot ! L’expo devait rester accrochée durant deux semaines et qui ont finalement tenu trois mois. C’était super.

La guêpe © Laurent Zimny
Qu’est-ce qui fait votre culture BD ?
En franco-belge, Les Petits Hommes du regretté Pierre Seron. Je les ai lus et relus. Eslapion, ce fut ma première leçon d’architecture. Puis il y a eu les comics pocket en noir et blanc. Mes premiers comics furent des fumettis. Diabolik, aussi. Puis, Swamp Thing, la créature du marais, tellement étrange mais tellement fascinant. Après, j’ai arrêté d’en lire, parce que là où je vivais il n’y avait pas de magasin de BD. J’ai renoué avec la BD en VO chez ASTROCITY à Lille, à 18 ans, quand je suis arrivé à ecole d’architecture.

La créature du marais © Laurent Zimny

La créature du marais © Laurent Zimny
Mais comment avez-vous atterri si vite en Belgique, ici à Andenne ?
Andenne, c’était mon tout premier salon BD, grâce à Mauricet qui a vu un de mes dessins sur le net. C’est par lui que tout a commencé, il a parlé de moi à Tony d’Atomik Strip et boom, me voila en train de déguster une Caracole à Andenne! Mauricet m’a aussi fait l’honneur de faire la couverture d’une petite histoire que j’ai réalisé sur le Mister Miracle de Jack Kirby

Mister Miracle © Laurent Zimny
Mais diable, quelle est votre technique ?
Tous mes dessins sont des dessins vectoriels (comme Arthur De Pins et Alexandre Clerisse), c’est à dire qu’ils sont 100% numériques. Le dessin vectoriel ne génère aucun pixel , on crée des courbes et on tire sur des poignées pour dessiner, c’est assez particulier, il n y a pas vraiment de technique comparable dans le dessin traditionnel. Cela dit, je fais toujours un crayonné avant. Le vectoriel est l’outil idéal pour obtenir des belles courbes, avoir des aplats parfaits.

© Laurent Zimny
J’ai toujours été tétanisés par les couleurs. Du coup, au moment de dessiner, je ne sais jamais ce que je vais mettre, pour quel rendu je vais opter. Les couleurs que j’utilise sont assez uniques, je les crée pour mon dessin. La couleur appartient au dessin.
Si vous avez commencé sur les réseaux sociaux, aujourd’hui on touche vos dessins. Il y a même une sérigraphie, ici, à Andenne.
Quand j’étais architecte, j’adorais aller chez l’imprimeur pour la sortie des plans et des images de synthèse, c’est la que le travail de toute une équipe apparaissait enfin. Ce passage, j’en ai gardé la magie.

Batgirl © Laurent Zimny
Comment les choisissez-vous ces personnages que vous réinterprétez ?
Au coup de coeur ! On ne me paye pas, je n’ai pas de contrat, pas d’éditeur – je cherche du boulot d’ailleurs ! -, du coup, je m’amuse. Je prends ces dessins comme des cadeaux. Parfois, cela crée des rencontres. Comme celle avec Victor Santos à Andenne.

Polar © Laurent Zimny
Il y avait aussi ma rencontre avec Antonio Lapone. Nous avons été manger un bout au restaurant de Serge Tholomé, Itinérance gourmande, on a discuté de notre travail et, tout d’un coup, Antonio m’a demandé: « T’as de quoi dessiner? » et il ma proposé de faire une séance de dédicace avec lui. C’était totalement improvisé et génial de me retrouvé la avec ce grand monsieur.
Ces personnages, comme ce Spirou et ce Fantasio, ils n’ont parfois pas de bouche, pas de nez ?
Ce n’est pas toujours utile. C’est une des leçons apprises de mon métier d’architecte. Avec l’outil numérique, je pouvais mettre une variété de détails qui, au final, sur un projet, n’allaient pas servir. On perd parfois du temps à des choses qui n’aident pas. Avec mes dessins, je cherche la simplification, je veux voir jusqu’où je peux aller dans la simplification tout en restant fidèle au personnage. Je suis très heureux de voir que, dans un style si éloigné des modèles, les enfants sont capables de reconnaître les personnages que j’ai redessiné. Ça veut dire que ça fonctionne !

Spirou et Fantasio © Laurent Zimny
Combien de temps vous faut-il ?
J’ai fait un Batman, dix minutes de crobards et, en une heure, j’avais fini. Quand je suis chaud, je fais six dessins par jour. Je fais mes croquis dans le métro, le train, au café, bref quand je peux.

Croquis du géant de fer © Laurent Zimny
Ça dépend aussi des effets, des ombres. J’ai mis sept minutes chrono en main pour une Power Girl, un Shadow a par contre été beaucoup plus long à assembler.

Power Girl © Laurent Zimny
Vos maîtres ?
Celui qui m’a le plus étonné dans le domaine du dessin vectoriel, c’est Alexandre Clérisse, en plus il a une culture artistique indéniable qu il arrive a injecter das ses histoires. Après, inévitablement, Arthur de Pins. Lui, il a un truc. Je me demande toujours comment il fait !
Dans la Bd traditionnelle: le principal, c’est Darwyn Cooke. Puis, j’ai aussi des références artistiques surtout avec des artistes comme David Hockney , Hans Arp, le mouvement Cobra,
Parker de Darwyn Cooke ! Ça c’est ce que j’aurais aimé faire en traditionnel, franc du collier, direct, efficace.
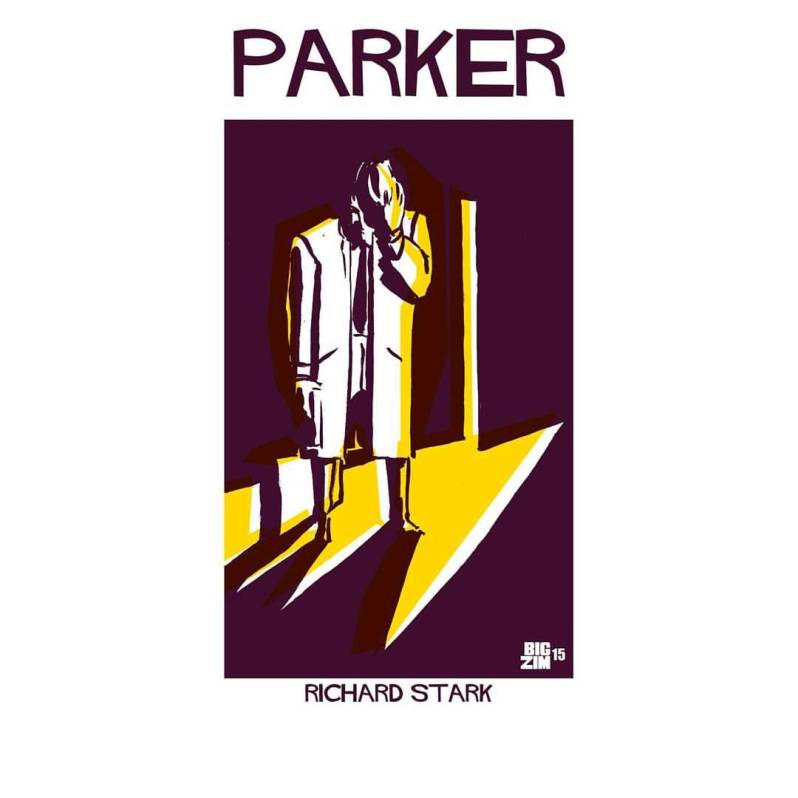
Parker © Laurent Zimny
Et la BD en tant que telle, c’est pour bientôt ?
Je suis en transition. La bande dessinée, c’est un autre délire. C’est spécial. En théorie, je pense comprendre. La BD m’attire de plus en plus, en tout cas mais la j ai tout a apprendre d’où ce court hommage à Mister Miracle. C’est un petit exercice. Ce n’est pas mon personnage mais lui dédier un petit scénario m’a beaucoup plu. C’est ce qui me plaisait, en fait, dans l’architecture : pas construire en tant que tel mais mettre en forme des idées !

Tarzan © Laurent Zimny
Que pourraient-elles raconter vos histoires ?
Par exemple, après une soirée Comixology au Comic Con de Paris, je me suis perdu dans la ville, mon téléphone était en rade. Un vrai Very Bad Trip. J’ai marché durant quatre heures et je suis arrivé à Saint Ouen. Je me suis dit que je raconterais bien cette histoire, mon périple et ces rencontres improbables dans la nuit. En dix minutes, j’avais découpé dix planches. J’ ai la chance d’avoir des pros comme Alain (Mauricet), Karl T. (Tollet) et Elsa Charretier qui me donne des conseils .
J’ai envie d’apprendre, je vais voir des dessinateurs qui savent y faire, je me prends trois baffes et je m y remet.
La BD, ça a toujours été un fantasme.
J’essaie de comprendre le business de la BD, des éditeurs, de la monétisation du dessin,des délais et, finalement, c’est très semblable au monde de l’architecture qui demande qu’on bosse de plus en plus, qu’on soit polyvalent, sans pour autant être payés plus et c’est rare qu’on vienne vous chercher. J’ai failli travailler avec Brian Michael Bendis juste avant qu’il parte de Marvel. J’ai réussi à le rencontrer au Comic Con de paris et il m’a donné des contacts et des conseils avant de partir chez DC. Mais ça m’énerve de ne pas avoir pu collaborer avec lui comme il en était question mais patience, j’ai encore du boulot et pas mal de choses à apprendre.
Comme on dit souvent, « a suivre »
Et on y compte bien ! En attendant, on peut vous retrouver sur votre Tumblr.
Propos recueillis par Alexis Seny
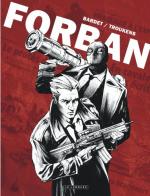
Saint Nicolas n’a peut-être plus de crosse (du moins en Belgique, selon un débat stérile) mais il a les armes pour se venger. Saint Nicolas, cette année, c’est un peu François Troukens, ancien gangster réconcilié en raconteur d’histoire ne manquant ni d’ampleur ni d’ambition. Ce 6 décembre, en Belgique, mais aussi en France, sort Tueurs, un film de braqueurs très contemporain et filant à toute allure sur le ring de Bruxelles mais aussi d’un cinéma franco-belge qui ne voit plus souvent ça. Avant de découvrir ce film, dans la même veine qui laisse gicler l’encre à profusion (plutôt que le sang, le moins possible en tout cas), François Troukens forme un tandem éblouissant de noirceur mais aussi de poésie avec Alain Bardet pour Truand, un roman graphique nerveux, avec un look de story-board (mais n’ayant rien à voir avec le film précité) et une efficacité redoutable. Nous avons rencontré ces deux nouveaux as du casse graphique !
(Photos de une signées Aline Fournier et Gaëtan Chekaiban)

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard
Bonjour Alain, bonjour François. Après Caïds, avant Tueurs, vous signez Forbans. Les méthodes de tout ce petit monde sont parfois expéditives, comme vos titres !
François : C’est vrai que je ne m’en étais pas rendu compte mais un seul mot suffit. Cela dit, au départ, mon titre était plus long. Le mot Forban était déjà présent et il est resté, je suis un fan de Surcouf. Je trouve qu’un mot en plus, ça fragilise les choses.
Alain, vous êtes Suisse, François, vous êtes Belge, comment vous êtes-vous rencontré ?
François : Mon histoire avait d’abord été signée chez Dupuis. Alain était en attente d’un projet chez Le Lombard où il avait été repéré par un éditeur mais ses essais n’avaient pas convaincu Dupuis, sans doute plus commercial et pas forcément enclin à voir une histoire en noir et blanc, très artistique et tenant finalement plus du storyboard. C’était plus dans la démarche du Lombard qui a récupéré le projet, étant dans le même groupe que Dupuis. Il suffisait de monter un étage.
Alain : Je suis très versatile dans mes styles. Je fais de l’illustration, de la peinture, je ne me mets aucune barrière mais je ne veux pas gratter à toutes les portes pour trouver un projet.
Cela dit, ce projet-ci est plutôt bien tombé. Je suis un grand fan des univers de gangsters, c’était du pain béni renforcé par le côté poétique donné par François.
Alors, du coup, on ne s’étonnera pas de retrouver Lino Ventura dans les traits d’un de vos personnages !
Alain : Je ne peux pas le cacher, c’est une de mes inspirations.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard
Vous, François, on vous voit à l’école du crime, d’abord dans les lectures de certains gangsters qui vous ont précédé. Qui étaient-ils ?
François : François Besse qui a écrit « Je suis un bandit d’honneur ». J’étais fasciné par ce type de personnage, plus discret que Mesrine, qui dénonçait la violence. Je voyais en lui le côté « bandit social », d’extrême gauche. Puis, je lisais les romans de Borniche. Au cinéma, c’était Melville, Sautet. Les Simenon, aussi.
Vous écrivez mais vous dessinez aussi ! Vous avez pensé à faire vous-même la partie graphique de cet album ?
François : Je suis plus un homme de plume, porté par l’amour des mots, je n’ai pas le talent d’Alain. J’ai énormément lu. J’ai grandi dans une famille qui avait enlevé la télévision. Quand j’étais petit, je noircissais des carnets. J’avais 10-12 ans quand j’ai écrit mon premier roman. J’ai fait un écart, pour rentrer dans la peau du hors-la-loi. Ce monde me fascinait et je devais trouver une justification à faire ça. J’ai choisi l’exclusion volontaire, j’ai traversé le miroir pour toucher du doigt cette réalité qui faisait peur à d’autres.
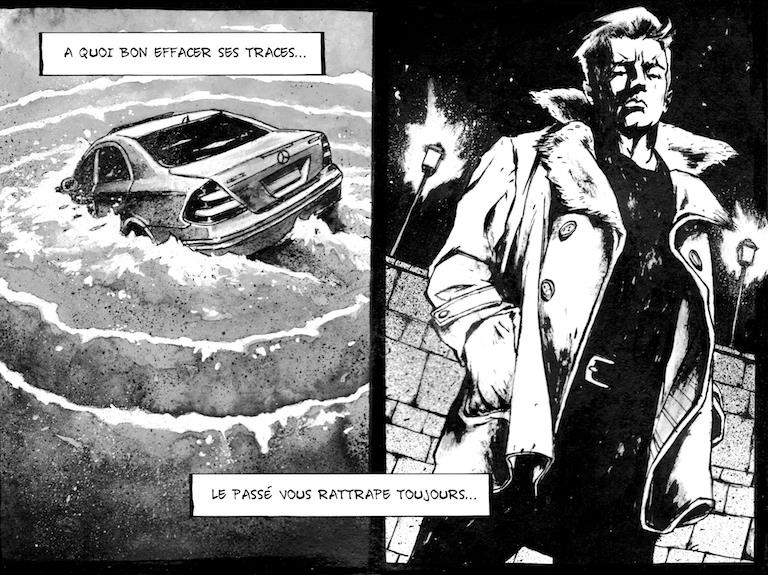
© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard
Quelle était votre conception du hors-la-loi ?
François : Comme un corsaire, on y revient, qui peut attaquer qui il veut, ces salauds d’Anglais qui pillent sans vergogne. À la réflexion, je me suis rendu compte que j’étais dans le faux, je suis revenu à la vie. C’est très difficile de vivre et rattraper ses fantasmes. C’était l’aventure pour la liberté. Se faire tuer ou tuer. Mais moi, je ne voulais pas tuer, c’était la limite à ne pas franchir.
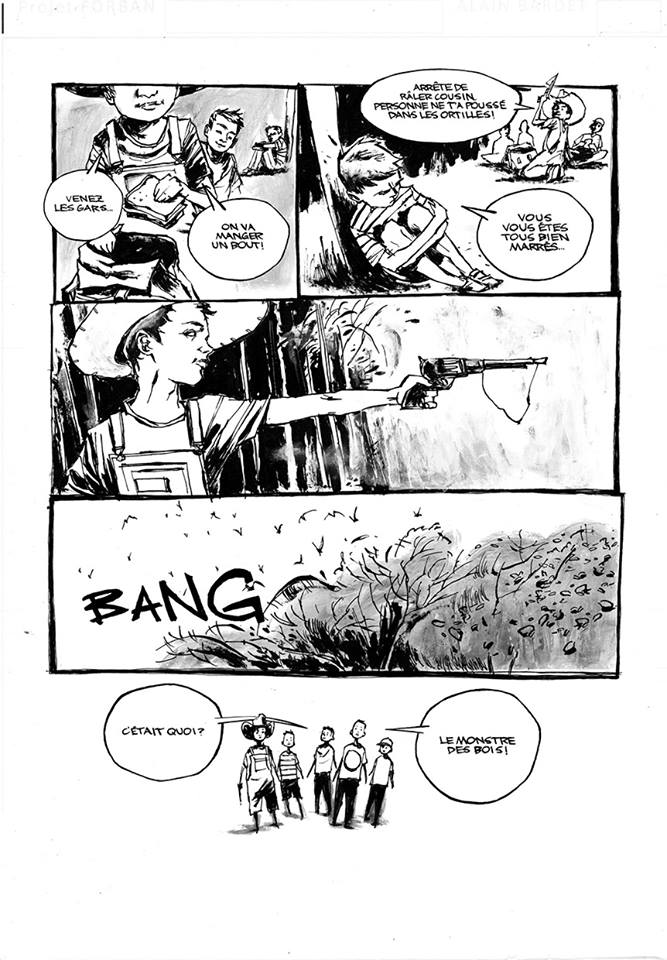
© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard
Pourtant, il est bien dur de ne pas la franchir !
François : C’est une utopie. À partir du moment où on glisse une balle dans un pistolet, c’est pour tuer ! Quand on met un couteau en poche. Ne dit-on prendre les armes ? Inconsciemment, je devais avoir accepté ça même si je m’y refusais. Oui, il y avait ce risque de tuer un innocent. La belle image du bandit d’honneur, ce n’était que de la théorie. Et quand bien même, les gens qui se font braquer n’ont pas conscience que vous ne voulez pas les tuer. Mais la violence extrême a une force de fascination. Le panache de Lino Ventura, De Niro dans Heat qui est limite plus droit que le policier campé par Al Pacino. Il ne boit pas, il est dans la gestion, a des règles morales. C’est ça aussi être un voyou. Ce sont des gens qui s’octroient des droits et beaucoup n’aiment pas ça.
Alain : Le code d’honneur qu’on prête à Franck dans l’album, il était primordial de le respecter. Il y a un travail instinctif en amont. Des discussions se sont mises en place. Mais la liberté était importante. Je pouvais créer ce que je voulais.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard
François : En fait, les gens transgressent la loi depuis la nuit des temps. Lisez Homère. Forban, c’est une tranche de vie, un reflet dans la glace, un échantillon pour analyser la vie à un moment bien précis. Le polar, c’est ça, un moyen de raconter de l’intérieur une vie qui va changer, des gens transpercés par ce qu’il va se passer.
Cette BD, elle est très cinématographique d’ailleurs, non ?
François : Alain joue et rend tout ça très vivant.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard
Avec une voix off omniprésente.
François : Elle était importante, et Alain a bien joué le coup pour que cette voix ne raconte pas l’image, que l’image raconte autre chose. Ce qu’on voit n’est pas ce qu’on lit. Alain a aussi transmis un côté nerveux, il casse le code mais use d’une perspective parfaite, il brise les angles mais rend tout ça rond. Cette voix off, elle était nécessaire pour comprendre le personnage qui a tout pour réussir mais décide de s’exclure de manière volontaire. La voix off, c’est un processus très littéraire, chez Hugo, Céline, Eden ou Gray. Mais elle est aussi très utile au polar qui est très silencieux, elle permet de raconter une poésie hors du dessin.
Finalement, Forban n’est pas une autobiographie mais il y a pas mal de vous quand même. Et si on jouait aux jeux des différences.
François : Si j’ai des capacités artistiques, je ne suis pas musicien, la trompette (ndlr. qui donne l’une des plus belles séquences de cet album, soit dit en passant). Mais j’ai failli faire le conservatoire ! Mais j’ai voulu me distancier, Franck ne me ressemble absolument pas, il véhicule une certaine tristesse Et Alain a bien réussi à alterner des planches plus tristes et d’autres plus joyeuses. Après, la fiction est plus intéressante pour raconter le grand banditisme.
Qui est ?
François : Ce n’est pas la banlieue, ça n’a rien à voir avec les Kaïra. C’est un panache qui alterne les personnages, qu’ils soient Delon ou Ventura. C’est aussi un carnet d’adresses, comme ceux de Francis le Belge ou Marcel Habran qui était coutumier de rencontres avec des grands de ce monde.
Avec ce paradoxe qui embarque l’album dans une autre dimension : et si on nous avait laissés commettre nos braquages ? Notamment pour abolir le cash et amener tout le monde à utiliser sa carte de crédit. Et c’est, plus loin, l’obsession de votre film aussi !
François : À l’époque, il devait y avoir une attaque par semaine. Et oui forcément, on se dit quand les coups sont trop faciles, que la police n’a peut-être pas tout tenté pour nous arrêter, que cela arrangeait bien certain. Et si on nous avait laissé quelques libertés pour créer un climat anxiogène et détourné les gens du cash pour privilégier le cash. Cela ne pouvait-il pas être du racket organisé par les cartels ?
Après, encore aujourd’hui, la camaraderie et l’injustice sont potes. Regardez Nethys, ceux qui ont accepté de se taire en touchant du fric au conseil d’administration ou ailleurs.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard
Venons-en à Franck, alors, s’il n’est pas exactement comme vous ?
François : C’est un peu un fantasme imaginaire, un Robin des bois. Il a envie d’une répartition plus juste, de dénoncer certaines pratiques. Il rêve de transparence.
Et finalement, après sa vie de bandit, il va à nouveau passer de l’autre côté du miroir.
François : Je déteste le mot « repenti », la « réinsertion ». À cela, je préfère la réconciliation. Aujourd’hui, je veux devenir acteur, par ma plume, poser des actes, amener le débat par mon expérience et éveiller les consciences.
Avec Tueurs, je montre le processus qui mène à la création d’un ennemi public. Et les journalistes n’y sont pas étrangers. C’est une réflexion sur l’instrumentalisation.
Alain, vous avez réagi comment quand vous vous êtes dit que vous alliez rencontrer un bandit et peut-être même collaborer avec lui ?
Alain : François m’a tout de suite mis à l’aise. Pourquoi le passif poserait-il problème. Ce n’était pas un gangster que je rencontrais mais un homme de valeurs, de beaucoup de valeurs.
Quelles sont vos influences, finalement ?
Alain : La BD franco-belge mais surtout la BD en anglais, les comics de Sienkiewicz, McKean, Kent Williams. J’aime avoir une grande liberté de mouvement, passer de la planche à la peinture.
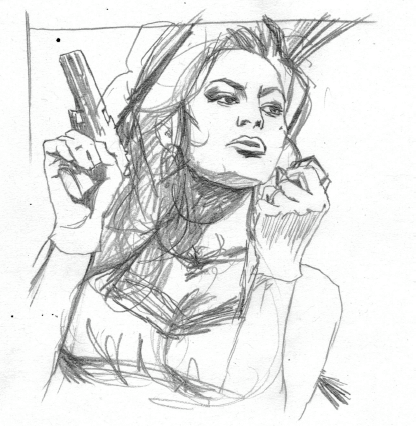
© Alain Bardet
François : Alain s’est élevé à briser son style. Forban, c’était une carte blanche. J’ai évolué après l’avoir rencontré, j’ai scénarisé en fonction de son dessin, avec un découpage plus à l’aise : j’avais trouvé un super-chef op’ ! Ça a pris du temps, le dessinateur était suisse (ils rient) mais on a fait ce qu’on voulait. Pas pour être médiatique, ce n’est d’ailleurs pas le genre de format qui marche le mieux, mais pour porter au mieux l’histoire, avec des traits poétiques.
En 2013 et 2014, j’ai dû retourner en prison, (ndlr. en vue de ses projets, il avait côtoyé d’anciens détenus, comme Joey Starr, ce qui était interdit parmi les conditions de sa libération). L’éditeur venait me voir, je lui passais mon scénario pour Alain. J’ai retravaillé la scène de prison depuis ma cellule, d’ailleurs. Alain, il joue le personnage, il lui rend la vie et crée son univers tout en l’harmonisant avec le texte.
Alain : Entre 2012 et 2017, j’ai trouvé mon style, j’ai fini par le prendre comme il était. Les dernières planches sont plus vives.
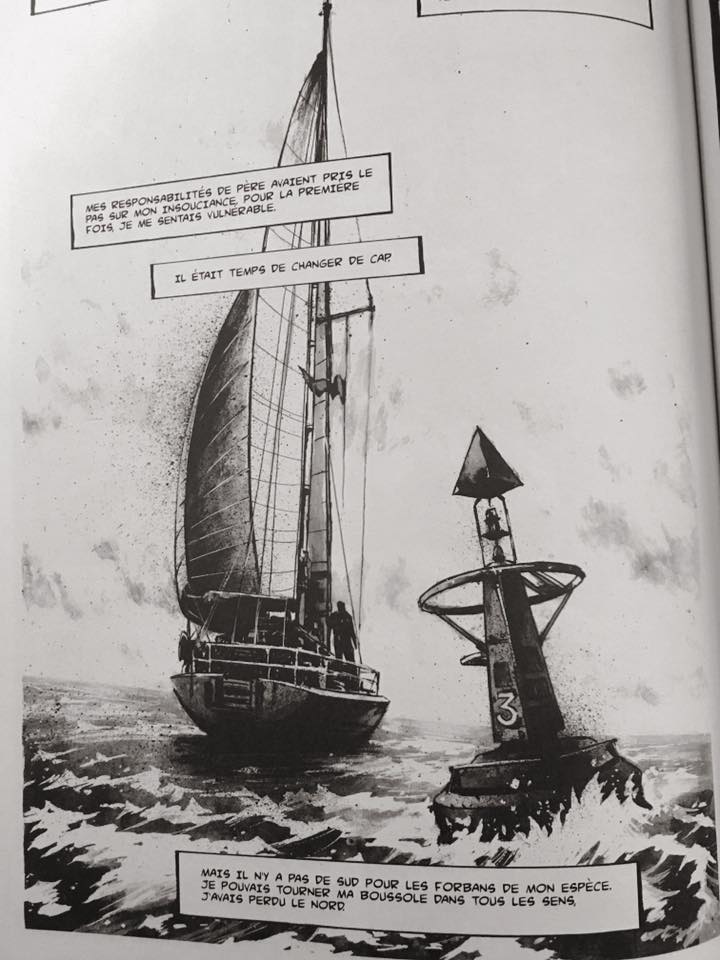
© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard
Et la suite ?
François : On a envie d’y retourner ! Peut-être avec des couleurs. Mais aucune envie d’être élitiste. J’écris beaucoup plus naturellement. Un mot ou rien peuvent suffire. Il ne faut pas écrire pour dire : « hey, regardez, j’existe ». Non, il faut servir l’oeuvre.
Travailler avec Olivier Gourmet sur Tueurs a également été une expérience très riche. Face aux pages de dialogues prévues, il a pris son stylo et a commencé à élaguer. « Ça, je ne dis pas ». J’étais en stress, je le voyais réduire son texte à peau de chagrin. Je me disais : « Ah merde, il enlève tout ça! » Mais il faut arriver à s’effacer. D’autant plus qu’au final, il avait raison ! Au montage, je suis même permis de couper certains passages pour ne garder parfois qu’un regard, raconter le dialogue dans l’oeil ou la gestuelle. C’est génial si un dialogue peut exister dans le silence. On se raconte plein de choses, on s’invente sans besoin de 10 lignes chiantes et non-nécessaire.
L’affiche du film de François Troukens et Jean-François Hensgens dessinée par Alain Bardet
Et vous Alain, vous faites l’acteur ?
Alain : En tout as, je me joue les scènes afin de choisir les angles les plus judicieux, j’utilise des références, des photos.
François : Il n’est venu qu’une fois à Bruxelles et ça ne se voit pas. Comme pour dessiner le trompettiste, l’embouchure. Alain, il est chef-op et comédien à la fois, ce qu’il fait c’est du spectacle vivant.
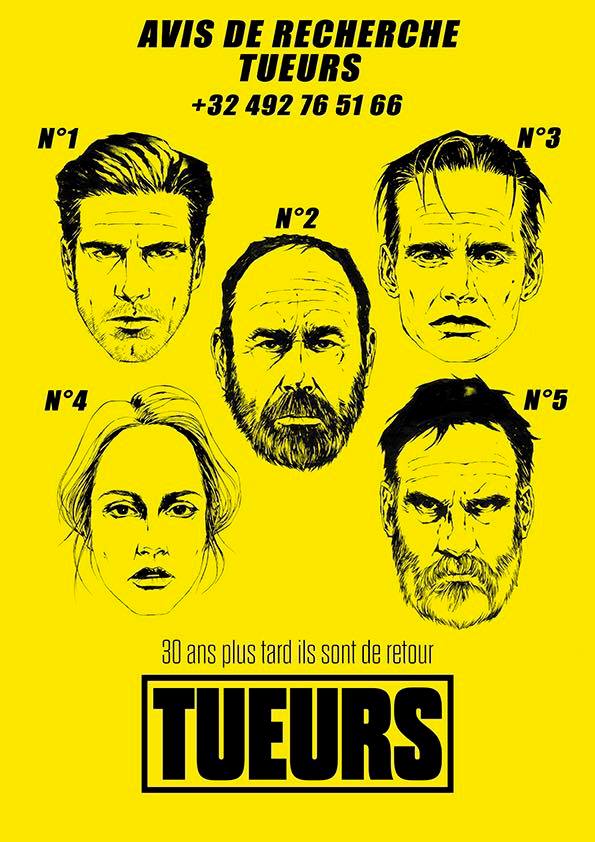
© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard
Le spectacle, il a été plus fort que le braquage ?
François : Je suis fasciné par le spectacle. J’ai trempé dans un univers tellement noir : l’artistique, c’est magique. Je n’ai pas eu une expérience de vie qui le favorise. Le monde des arts, pour moi, c’est le haut de la pyramide. Et ce n’est pas évident d’y trouver sa place, il n’y a qu’un seul Hugo, qu’un seul Mozart. Finalement, comme la famille, l’art a été le plus fort pour matérialiser ce que j’avais volé.
Au fond, je rêve d’avoir une petite ferme, deux-trois vignes, un cerisier… une chambre de bonne à Paris pour profiter des spectacles. Une vie simple. En fait, l’argent ne rend jamais heureux. Je préfère l’associatif qui est concret et nourrit la vie. Après, je n’ai pas envie d’utiliser le grand banditisme pour faire de l’argent médiatique.

© François Troukens/Alain Bardet chez Le Lombard
Toujours ce goût pour la provoc et dénoncer ce qui ne va pas, donc ?
François : Quand on a eu le premier financement pour le film, avec une pointe d’humour cynique, j’avais cliqué qu’on avait réussi le casse du siècle. Bon, certains ont dit que j’aurais dû m’abstenir. Mais la vérité était là : c’était mon plus beau butin.
Et on vous en souhaite beaucoup des butins comme celui-là ! Merci à tous les deux et bonne continuation.
Propos recueillis par Alexis Seny
Titre : Forban
Récit complet
Scénario : François Troukens
Dessin : Alain Bardet
Noir et blanc
Genre : Polar, Thriller
Éditeur : Le Lombard
Nbre de pages : 112
Prix : 17,95€

Il y a des heureuses coïncidences. Ce jour-là en amenait une sacrée et plaisante. Alors que je devais les rencontrer quatre heures plus tard à Bruxelles, c’est sur le quai de la gare de Gembloux que j’ai rencontré Christophe Cazenove et Jean Bastide. Leur accent du sud réchauffait l’atmosphère d’un hiver en avance et les deux comparses venaient de mettre plein d’étoiles dans les yeux d’élèves d’une classe de primaire. Des étoiles comme sans doute ils en ont eux quand on leur a proposé de présider au destin de deux fameux héros bientôt sexagénaires. Pourtant le temps n’a filé aucune ride à Boule et Bill. Ils sont intemporels et, prenant le temps d’un voyage en train, nous en avons longuement discuté.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud
Bonjour à tous les deux. Si je comprends bien, vous sortez tout juste d’une classe primaire de Gembloux.
Christophe : C’était bien et sympa, les enfants étaient vraiment mignons.
Jean : Un super esprit.
Christophe : On a expliqué comment on travaillait, ils ont pu poser leurs questions. Des questions mignonnes d’enfants, d’autres plus axées sur le travail des auteurs en lui-même. Sur le dessin. Des questions assez pertinentes sur comment Jean fait, comment on apprend à dessiner.

© Cazenove/Bastide
Tous connaissaient Boule et Bill ?
Jean : Oui, ils étaient assez concernés et impliqués.
Christophe : Sous la menace, ils ont du s’y mettre (il rit). On est rentré dans la classe, tous les albums étaient mis sur le pupitre, c’était très touchant.
Jean : C’est marrant de voir une série comme Boule et Bill transcender les générations. Ça fait des années, des décennies que ça dure et ce n’est pas près de s’arrêter. Tant mieux. Il y en a un qui nous a demandé si on nous reconnaissait dans la rue. C’était mignon mais… comment dire… non !
Christophe : Je devrais peut-être m’habiller avec une salopette bleue, remarque !
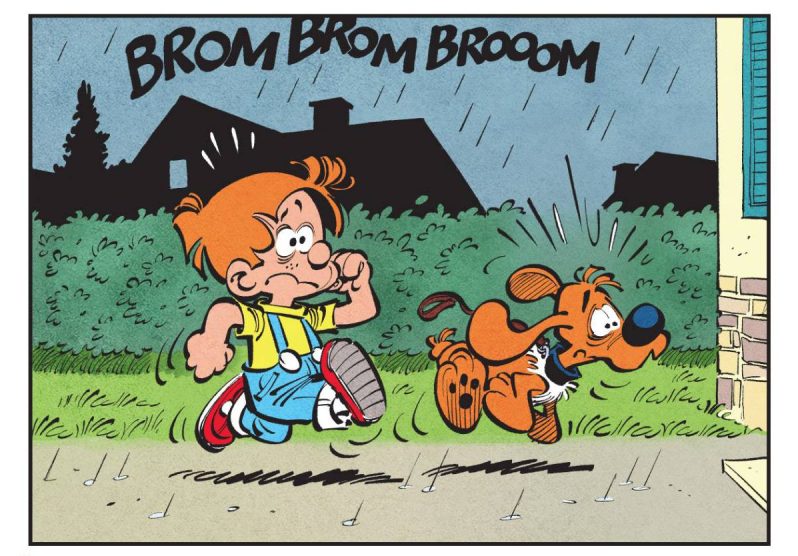
© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud
Justement, c’est votre deuxième album en compagnie de ces deux héros mythiques. Mais comment vous sont-ils arrivés dans les mains ?
Jean : Grâce à Pauline Mermet, directrice de collection chez Dargaud et notamment de la série Boule et Bill. Elle a contacté Christophe, d’abord.
Christophe : Elle avait apprécié une autre de mes séries et avait un univers à me proposer. On s’est donné rendez-vous à Angoulême en 2015. J’ai été la voir en sachant pertinemment que je refuserais ce qu’elle me proposerait. Je me sentais bien chez mon éditeur et n’étais pas tenté d’aller faire une création ailleurs. Mais je ne m’attendais pas du tout à cette proposition. J’ai dit oui tout de suite. Une semaine après, j’envoyais dix découpages pour voir si ce que je proposais pouvait convenir. Et on a ensuite cherché un dessinateur.

© Cazenove/Bastide
Après quelques essais avec des dessinateurs humour que je connaissais, Pauline a eu le flair de se tourner vers Jean qui n’était pas du tout dans cet univers.
Jean : Apparemment, Philippe Ostermann avait également pensé à moi. Encore aujourd’hui, vu tout ce que j’avais fait auparavant, je me demande comment ça a bien pu leur venir à l’esprit.
Christophe : Je lui avais demandé et elle m’avait répondu que par rapport à tes précédents albums, tu avais la capacité à changer de style. De mon côté, ce que j’ai pu remarquer avec les dessinateurs humoristiques que je connais, c’est qu’ils ont un dessin très propre. Philippe Larbier, s’il fait Boule et Bill, ils auront l’air crétin; avec William, des Sisters, Bill aurait l’air trop sérieux. Un dessinateur humoristique a toujours un style très personnel. Le dessin humour oblige à caractériser très fort.
Jean : J’ai du reprendre d’une page blanche, j’ai du réapprendre. C’est plus facile, je pense, qu’un dessinateur humoristique qui a déjà ses propres codes. Ainsi, j’ai pu m’approcher du trait de Roba, ce qui était la volonté de Madame Roba, assez vindicative à ce propos. Comme l’a fait Laurent Verron qui était très proche au début avant de se distancier un peu. C’est le cahier des charges.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud
Mais n’est-ce pas un peu frustrant ?
Jean : En fait, non. Je le prends comme un exercice. C’est formidable d’avoir un tel maître pour t’apprendre à dessiner. Il est décédé, malheureusement, mais j’ai eu la chance d’avoir accès à toute sa production, avec des scans d’excellente définition. J’arrive ainsi à comprendre comment il s’y prenait, comment il tenait sa plume, son attaque. Ça me fait énormément progresser. C’est une opportunité, en plus je suis payé pour progresser. (rire)
C’est ce qu’on voit avec Astérix repris par Conrad, on sent avec son troisième album qu’il se dégage de l' »emprise graphique » d’Uderzo. Ça pourrait vous arriver ?
Jean : C’est particulier, Uderzo est encore vivant et ça doit être très compliqué de reprendre un monument sous l’oeil de son auteur.
Christophe : Et le naturel peut revenir au galop. On peut se forcer à le chasser sur un album puis…
Jean : Chaque fois que je fais une page, j’ai toujours quelques planches de Roba à côté pour éduquer mon oeil. Pour être sur une espèce de rail. Parce qu’on peut très vite dévier. On a tous des tics graphiques. Il faut s’obliger à rester dans la ligne, c’est le jeu, ça fait partie des efforts à fournir. Après, si j’ai la chance d’en faire dix, ça évoluera peut-être.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud
Mais j’y trouve mon compte dans cet exercice. L’analyse scrupuleuse du trait, c’est intéressant. Je n’ai aucun problème.
En disant oui tout de suite ?
Jean : Ah, oui… enfin pour l’essai. Rien ne disait que j’allais le réussir. Christophe, toi, tu as été engagé direct ?
Christophe : Quand j’ai dit oui à Angoulême, je voulais très vite envoyé mes découpages, ne pas leur faire perdre de temps. Après, Pauline m’a dit oui assez rapidement. Mais, on n’a pas le même rapport avec cette série. Moi, je la lis depuis que je suis gamin. C’est un rêve, c’est spéc’ et curieux de se retrouver derrière les personnages avec lesquels j’ai grandi.

© Jean Bastide
Jean : Tandis que moi, ce n’est pas ma culture. Je ne suis pas issu de cette BD-là. Si je connaissais Boule et Bill, je ne suis pas sûr d’en avoir lu quand j’étais gamin. Ou très peu. Moi, j’étais plutôt dans le manga, rien à voir. Et ce que j’ai fait après, ça n’avait rien à voir non plus avec Dragon Ball.
Après, je fais partie d’une génération de dessinateurs qui a tout de suite dû être performante. On ne peut pas tout apprendre en un coup. Nous devions être d’abord des techniciens avant d’être des créateurs d’univers, d’histoires. Du coup, sur le tard, on développe sa propre patte. Alors que les Franquin et les autres avaient des magazines sur lesquels compter et des dizaines d’années pour façonner leur style, sans l’obligation d’arriver à faire un truc qui tuait tout de suite. Étant donné le nombre que nous sommes aujourd’hui, ça égraine, il n’y a que les meilleurs qui sont pris. Tout est trop axé sur l’aspect technique et ça a tendance à asservir le contenu. Des albums sont souvent bien dessinés sans pour autant incarner et raconter quelque chose. Nous sommes des dessinateurs-caméléon.
Christophe : Pour moi, il y a eu deux bonnes surprises. Boule et Bill, d’abord. Puis le suivi de l’éditeur. Comme je changeais d’éditeur pour cette série, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je pensais que comme nous étions dans le domaine du patrimoine, tout serait très directif. J’ai eu mon petit cahier des charges, Pauline m’a demandé d’axer les gags sur les parents-Bill-Boule-Pouf-Noisette-Caroline… et c’est exactement ce qui me plaisait. À part ça, on montre les pages, on a des retours, tout se passe agréablement bien.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud
Paul : C’est un métier dans lequel le facteur humain importe beaucoup. On serait tombé sur une autre personne, ça ne se serait peut-être pas passé ainsi.
Christophe : Je connais des personnes qui ont fait des reprises, qui sont partis dans une belle aventure pour qu’au final, ça se passe mal. À tel point que ça devient difficile pour l’auteur de travailler sur quelque chose que… pourtant il aime.
Justement, par rapport au cahier des charges, pas envie d’ajouter des portraits à la galerie ?
Christophe : Non, juste une jeune fille. J’essaie vraiment de rester sur le noyau dur tant que nous n’avons pas besoin de faire venir de nouveaux personnages. Le prochain album sera plus axé sur les chiens. Il y en a beaucoup dans les albums de Roba. Ce sera le thème, amener pas mal de copains chiens. J’adorais ça quand j’étais gamin, ces planches où Bill magouille pour filer des os ou des morceaux de jambons à ses amis. On va essayer de retrouver cet esprit. Il y a pire quand même comme travail que de chercher des gags dans lesquels des animaux font des bêtises.
Et comme Bill réfléchit, comment se met-on dans la tête d’un chien ?
Christophe : Je me sers beaucoup de mon chien, un corniaud qui a du caractère mais pas de race. Comme la première planche de ce tome 37, elle est à l’image de ce que la plupart des chiens font. Je m’allonge sur le canapé, il se met sur moi. Comme je n’arrive pas à lire, je le chasse. Du coup, il se met sur mes pieds, il est collant. Dans mes deux tomes de Boule et Bill, pas mal de choses sont des choses vécues avec mon chien. Toujours dans le tome 37, lors d’une promenade, Bill s’arrête. Impossible de le faire avancer. En fait, il a une petite épine dans la patte. Et c’est quelque chose que mon chien fait souvent. Je dois m’arrêter et soulever ses pattes l’une après l’autre. Souvent, ce n’est rien, ce n’est même pas douloureux mais ça le gêne.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud
Et vous, Jean, vous avez un chien ?
Jean : Non… et je pense que je n’en aurai pas car j’ai déjà deux enfants, c’est du taf (il rit). Je n’ai jamais eu beaucoup d’animaux à la maison. Je n’ai pas la fibre comme Christophe. C’est vrai que ça aurait pu m’aider pour dessiner, pour les postures.
Christophe : Mais tu as tes enfants pour dessiner Boule !
Est-ce plus facile d’animer les humains ou les chiens ?
Jean : Au fil des mes albums, j’ai eu la possibilité de dessiner beaucoup d’humains. Les animaux, je les découvre, c’est un dessin très humoristique, hyper-agréable à faire. Il n’y a pas d’obligation de respecter les proportions. Dans le cadre de l’humour, c’est différent, on peut délirer mais pour dessiner des humains, on doit toujours faire par rapport à ce qu’on connait.
Christophe : Et ils sont super-marrants, ses chiens, il les tient bien !

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud
Puis, il y a les oiseaux bleus, Caporal le chat de la voisine…
Christophe : Lui, j’avais presque fini mon tome 1 quand la directrice de collection m’a dit que ce serait bien de faire intervenir Mme Stick et son chat Caporal. Je les avais zappé. Elle m’énervait quand je lisais Boule et Bill, elle était sévère, antipathique, militaire. Et quand j’ai écrit ce premier gag avec elle, je suis reparti dans le passé, je me suis revu petit lecteur de Boule et Bill en train de détester Mme Stick. Pauline m’a aussi demandé de faire un gag juste d’amitié, sans besoin de suite drôle, juste de l’affection. Luce Roba m’a aussi demandé de me rapprocher du parler de Boule et Bill, période Roba. Je me suis demandé comme j’allais faire, j’ai feuilleté les anciens tomes. Je suis à l’écoute des demandes et des conseils de Jean pour orienter mes gags et que ça nous plaise à tous les deux.
Jean : Au fur et à mesure, je relis les albums. Et cette mécanique du gag, Christophe l’a bien comprise. C’est naturel. C’est fluide, sans différence dans la façon de raconter.
Christophe : Après, je ne fais que du jeunesse, ça aide…
Jean : À tel point que ses scénarios, je les reprends tel quels, j’ai besoin de ne rien changer. Ça facilite la vie.
Christophe : Et s’il y a des trucs à changer, ce n’est pas grave, c’est le principe d’une collaboration. Avant Boule et Bill, on ne se connaissait pas, on s’entend bien. Je n’arrive pas à travailler avec quelqu’un avec qui il n’y a pas de contact. Se faire des retours mutuels, c’est la meilleure façon d’avancer. Puis, je demande toujours à Jean les thèmes qui pourraient lui plaire. Comme la pétanque dans notre premier tome, la musique dans le tome 38. Il y avait tellement peu de chance que le boudègue, ce drôle d’instrument qui ressemble à une cornemuse se retrouve sur une couverture de Boule et Bill.
Jean : C’est insensé.
Christophe : Il m’a présenté un de ses amis à Angoulême. Pour une raison qui m’échappe aujourd’hui, il nous a parlé du boudègue, avec sa consonance provençale, et ça a fini en couverture.
Jean : Un concours de circonstance.
Christophe : Il doit exister plus de mille gags de Boule et Bill et, malgré tout, il faut trouver des histoires inexploitées. Le meilleur moyen d’y arriver, c’est de se servir de nos expériences, de regarder autour de nous. Le pire serait de faire un gag déjà fait par Roba. Je les connais tous mais je n’ai pas des pare-feux pour chaque page. Il faut mettre à notre sauce sans que le but soit que ça nous ressemble à nous mais à du Boule et Bill. Mais si on peut renouveler les gags avec des choses qui nous sont personnelles, tant mieux, on le fait.
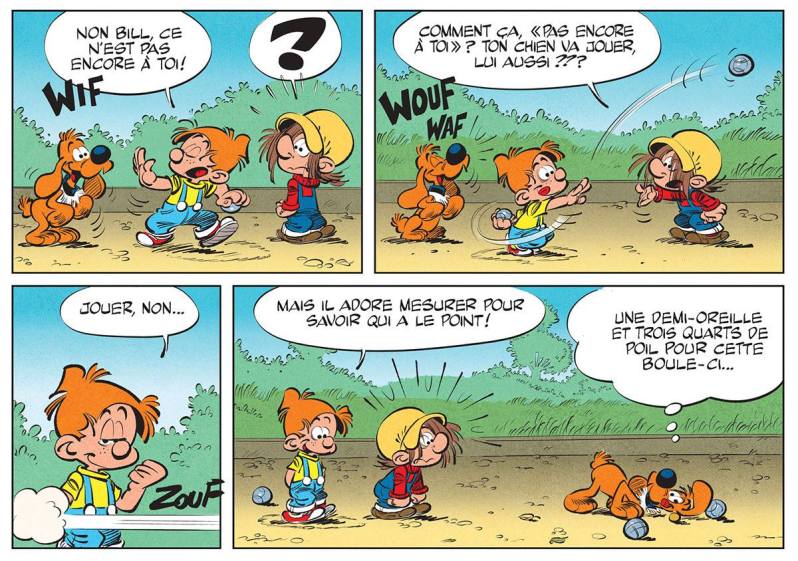
© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud
Et pas de barrière entre les personnages, pas de gsm, pas de console…
Christophe : On en avait parlé avec Pauline et on était d’accord. La maman de Boule a une tablette mais pour le reste je ne trouve pas qu’il serait opportun de montrer Boule sur sa console. Ce qui est important dans cette série, c’est la relation entre Boule et Bill, celle qui donne son titre à la série. Et quand on a une relation avec son chien, pas besoin de tablette mais d’une balle. Un principe très simple.
Jean : On évite les marqueurs temporels très forts. Il y a très peu d’intervention avec la technologie, le téléphone, c’est pas plus mal et ça rejoint le fait qu’il y a plein de choses qui ne sont pas dites dans Boule et Bill. On ne sait rien d’eux, pas même leurs prénoms. Ce n’est pas le propos, le propos, c’est cette relation enfant-chien et les personnes qui gravitent.
Christophe : Ce ne serai pas intéressant de dire qu’ils sont dans telle ville. Le papa de Boule, je crois me souvenir qu’il est dans la publicité. La maman, on ne sait pas. Mais c’est vrai qu’elle, j’essaie de ne pas en faire une maman au foyer. Ce qui n’a rien de péjoratif mais j’essaie d’être plus dans l’air du temps.

© Christophe Cazenove/Jean Bastide
Jean : Moderniser l’image de la femme. Parce que c’est vrai que dans les années 50, c’était très différent, la ménagère et tout cet imaginaire.
Christophe : Dans le nouveau tome, on voit la maman sur sa tablette et le papa qui fait la vaisselle. Ce n’est qu’un détail mais c’est par des détails qu’on y arrive.
Jean : Les habits aussi, on a un peu renouvelé sa garde-robe.
Christophe : Il ne faut pas qu’elle n’ait qu’un rôle décoratif, mais qu’elle ait sa personnalité et que le couple soit moderne. Qu’il y ait des impulsions.
Puis, pas besoin de Wikipédia, il y a des encyclopédies puis le savoir Do-it-yourself (pas forcément concluant) du papa.
Christophe : Le plus important, c’est Boule et son cocker mais il y a de la place pour les autres, pour des interactions. J’aime bien montrer le côté gaffeur du papa mais aussi sa volonté d’apprendre des choses à son fils. Je l’ai toujours vu moins comme un gaffeur que comme un papa très gentil. Avec un gag que j’avais beaucoup aimé, notamment : le jour de son anniversaire, Boule va au grenier et en ramène une antique tenue de son grand-père. Entre-temps, la maman dit au papa : « quoi que ce soit, tu acceptes. » Et avec ce vieux costumes, il part au travail. C’est formidable, c’est un papa en or et généreux.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud
Jean : Aimant.
Christophe : … et qui subit les facéties de Bill.
Jean, si je comprends bien, vous vous étiez tenu éloigné de Boule et Bill. Par quoi avez-vous commencé ?
Jean : La première page d’essai, je l’ai faite avec mes vagues souvenirs. Je n’avais pas d’album sous la main. Ma première page n’était pas folichonne. Mais j’avais le mérite, comme Christophe, d’avoir été assez réactif, dans les quelques jours qui ont suivi. Du coup, Pauline a du se dire que j’étais motivé.
L’important dans ce genre de trait, ce sont tous les petits détails, la façon de faire. Ce que je n’avais pas. J’ai du potasser, apprendre la mécanique. En fait, chez Roba, chaque élément est à sa place, a une forme particulière, tout est codé, même les brins d’herbe, il y a une façon de les faire. C’est dingue. Du coup, j’ai commencé avec les scans qu’on m’a envoyé. J’ai voulu faire en traditionnel sur papier comme lui mais je n’en ai jamais été capable. Il me fallait une vivacité de trait, une technicité au niveau de la plume dont j’étais incapable. Ça m’aurait pris des années. Je suis revenu à l’ordi, j’ai pris les scans de Roba en très haute définition et je me suis fabriqué une palette s’approchant le plus de la plume et ses effets. Ça s’appelle Plume Roba, d’ailleurs.
Je me suis aussi acheté un stylet spécial qui reproduit la rotation là où les stylets Wacom ne réagissent qu’à l’inclinaison et à la pression. Avec ce stylet, je pouvais reproduire exactement la même gestuelle. Du coup, avec ces outils, je pouvais me rapprocher de Roba. J’avais le matériel, si je n’y arrivais pas, c’est que j’étais mauvais. Je me suis donc entraîné. Sur le tome 37, j’ai du batailler, il y a des planches foireuses que j’ai du redessiner.
Christophe : C’est bien aussi, un dessinateur qui n’a pas peur de revenir sur son dessin.
Jean : Il faut être humble, aussi.
Christophe : Mais ce n’est pas le cas de tous.
Jean : Quand ça ne le fait pas, il faut. Je ne permets pas de servir quelque chose qui serait à moitié bien. Et encore, il y a certaines planches du 37 que je suis incapable de regarder. Le 38, ça me convient déjà mieux. Il est plus homogène, plus maîtrisé. Petit à petit. Mais on sent que je suis assez jeune dans ce style de graphisme. C’est une attention de tous les instants à avoir. J’ai toujours deux-trois planches de Roba à côté. La façon de faire des hachures, les grilles optique, c’est bête mais si tu tiens ton stylet d’une certaine façon, tu ne feras pas la même hachure que Roba. Ce ne sera pas assez fin, trop espacé. C’est bête mais c’est toute une série de détails qui participent à un vocabulaire, une écriture. Ça participe à la ressemblance. Sinon autant prendre un bête stylo. C’est pour ça que j’adore faire ça.

© Bastide
Christophe : C’est vachement pointu l’analyse que tu fais là ! Moi, j’en suis incapable, je suis plus dans le ressenti.
Jean : Moi, si j’avais du faire ça au feeling, ça aurait été pourri. Puis, le dessin et le scénario, c’est différent. Avec le dessin, on ne peut pas tricher.
Christophe qui avale de travers : Ah bon…
Jean (cherchant à se tirer du mauvais pas) : Je ne dis pas que tu triches, hein (rires). Mais tu ne peux pas aller au bluff. C’est exigent, il faut être scrupuleux encore plus sur ce genre de licence. On ne peut pas tenter le diable, se dire qu’ils n’y verront que du feu. Il y a cette impression de facilité avec des scènes courantes… mais c’est bien plus dur que les BD’s réalistes que j’ai pu faire. On pourrait croire, pourtant. Mais non, je n’ai jamais galéré autant que sur ces deux bons vieux Boule et Bill. Tout le monde sait jouer de la flûte à bec mais qui sait bien en jouer ? Pas beaucoup.

© Cazenove/Bastide
La musique, justement, c’est votre apport. Mais comment représente-t-on la musique en BD, sans le son ?
Jean : C’est très compliqué, il y a les onomatopées, des petites notes de musique. J’ai regardé comment Roba faisait mais il y a très peu d’éléments musicaux dans sa série. C’est assez peu représenté. En général, ce sont des petites portées. Mais, là encore, je n’ai pas pris de liberté, j’ai calqué sa façon de faire sur à peu près tout. Ça me va très bien, il avait tout élaboré, tout est bien tenu, et je ne vois pas spécialement l’utilité de développer des choses. Peut-être que ça viendra mais le style de Roba est parfait. Les années 80-90, il était au sommet de son art, un virtuose. On parle énormément de Franquin et Morris, bizarrement assez peu d’Uderzo et de Roba, mais ils étaient des maîtres, géniaux.

© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud
En relisant les albums, vous êtes-vous aperçu que vous aviez manqué quelque chose ?
Jean : Ce n’est pas spécialement le type de lecture que j’adore mais il faut reconnaître que c’est ultra-plaisant à lire. C’est haut en couleur, léger. La Guerre des Sambre, pour le coup, c’était ultra-dépressif. On faisait ça dans une cave avec mon collègue, durant nos études en Belgique. Sans fenêtre, ni rien, vraiment dans l’atmosphère. Maintenant, j’ai de grandes fenêtres là où je travaille, c’est différent.
Finalement, comment expliquez-vous, tant au niveau du dessin que du scénario, que Roba et ses deux héros aient traversé les âges et qu’en 2017, ils soient toujours aussi présents ?
Christophe : C’est une famille : le papa, la maman, le chien, le gamin… euh pardon, le gamin et le chien. (il rit) Ça parle à tout le monde, c’est intemporel, sans date. Tout le monde est concerné et peut se repérer même si on n’est pas rouquin et qu’on n’a pas de chien. Au-delà du fait que le dessin de Roba est génial, très attractif. Là où j’ai des difficultés pour imaginer des gags, parce que c’est très quotidien, c’est cet aspect fantastique : tout ce que Bill est capable de faire avec ses oreilles. Quand Bill volait comme un avion grâce à ses oreilles. Ainsi, je lui fais faire le ventilateur.

© Cazenove/Bastide/Perdriset pour Spirou/Dupuis
Jean : Qu’est-ce qu’elles sont dures à animer les oreilles de Bill. Christophe me fait un crobard, tiens débrouille-toi. Je fais des croquis, c’était pourri, j’ai refait. Roba a tellement fait de Bill qu’il y a un moment donné où je me suis dit : « Ah je pourrais reprendre tel truc ». En fait, Roba avait déjà tout fait !
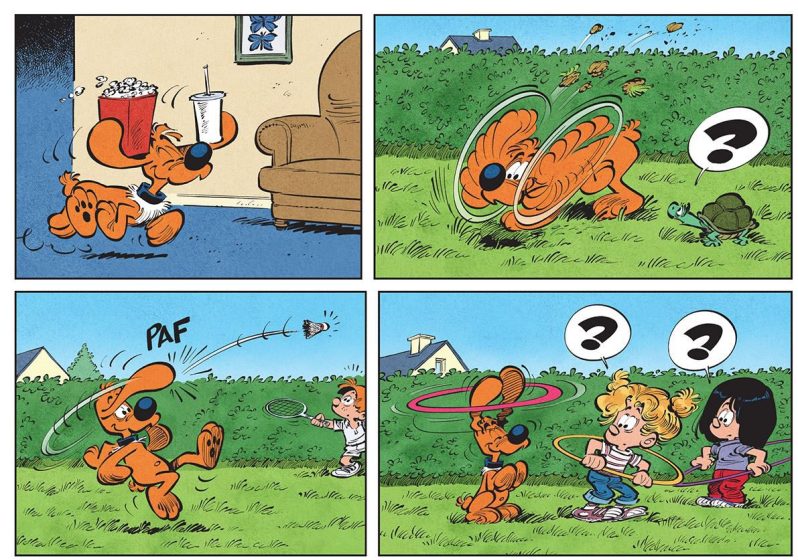
© Cazenove/Bastide/Perdriset chez Dargaud
Christophe : Au rayon « compliments », je ne me pose pas de question quand j’écris le scénario, je ne me demande pas si Jean ou un autre va y arriver ou pas. Je pars du principe que oui ! C’est un bon dessinateur. On connait les difficultés de ses dessinateurs, j’y fais attention.
Le découpage d’une planche de Christophe Cazenove
Qui dit Boule et Bill dit forcément dédicaces, quel est votre rapport à elles ?
Christophe : Moi, ça m’a changé mon public. Depuis que je travaille sur Boule et Bill, je n’ai plus seulement que des enfants mais aussi des gens plus âgés qui ont grandi avec ces deux héros, des mamies avec des cockers. Pas mal de personnes ont adopté un cocker grâce à Boule et Bill.
Beaucoup d’auteurs se plaignent aussi qu’une dédicace, aussitôt réalisée, se retrouve vendue avec intérêt sur Ebay et consorts. Et j’imagine qu’avec des héros pareils, on n’est pas à l’abri !
Jean : Intrinsèquement, avec des collectionneurs, ça peut valoir des sous. Le rapport à l’argent confère toujours un côté malsain. Et dès qu’une série devient populaire, il y aura toujours des gens pour tenter de s’en mettre plein les poches sur le dos des gens.
Christophe : Après, c’est quand même une série jeunesse, on a beaucoup d’enfants en festival et pas énormément de chasseurs. Moi, je fais des petits dessins mais ça ne s’est jamais vendu sur Ebay… je ne sais pas pourquoi !

Un découpage de Christophe Cazenove
Jean : Après, avant Boule et Bill, j’avais fait un tirage de luxe de Notre-Dame, mon adaptation de Notre-Dame de Paris, en grand format et couleurs. Ça coûtait assez cher. Un gars, super-sympa, était venu à BDFugue à Lyon, je m’en souviens très bien. On avait parlé, je m’étais appliqué avec mes aquarelles. Le lendemain, je vois l’album sur Ebay, deux fois plus cher que le prix vente. Et il est parti ! Quel salopard ! En soi, c’est pas illégal mais moralement, c’est pas top ni cool.
Christophe : Je comprends que le problème se pose, c’est dommage.
Jean : Une dédicace, c’est une discussion, un partage. Une signature. Ça n’a pas de valeur en soi, c’est le plaisir de rencontrer la personne. Il m’est déjà arrivé d’avoir en face de mon stand des gens avec quatre ou cinq bouquins sous le bras. « Je vous le laisse, je vais voir untel ». Et il s’étonnait de voir que je n’avais pas dédicacé son bouquin en revenant. Je ne le faisais pas. « Vous ne l’avez pas fait? » « Ben non, vous n’étiez pas là! » Le mec s’excitait presque sur moi. C’est fou. Et ce n’est pas arrivé qu’une fois.
Puis, il y a ceux qui prennent femme et enfant et dispatchent !
Jean : Ohlala, pitié… Ça m’est arrivé aussi.
Christophe : Il ne faut pas que ça fasse oublier tous les gens sincères et heureux qu’on croise. Parfois, j’ai l’impression que sur Facebook, on peut se laisser aller à beaucoup de véhémence. Quand je vais en festival, je me dis qu’on touche pas mal d’enfants et je ne voudrais pas laisser un mauvais souvenir à un gamin qui va être content de la rencontre. En plus, en BD jeunesse, on n’a pas de gens qui nous demandent des trucs tarabiscotés, pas de collectionneurs.
Jean : Eux, c’est différent. Faut dire qu’ils ne sont pas nombreux les collectionneurs. Ils sont peut-être une vingtaine qui ont des milliers de BD chez eux et passent leur vie à ça. Ce sont des fadas mais ils ne sont pas méchants. Par conte, ceux qui m’embêtent plus, c’est ceux qui y voient l’opportunité de faire du fric, qui vont acheter dix tirages de tête pour les faire dédicacer et se faire 500€ sur ton dos sans rien en avoir à cirer de la BD. Là, c’est un autre domaine, de l’ordre du placement financier. Ils sont très peux mais ceux-là obscurcissent un milieu qui est fait d’une majorité de gens qui aiment la BD et la rencontre qui en naît.

Un crayonné de Jean
Christophe : Pour les auteurs agacés par ces comportements, rien ne les oblige non plus à faire des dédicaces. On n’est pas tenu d’y aller. J’y vais par plaisir, pour les rencontres avec les lecteurs mais aussi avec d’autres auteurs avec qui je pourrais collaborer. J’aime beaucoup cet exercice.
Quels sont vos projets ?
Jean : Christophe en a plein, il fait quinze albums par an. L’avantage d’être scénariste.
Christophe : Sur quoi, suis-je ? Je termine TiZombi avec William après quoi on attaquera le tome 13 des Sisters, puis j’ai quelques séries chez Bamboo. J’ai toujours des nouveaux projets mais des projets en l’air, tout le monde en a mais je préfère en parler quand ils intéressent au moins quelqu’un, un éditeur. Si c’est pas pris, c’est pas la peine. Je n’en ai pas eu l’année passée, avec Boule et Bill qui prenaient du temps. Mais maintenant, j’ai deux-trois séries qui se sont arrêtées, ça laisse de la place.
Jean : La problématique n’est pas la même. Un dessinateur, sauf exception, ne peut pas mener plusieurs projets de front. C’est pour ça que Laurent Verron a arrêté, il n’avait pas le temps de faire d’autres projets. C’est beaucoup plus contraignant et prenant. Le prochain album me prendra six mois. Ça coupe l’année en deux. Alors, je fais des couleurs pour des amis. Comme Katanga, plutôt cool à faire. Je me suis régalé. Le démarrage est sympa. Puis, je fais de la musique, de la peinture, de la pétanque. Puis, Boule et Bill nous ont quand même amené un confort de vie et une sécurité. Avec ma compagne, on est moins pris à la gorge. On a quand même passé des années compliquées. Et Christophe plus que moi. On était smicards, les fins de mois étaient difficiles.
Christophe : La BD a changé ma vie, c’est sûr. J’ai travaillé en grande surface pendant quatorze ans, à attendre que mes projets soient pris. Et c’est sûr que quand on se voit l’opportunité grâce à un éditeur de reprendre une grande série, c’est curieux. Je n’ai pas encore vraiment retouché terre. Quand je pars promener mon chien et que je rentre chez moi en disant : je vais faire du Boule et Bill, il y a quelque chose de bizarre dans la phrase ! Il y a un élément qui me perturbe.
Jean : Moi, non plus ! Pour le coup, même si j’ai beaucoup moins d’étoile dans les yeux que toi, je sais que c’est du patrimoine. Et je m’en rends compte de jour en jour au fil des rencontres avec les jeunes lecteurs, les enfants. C’est un truc qui me dépasse. Encore plus avec les outils marketing. Des PLV, des banderoles, je n’en avais jamais eus !
Christophe : On n’avait jamais été à Gembloux ! (Rire)
Jean : C’est quand même la ville réputée pour son… attends… agronomie…
Christophe : … et sa coutellerie ! Puis, ce soir, on rencontre Luce Roba, ça nous tenait à coeur en tant que repreneurs de Boule et Bill, on ne l’a encore jamais rencontrée.
Éh bien, que la rencontre soit belle alors ! Merci à tous les deux et bonne fin de voyage… en train !
Série : Boule et Bill (Facebook)
Tome : 38 – Symphonie en Bill majeur
D’après les personnages créés par Jean Roba
Scénario : Christophe Cazenove
Dessin : Jean Bastide
Couleurs : Jean Bastide et Luc Perdriset
Genre : Humour, Gag, Famille
Éditeur : Dargaud
Nbre de pages : 48
Prix : 10,95€

Institution du monde détective DIY, Jérôme K Jérôme Bloche a beau cavaler sur son Solex aux quatre coins de la ville et de la France, il n’est jamais essoufflé. En selle pour sa 26ème aventure, le Nordiste qui se rêve en Humphrey Bogart revient au pays, à Bergues, de manière plus dramatique que le cas de ce facteur du Sud muter din ch’Nord. Boon et Dodier ne jouent pas la même scène et c’est tant mieux. Même si le papa de Jérôme n’est jamais le dernier pour faire des blagues à ses héros, cette fois, une gamine a disparu. Et cela semble sérieux, aussi sérieux que ce couteau qui, planté dans son arbre depuis des années, attend le retour de son propriétaire. C’est à Bruxelles, dans la Galerie Champaka qui le met à l’honneur jusqu’au 3 décembre, que nous avons rencontré le lumineux et sympathique Alain Dodier. (Photo de couverture de Chloé Vollmer)
Bonjour Alain, vous n’aviez pas attendu Dany Boon et sa bande pour nous faire découvrir Bergues, dans le troisième tome de la série, mais vous y revenez pour ce tome 26. Comment avez-vous retrouvé le chemin ?
C’est l’histoire qui m’a attirée. J’avais dans mes carnets cette idée selon laquelle un père ferait porter à son fils la culpabilité de quelque chose dont il est responsable. Le tout était d’introduire Jérôme dans cette enquête, ce tissu social. Jérôme, c’est toujours le problème !
Je pensais au Nord, plutôt Dunkerque, je voulais la mer. Mais je n’y suis pas arrivé. Alors l’oncle de Jérôme, dans un souci de bien se faire voir par son patron, a appelé celui-ci à l’aide pour une fugue un peu banale dans un univers froid, à Bergues.

Couverture du tirage de tête
Mais très vite, le trouble est semé, les hommes et les femmes s’opposent dans la recherche de la vérité.
Disons que les hommes ne sont pas à leur meilleur, cette fois-ci. Ce sont les femmes qui voient juste, elles ont l’intuition, sont moins sensibles aux artifices, aux conventions sociales. Elles (ré)agissent.
Et Jérôme qui n’est peut-être pas payé par le bon camp, du coup.
Jérôme, je suis le premier à ne pas savoir ce qu’il a dans la tête. Passif et intuitif, il est le bouchon dans le courant. Cela dit, il doit bien avoir un talent… c’est quand même lui, le héros.
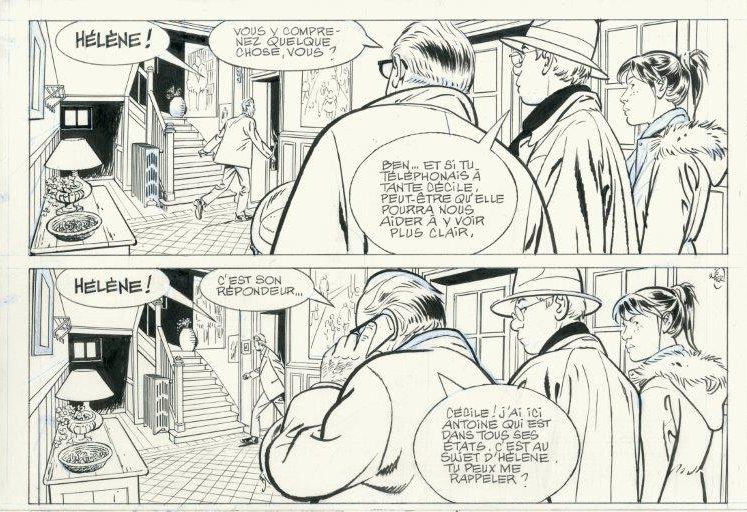
© Dodier
Avec une envie de le guider avec un nouveau regard sur Bergues, dans des coins que vos albums n’avaient pas encore visité ?
Je suis quelqu’un de casanier, attaché à ma terre. Avant de courir le monde, je trouve ça pas mal de faire le tour du quartier. Plusieurs fois. On n’est jamais déçu et on découvre toujours quelque chose. Je m’intéresse aux gens, peux rentrer chez eux, je connais cette vie. À l’autre bout du monde, le spectacle est à l’extérieur, on ne peut pas rentrer aussi facilement chez les gens.
Avant tout, j’imagine l’histoire, après quoi je cherche les lieux qui vont la servir et, qui sait, influer un peu. C’est un ping pong, avec la facilité que je n’habite pas très loin de Bergues. Mais un lieu n’a en tout cas jamais apporté une histoire.

© Dodier
Mais il y a des lieux dans lesquels vous prenez votre temps, balayant les phylactères (et dieu sait qu’il y en a dans cet album) pour faire le plein d’ambiance. Comme lors de ce déplacement de Jérôme sur son éternel Solex.
Oui, j’aime prendre mon temps mais, en même temps, dans cette planche, rien n’est gratuit. On tourne à l’Usine pour arriver au château qui est juste derrière. Ce chemin, je le connais bien, je l’ai fait, il existe… enfin, sauf la première case où là, si Jérôme suit cette direction, il parle dans la direction opposée. L’album vient de sortir mais certains lecteurs avertis m’ont déjà fait la remarque (il rit).
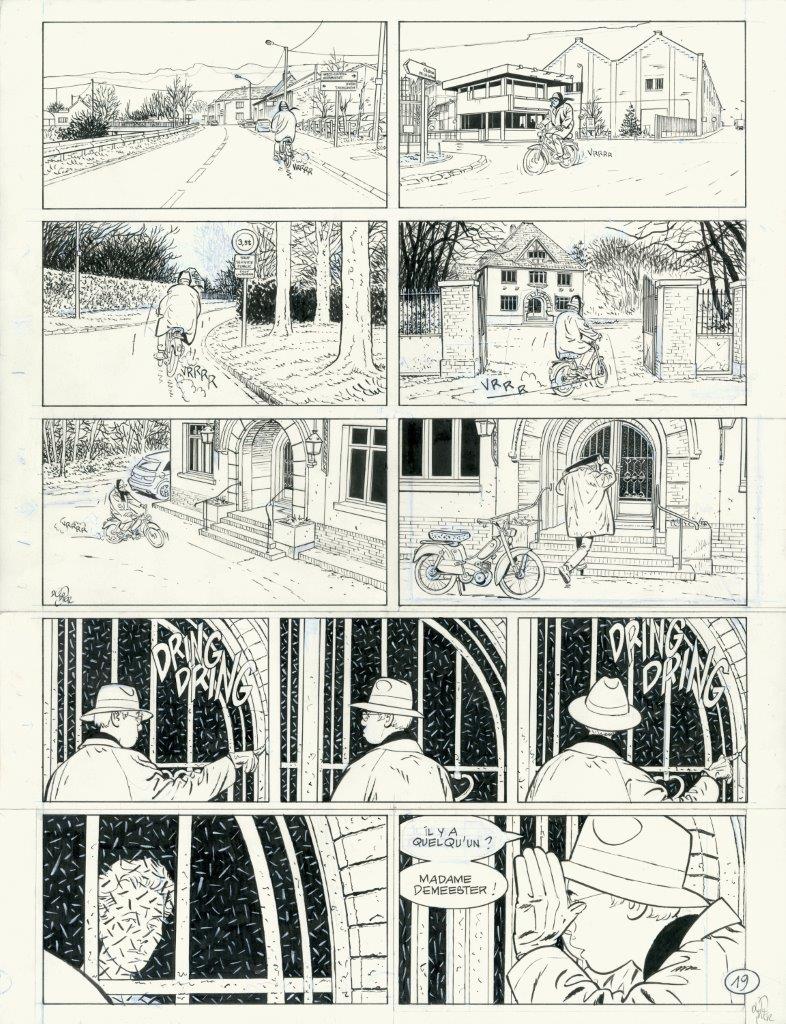
© Dodier
On aura qu’à dire que dans ses rêveries, Jérôme s’est trompé. Ce ne serait pas la première fois.
C’est vrai ! Dans ces moments-là, j’ai l’impression qu’il réfléchit. C’est la voie de l’air, un peu d’aïkido. J’aime bien faire ça, six cases qui respirent. Je ne faisais pas ça avant quand les albums étaient limités à 44 planches. Mais, cela dit, il faut être utile. Je n’aurais pas le courage de dessiner quelque chose qui serait inutile.
Autre planche, autre ambiance et une surprise. Lorsqu’ils sont appelés en pleine nuit, Jérôme saute dans ses habits… ou plutôt ceux de Babette.

© Dodier
C’était tellement inattendu que ce n’était pas dans le scénario. Au moment de la créer, je me suis dit : « Mais il n’y a rien dans cette planche ». Je ne pouvais résolument pas laisser cette succession de cases en l’état. Alors, en utilisant cette chambre noir, la lumière chichement répandue par le lampadaire et les vêtements jetés pêle-mêle, j’ai amené le dynamisme à cette planche nocturne.
Le fait de placer cette histoire en hiver est d’ailleurs, bien utile.
C’est la marque du polar. L’hiver, quand le soleil se couche et tire l’histoire vers la nuit, le noir. Un noir qui se justifie. Puis, je ne suis pas Milton Caniff, non plus. Mais cela dit, quand arrive l’ombre, j’aime faire quelque chose d’opaque, d’entier. Je suis hostile aux hachures.
Cet album, c’est aussi l’occasion d’une exposition chez Champaka à Bruxelles, l’occasion de voir que votre trait a changé.
Oui, j’en suis arrivé à synthétiser mon trait qui était plus baroque avant. J’utilisais des cache-misères, j’ai gagné en maîtrise.
Mais toujours avec des collages. On voit le travail, sur vos planches !
J’utilise un papier que j’aime beaucoup car il n’est pas totalement blanc… mais avec un inconvénient : il ne se gratte pas. Et comme j’ai beaucoup de repentir, je colle, coupe et découpe.
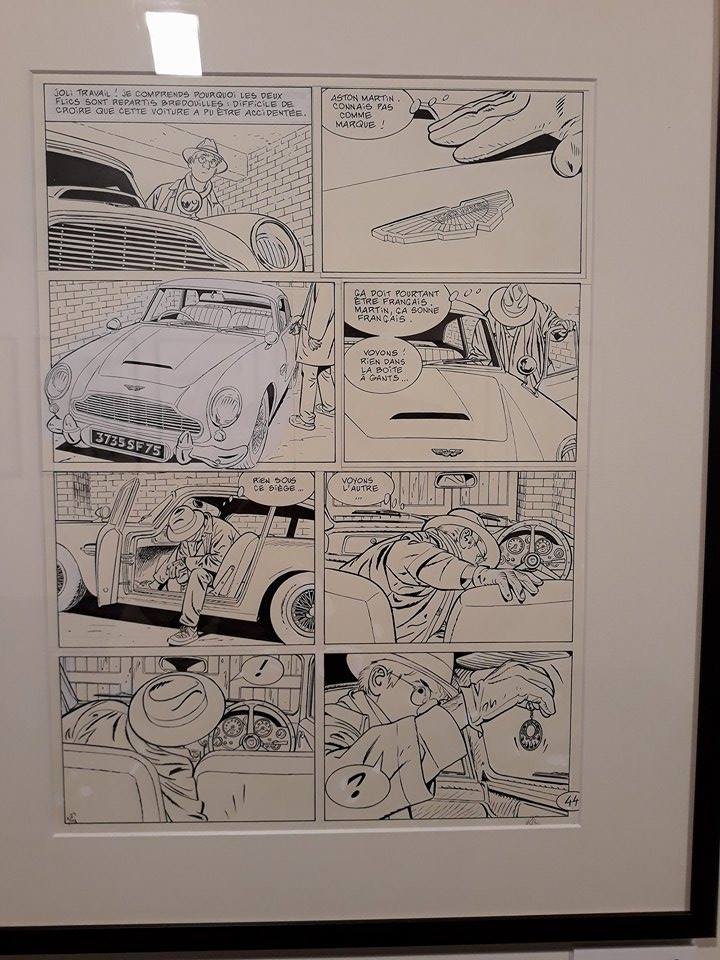
© Dodier
Cela fait 34 ans que j’anime Jérôme K. Jérôme Bloche, j’ai toujours autant de mal à avoir une idée, je laisse les personnages m’échapper aussi. Il y a beaucoup de combinaisons possibles, beaucoup de non-abouties aussi.
Une combinaison qui marche aussi, c’est ce flash-back qui ramène Jérôme en enfance.
À la seule exaction qu’il ait pu commettre un jour. Un vol de couteau. À son meilleur ami, en plus. Peut-être est-ce ça qui est à l’origine de sa vocation ? Oui, il a dû s’en vouloir. Cette idée, elle était en jachère dans un de mes carnets, attendant le bon moment pour être intégrée. Attention, pas au chausse-pied mais si, en plus, elle peut rentrer parfaitement et éclairer l’album, cela tient du miracle.

© Dodier pour Spirou

© Dodier
Éclairer comme le fait cette couverture sur laquelle Jérôme se mesure à un arbre impressionnant. Encore une fois, il est tout petit parmi les Éléments.
Ah oui, c’est pas mal, ça, comme interprétation. Une couverture, ça ne vient pas toujours tout seul. J’ai pris mon titre, Le couteau dans l’arbre, certains cherchaient le double-sens alors que ça ne veut dire que ce que ça veut dire. Il n’y a pas de sens caché. Et j’ai voulu utiliser la couverture pour le dire. Dessiner un tronc d’arbre et mettre Jérôme sur la pointe des pieds. Sa petite manche se relève, il essaie d’attraper le couteau et là on voit l’immensité du problème.
La suite ?
Contre-façon…s ? Je me demande encore si je dois mettre un « s » ou pas. Mme la Baronne fait appel à Jérôme. Une vidéo lui a été envoyée : son fils est ligoté sur une chaise et une rançon est demandée contre sa libération. Et quelqu’un en hors-champ qui utilise des grands cartons pour ne pas parler. Mme la Baronne/ 100 000 € / Demain Soir / Sinon… / PAN ! et on voit un revolver braqué sur l’otage. Jérôme voit ça et lâche : « oh, c’est original comme demande de rançon » avant d’être rappelé à l’ordre et de se dire que c’est quand même du sérieux.
Du sérieux qui nous fait dire qu’on sera encore de la partie pour ce tome 27. En attendant, vos planches originales, les nouvelles mais aussi les anciennes (une planche sélectionné pour chaque album) sont à découvrir à la Galerie Champaka de Bruxelles.
Série : Jérôme K. Jérôme Bloche
Tome : 26 – Le couteau dans l’arbre
Scénario et dessin : Alain Dodier
Couleurs : Cerise
Genre : Polar
Éditeur : Dupuis
Nbre de pages : 60
Prix : 12€

Ça claque, ça fracasse, ça casse aussi la mécanique de notre coeur de beurre, ça fait mal mais à la fin, ça fait aussi du bien. Parmi les albums qui restent accrochés à votre rétine très longtemps, Petite Maman de Halim tient une place de choix, de poids et de choc. Car raconter aussi près, aussi justement, aussi crûment la violence et de maltraitance intra-familiales si horrible à s’acharner sur des têtes blondes qui n’ont rien demandé, cela n’avait rien d’évident. Brisant le mur du silence, ne cherchant pas de grand méchant mais se plaçant du côté des enfants, Halim réussit la mission en choquant et en amenant la discussion et la réflexion. Nous l’avons rencontré et ses réponses ne nous ont pas déçus.

© Halim chez Dargaud
Bonjour Halim. « Petite maman » comme titre, c’est doux, non ? Ça ne prépare pas à une telle dureté. Ce titre est-il arrivé comme une évidence ou avez-vous mis du temps à le trouver ? Pourquoi, ce titre, si simple et si évident à la lecture de votre album ?
En effet, c’est très doux comme titre ! Je comprends que cela puisse dérouter vu le contenu et la dureté de l’album. En fait, « Petite Maman », dans mon esprit c’est d’abord son héroïne, Brenda. Elle en est le fil rouge, le rayon de soleil, et on voit cette histoire à travers ses yeux à elle. Du coup, je ne me voyais pas utiliser un titre dur ou triste, qui ne porterait pas, en lui, ce regard d’enfant sensible et particulier sur les choses.
Ce titre s’est donc imposé à moi dès le début. Cela arrive quelques fois d’avoir le bon titre dès le départ. Ça m’est arrivé aussi avec mon 1er album, « Arabico ».
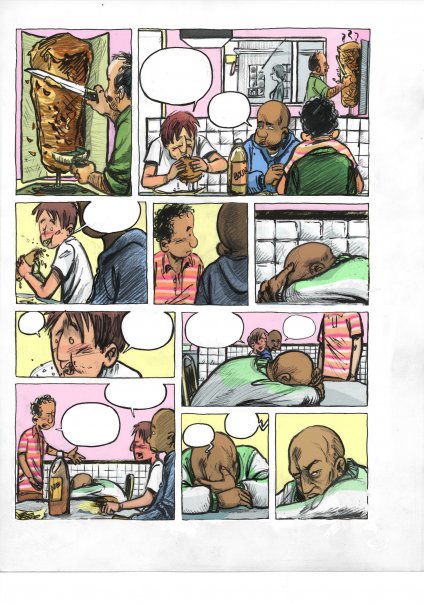
© Halim
Après Arabico, Brenda, un autre enfant. C’est du côté des enfants plus que du côté des grands que vous vous sentez à votre place ?
Bonne question ! Je ne saurai malheureusement pas y répondre clairement. Ou alors disons, que je me sens à ma place auprès des adultes qui sont redevenus les enfants qu’ils étaient.
Tour à tour, j’ai été cet enfant qui n’aimait rien de mieux que la liberté. Puis, en grandissant, je suis devenu cet adulte ne recherchant rien de mieux que la sécurité. Et maintenant, je vis entre ces deux extrémités. Je suis une sorte d’adulte-enfant qui aime juste vivre. Un peu comme le dit Michel Onfray à propos d’Henry David Thoreau : « L’Enfant qu’il fut, a bien été le père, de l’homme qu’il est à présent ».

© Halim
Votre tour de force, c’est de faire dans l’émotion en évacuant pourtant le pathos, ce que beaucoup d’œuvres peinent à faire.
C’est gentil, ça me fait extrêmement plaisir que vous ayez été sensible à cette exigence-là. Car oui c’était bien une volonté de ma part. Je suis trop souvent frustré en tant que lecteur, de voir des personnages en deux dimensions, comme si nous étions tous binaires, ou « facile à lire ». Or, on ne l’est pas. Même se lire, se comprendre soi-même est une sacrée gageure. Qui peut même prendre toute une vie !
Au-delà de la volonté, ce traitement s’est imposé de manière plutôt intuitive ?
Oui, je fonctionne intuitivement quand j’écris. Les personnages se mettent en place naturellement avec toute leur complexité et leur part d’ombre et de lumière. Concrètement, je les fais réagir, non pas en me demandant ce que je ferai à leur place, ou ce que je voudrais qu’il fasse ou qu’ils ressentent. Mais plutôt « Que peut-on ressentir dans un cas pareil ? ». Je reste en permanence fixé sur l’histoire. Le récit.

© Halim chez Dargaud
Et justement, que ce soit en BD, au cinéma ou ailleurs, la propension à sortir les violons, à faire dans le larmoyant quitte à passer à côté de son sujet, ça vous énerve ?
Au risque de vous décevoir, au cinéma, j’aime beaucoup les violons. Mais seulement si c’est justifié. Et trop souvent ça ne l’est pas, parce que le récit d’un film ou d’une œuvre est faible. Pour ce qui est des violons, prenons l’exemple de la peur dans les films d’épouvante. La peur étant une émotion, on pourrait penser que trop de peur dans tel film équivaut à sortir les violons. Comme avec les larmes pour un drame, ou le rire pour une comédie. Or, plus un film nous fait peur plus il est réussi, de même que l’on se souvient beaucoup mieux d’un film où on a ri du début à la fin. Bref, là on aime sans compter. On est « plongé » dans l’histoire.

© Halim chez Dargaud
Rien ne me met vraiment en colère, mais ce qui me déprime, totalement en revanche la quasi-absence de bons scénarios. De bonnes histoires. Alors que c’est la clé de voûte de toute œuvre. Quand on demande à John Lasseter la recette des succès de Pixar, il répond toujours la même chose : « L’histoire ! L’histoire ! L’histoire ! ». Pour David Fincher; par exemple, c’est l’émotion. Parce qu’au fond, tout est affaire de storytelling.
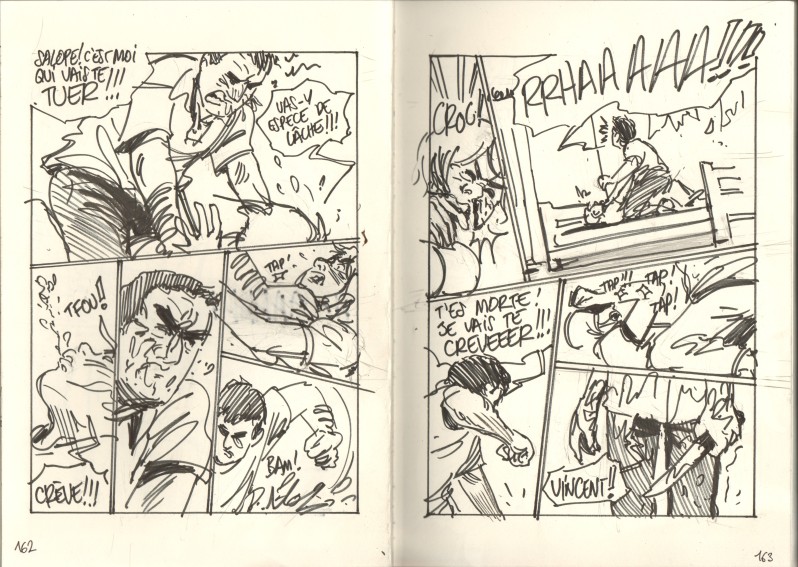
© Halim
Pas de pathos mais pas non plus de manichéisme. Vos personnages sont moins maîtres d’eux qu’il n’y parait. Ne se débattent-ils pas ? Ne sont-ils pas responsables de leurs gestes mais pas aussi conscients que ça ? Même Vincent, le tyran de cette histoire, a un autre visage, plus doux. Lui pardonneriez-vous ?
Encore merci, vos compliments me touchent sincèrement. D’autant que je prends vraiment soin d’écrire des histoires humaines avec toutes leurs nuances, cette bienveillance me tient très à cœur.
Et donc oui, j’espère ne jamais avoir à écrire une histoire manichéenne, où la vie et les épreuves ne modifient pas les personnages. Ils se débattent tous, je crois que c’est le meilleur reflet qu’on puisse offrir à des lecteurs. Parce que nous cherchons tous à vivre et à faire de notre mieux. Même lorsque nous échouons à être qui nous voudrions. Je pense qu’il n’y a que des souffrances, et que la méchanceté gratuite (naturelle donc), ça n’existe pas. Même si ça fait de bonnes histoires.

Vincent, calme… © Halim chez Dargaud
Par ailleurs, le monde ne manque pas de juges, surtout depuis l’avènement d’internet, des commentaires anonymes, des règlements de comptes sur place publique. Tout cela n’encourage qu’à résumer des faits complexes, à étiqueter les gens et à distribuer des bons et des mauvais points. Désigner les bons des mauvais citoyens. Nous perdons un temps et une énergie folle dans cette « guerre de tous contre tous », et cela nous divise malheureusement. On ne s’attaque plus à des problèmes (qui nous concernent pourtant tous) mais à des personnes censées incarner à elles seules les maux de la société.
C’est aussi contre cela que j’écris des histoires intimes. Une façon de dire que l’on est tous pareils. Peu importe derrière quelle idéologie on se cache. Nous sommes faits du même bois, et éprouvons les mêmes (re)sentiments. Nous pouvons donc tout comprendre, même la méchanceté de Vincent.

… trois cases plus tard © Halim chez Dargaud
Avant de réellement entrer dans l’enfer quotidien de Brenda, vous relatez un autre enfer : cette expérience de Frédéric II, horrible. Ça aurait pu venir comme un cheveu dans la soupe, mais pas du tout. Vous teniez à intégrer cette expérience ? Pourquoi ?
Cette anecdote n’était pas un hasard. Je m’en serai beaucoup voulu sinon… Au-delà du fait que cette expérience soit incroyable en elle-même, et même insupportable à imaginer ; je tenais à l’intégrer pour prévenir le lecteur en quelque sorte. Pour lui dire qu’on allait parler d’interactions humaines ; et de la plus important d’entre elle : l’amour.

© Halim chez Dargaud
Ainsi vers la fin de l’album, on se rend compte que le langage inné recherché par Frédéric II chez les nourrissons, c’était l’amour. Et l’héroïne, Brenda, se raccroche à sa vie grâce à l’amour inconditionnel qu’elle éprouve pour sa mère. Elle aime sa mère comme s’il s’agissait de sa propre fille, et c’est pour cela qu’elle la protège quoiqu’il arrive. Stéphanie est une adulte, construite par ses échecs, ses doutes et ses blessures. Les enfants n’ont pas encore les névroses que nous avons, et je crois que c’est pour cela qu’ils n’abandonnent pas facilement. Qu’ils sont si forts…
Je crois que nous le sommes tous d’ailleurs, mais nous avons beaucoup perdu en chemin, un peu de notre capacité à rêver, je crois.

© Halim
Vous remerciez Loisel de vous avoir encouragé à trouver votre style. Un style, c’est difficile à trouver ? Comment définiriez-vous le vôtre ? Vous l’avez fait évoluer pour vous attaquer à Petite Maman ? Quel apport a eu ce géant de la BD qu’est Loisel ?
Ho que oui, un style est difficile à trouver. Qu’il soit narratif ou graphique d’ailleurs. C’est surtout long. Très long. Ça prend des années, et c’est grâce aux années, au chemin qu’on prend, que l’on arrive, je ne sais trop par quelle magie, à arriver là où on voulait. Là où on s’était imaginer arriver, sans trop savoir comment. Exactement comme un scientifique qui aurait une vision (la relativité pour Einstein, etc.) et qui devait ensuite la prouver, la mettre au monde, la faire exister.
Par exemple, l’application en philosophie politique de la formule de Fibbonacci (théorie mathématique sur la suite d’entiers) illustre bien que nous atteignons toujours nos buts. Par l’intermède de suite non pas d’entiers, mais d’échecs et d’erreurs auto-correctrices, on parvient au but. Toujours ! En gros, l’échec est la voie royale vers la réalisation de nos idées ou de nos rêves.

© Halim
Quant à Régis Loisel, je ne le remercierai jamais assez. Il m’a apporté énormément. Artistiquement mais aussi humainement. C’est l’un des hommes les plus inspirants du monde, à tout point de vue. Je l’ai rencontré à Montréal et j’ai investi son atelier quelques temps, un vrai rêve. Je tâtonnais dans mon désir de faire de la BD, et Régis m’a soutenu indirectement. Notamment, en me disant que j’étais fait pour ça. Que j’allais faire de grandes choses. L’entendre de la part d’un géant comme lui, c’était un bonheur indescriptible, imposant, redoutable de pression… mais un bonheur inestimable.
Après concernant l’apport artistique, il m’a toujours dit de faire sortir ce que j’avais dans le cœur. Je n’ai jamais cherché à m’inspirer de son travail. Mais à travailler sur moi. Comme il me l’intimait. Et il avait raison.

© Halim
Comment faites-vous pour secouer à ce point les cases ?
Ça, je n’en sais rien non plus ! Je peux vous dire comment je m’y prends en revanche. Je trouve cet agencement sur un brouillon assez nerveux, et instinctif. Je rentre littéralement dans l’émotion, comme en transe. L’action et les gestes des personnages, le fait qu’ils sortent d’eux, font que j’ai eu ce besoin impératif de secouer les cases. De « faire exploser le cadre ». De faire plier le support sous les pics d’émotions des personnages (et du lecteur du coup), ainsi du récit. Voir si cela ne nuisait pas à l’histoire. Et je l’ai gardé, en voyant que cela fonctionnait. Je tâtonne, j’échoue souvent, et je parviens à ce qui me trottait en tête, tout doucement.

© Halim
Cette histoire viscérale, pas anodine mais pas rare non plus, malheureusement, qu’est-ce qui vous l’a inspirée ?
C’est un ensemble de choses. Tout d’abord, le fait que j’ai grandi dans une banlieue populaire et pauvre. J’étais donc aux premières loges de la ghettoïsation socio-économique et de la précarité quotidienne terrible qui s’abat sur les gens qui y vivent. Ça se traduisait par des tas de souffrances d’adultes qui n’avait pas le temps, ni la sérénité ni la force, de ressembler à cette image inhumaine des « merveilleux parents » que la télé leur crachait au visage… Le mal-être et la misère ont tout brisé : les individus, et les liens familiaux en premier lieu. Il s’attaque à nos cœurs et à nos âmes. Et ce sont les femmes et les enfants qui sont au bout de cette oppression systémique. Donc voilà, je suis en quelque sorte, suffisamment habitué au malheur et aux mécanismes d’échecs et de répression pour en parler. Ça m’est malheureusement très familier, limite banal.

© Halim
Ensuite, il y a ces vagues d’infanticides qui ont défrayé la chronique encore très récemment. Des affaires sordides qui me faisaient froid dans le dos. D’autant plus lorsque l’on est parent soi-même, c’est insupportable à concevoir que l’on ne fasse pas tout pour prévenir ces drames, et juguler la souffrance humaine. L’État, au contraire, coupe les budgets, précarise et réprime les liens et acquis sociaux, tout en judiciarisant à outrance tout ce qu’il touche. C’est dans la ligne logique d’une gestion punitive et carcérale d’état, qui a choisi de mettre le profit et les intérêts privés immédiats des actionnaires au centre de ses priorités. Loin, très très loin devant l’humain… Notre société déresponsabilise tout, et les êtres humains qui la composent continuent d’oublier à quel point ils sont humains. Jusqu’à en perdre le pouvoir qu’ils ont sur leur propre vie. C’est le même processus que l’esclavage, la colonisation, le racisme ou le sexisme. Lorsque l’on est dépossédé de soi-même, ça s’appelle de l’aliénation. C’est la source de toute violence. La racine du mal.
Et tous les personnages de mon albums sont aliénés de cette façon-là, ils sont dépossédés de ce qu’ils sont. Et agissent donc « inconsciemment » comme on dit…

© Halim chez Dargaud
Quand on est auteur face à une telle violence, est-ce que quelque part on ne veut pas tout faire pour l’arrêter ? Faut-il du coup s’interdire la facilité ? Se mettre dans la peau de cette jeune ado ?
S’interdire la facilité, pas jusque-là non, je pense que ce serait contre-productif. En création, il ne faut absolument rien s’interdire. Surtout pas la facilité. C’est elle qui permet ce que les neuroscientifiques nomment « l’absorption cognitive ». C’est-à-dire, le fait de se concentrer, de se connecter au travail que l’on est en train de faire. Ce n’est pas l’effort qui permet tout cela. L’effort c’est de la souffrance. Or, la création ne nait pas de la souffrance ou de l’effort ; mais de la facilité et du plaisir. Sinon, on ne met que des tensions sur ses pages, dans son art, ou dans sa vie. Et cela se ressent, chez un lecteur ou un interlocuteur. Car une histoire, un dessin ou une parole contient de la vie. Des signaux électriques comme le souffle ou l’énergie, qui permettent de communiquer de l’émotion.
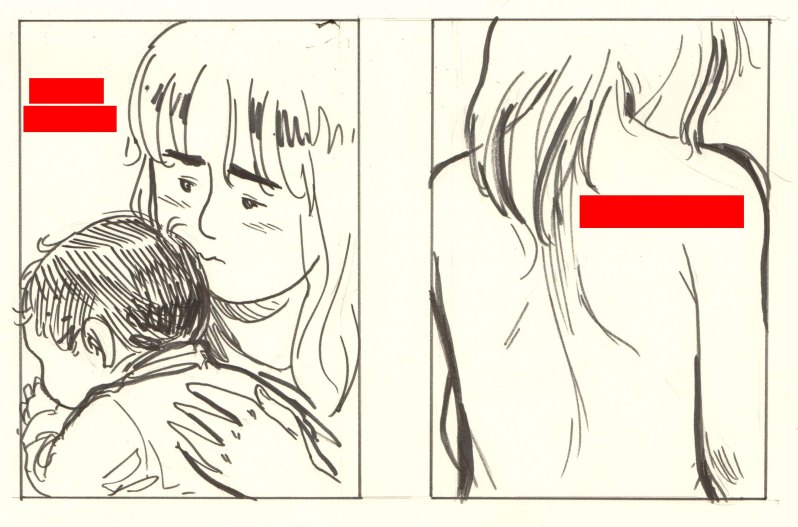
recherches de couverture © Halim
Je crois qu’il faut donc « vivre » sincèrement, simplement, et facilement ce que l’on raconte. Lâcher prise en quelque sorte, prendre du recul et viser juste. C’est comme cela que je peux ressentir au mieux que cela fait qu’être à la place de Brenda par exemple. Et puis, c’est plus facile que de faire l’autruche ou de prendre de la hauteur sur un sujet que l’on serait, par conséquent, tenté de juger et de prendre de haut.
Au-delà de mes doutes et de mes peurs personnelles, j’essaie de ne jamais perdre de vue que je ne fais qu’un album. Mais que par contre, je me dois absolument y croire et le vivre corps et âme. Parce que lui, l’album, il se lira comme le nez au milieu de la figure.
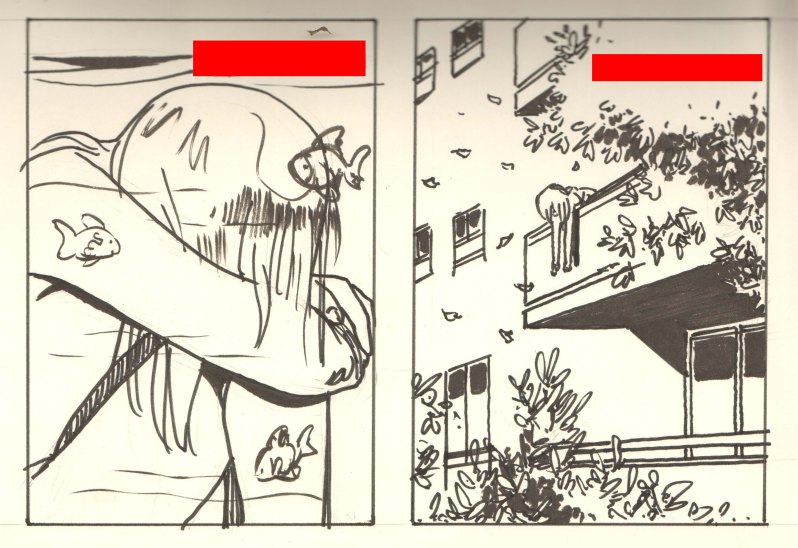
recherches de couverture © Halim
Au fond, vous ouvrez les murs de l’intimité d’une famille. Comment avez-vous documenté tout ça ? Comment l’avez-vous représentée, au plus près des corps, des coups de sang et des déchirures ? Se force-t-on aussi, paradoxalement, à prendre du recul ?
Oui. Je pense que c’est par habitude. L’intimité m’est familière. Que ce soit celle d’un individu ou d’une famille, ou d’un pays. C’est un choix je pense, je ne pourrais pas parler d’un personnage ou d’un groupe, si je ne le connais/comprend pas intimement. Quoiqu’il vive, et quel que soit le sujet. Et même, à la limite, plus le sujet est délicat, et plus je serai tenté de l’aborder je crois.
Pour la documentation, j’ai trouvé certaines descriptions des blessures, par les enfants eux-mêmes. Ça m’a dévasté de lire tout cela. Et j’ai ensuite dessiné la meilleure façon de représenter ces blessures, parce qu’en noir et blanc, c’est assez difficile de dessiner un hématome, ou un cocard par exemple, ou encore la peau pliée de douleur sous des doigts qui nous pincent fort… Par contre, je ne me suis pas efforcé de prendre du recul pour ça. Je n’ai pas pu, ni voulu « détourner les yeux », en sachant que des enfants eux, ne peuvent pas se détourner de l’enfer dont ils souffrent.
Autre tour de force, la capacité de cette BD à être immersive. Notamment en frappant fort les esprits avec tous ses bruits. Les clics, les portes qui claquent, le chien, le bébé. Concevez-vous la BD comme un objet sonore comme peut l’être un film ? Le fait d’exprimer ces bruits en dessin, de forcer le lecteur à les entendre, ne rend-il pas cet album encore plus percutant ? De ce « défaut » de la bd, ne tirez-vous pas une force ?
Encore une chose que je souhaitais que l’on ressente. Effectivement ! Je suis donc très content de ce que vous me dites là. En fait, j’ai ressenti cette expérience immersive chez Naoki Urasawa, dont j’ai lu Monster et 20th Century Boys à la suite, quand j’ai commencé « Petite Maman ». Et il y avait une permanence de bruits de porte ou de grillon en été. Ça m’a énormément plu, et contribué à me faire entrer dans ces histoires.
Et j’ai expérimenté un tas d’autres choses dans mon coin, sur ma table à dessin. Mais ce sont des choses que je n’ai jamais osé présenter à personne, car tout cela sort complètement du cadre habituel de la BD telle qu’on l’a connait aujourd’hui. Aussi, les bruits dans Petite Maman, les cases éclatés, le symbolisme etc. tout cela, c’est une proposition un peu timide de ma part, d’entrée immersive. Bon, ce sujet-là ne se prêtait pas tellement à l’expérimentation donc j’ai eu raison d’y aller mollo. Mais là, je voudrais commencer à emmener mes prochains albums « ailleurs ». Dans d’autres dimensions… Parce que je pense que le monde de la BD n’a pas encore tiré tous les fantastiques trésors de possibilités qu’il recèle. Il y a encore des cadres, et des barrières ici et là. Mais c’est normal, les choses mettent du temps à s’installer. Comme tout dans la vie. Et chaque génération voit son lot d’auteurs arriver avec de nouvelles propositions de lectures et des visions qu’ils ont puisés dans la matrice de leur époque, pour renouveler le milieu de la BD. Donc le 9e art évolue et c’est très excitant ! J’espère que nous aurons le temps et le plaisir de reparler de ces expérimentations et immersions, dans un avenir pas trop lointain.
Il y a la musique aussi, des Goonies. Un film culte pour vous? Que vient amener cette référence à Petite maman ? L’insouciance que Brenda n’a pas ?

© Halim chez Dargaud
Ho que oui ! Les Goonies, c’est un film cultissime pour moi. L’un des meilleurs films jeunesse et tout public jamais réalisé. Peut-être le meilleur, je crois. En tout cas pour moi ! Et notamment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c’est le seul film pour enfant (et tout public) où les héros sont des enfants qui n’arrêtent pas de jurer et de dire des gros mots. Même les personnages sont des univers à eux seuls. J’ai l’impression que ce film est libre, que c’est un peu un ovni dans la culture populaire. Je n’ai pas connu un cas similaire d’œuvre où les enfants juraient comme des charretiers. Ni au ciné, ni à la télé, ni en BD. Et puis, ça illustre bien la liberté de parole très décomplexée de l’époque, où on ne polémiquait pas autant, et surtout pas au mot près. Une époque où la surveillance généralisée depuis internet notamment, ne déterminait pas encore nos pensées, nos paroles et nos actes, comme de vulgaires algorithmes.
Et sinon, Les Goonies dans Petite Maman, c’est effectivement pour illustrer l’insouciance que Brenda n’a pas. D’ailleurs, le film l’amuse, mais on voit bien qu’elle ne rit pas spécialement, elle est comme impassible et absente. Elle est plus souriante et heureuse lorsqu’elle n’est pas seule et qu’elle va bien, comme lorsqu’elle regarde Karaté Kid 3 avec sa famille
Le dessin, il est important. C’est d’ailleurs par lui que Brenda va témoigner de sa détresse. Ce n’est pas/plus inoffensif un dessin ! Quand avez-vous d’ailleurs pris conscience de sa force de frappe ? Certains albums, certains auteurs vous ont fait vous rendre compte de cette force de frappe, de ce pouvoir à raconter le réel ?
Complètement ! Un dessin en dit long. Comme le dit l’adage, une image vaut parfois mieux qu’un long discours. Donc ce n’est pas du tout inoffensif en effet. Les structures d’aides à l’enfance, utilisent toutes les outils du dessin pour « faire parler » les enfants. Notamment parce que « parler », sortir le mal, mettre des mots sur des blessures, et surtout communiquer ; par le dessin ou n’importe quoi d’autre, c’est éminemment thérapeutique. C’est vital ! Alors, il était important pour moi que le mutisme, et la souffrance de Brenda possède une brèche qui permette d’entendre ce qu’elle ressent. En s’exprimant notamment par le dessin. De plus, étant dessinateur de presse, je connais assez bien l’importance d’une image seule. Et le fait que le dessin peut être constructif mais tout aussi destructeur, comme l’actualité nous l’a montré ces dernières années.
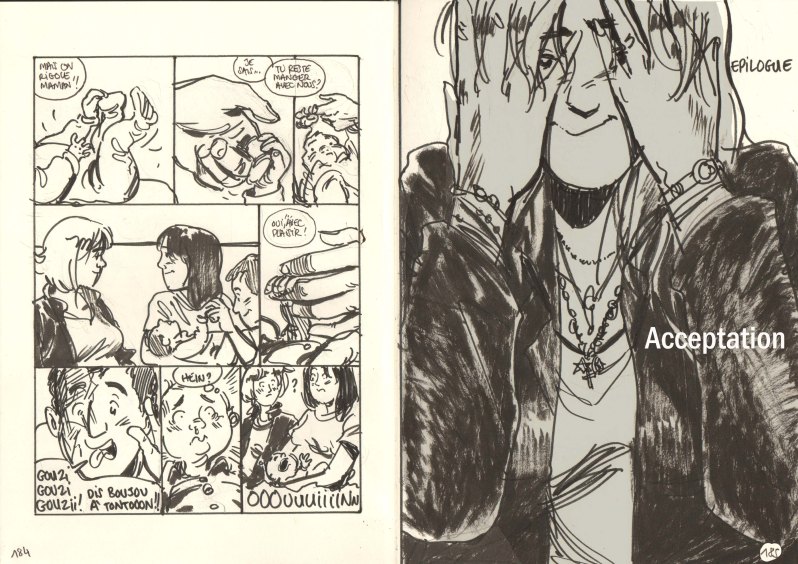
© Halim
Il y a beaucoup d’albums qui m’ont fait prendre conscience de la force de frappe et du pouvoir incroyable du dessin pour illustrer le réel. À commencer par Tintin, Yakari, ou toutes les BD qui m’ont décrit un monde auquel je n’avais pas accès. Et par la suite des albums comme « Là où vont nos pères » de Shaun Tann, « Quartier Lointain » de Jiro Taniguchi. « Sunny » de Matsumoto, et bien d’autres comme Fraise et Chocolat, Meteor Slim, Mauvais Genre, Bandonéon, Rebetiko etc. qui décrivent des réalités exceptionnelles, chacun dans leur domaine, leur sujet, et le traitement employé pour les aborder.
Quels sont vos projets désormais ?
En parallèle de mon activité de journaliste et dessinateur de presse, il y a un album d’humour et un essai qui sont prévus, autour du langage des images et de la liberté d’expression.
En BD, je suis en train de reprendre un mythe de la culture populaire mondiale. Je vais donc totalement changer de registre (narratif et graphique), et ce sera donc un conte fantastique, et social à la fois. Mais je ne peux pas en dévoiler davantage, car rien n’est encore signé.
À part ça, je commence tout juste à écrire des scénarios pour d’autres. Et juste en tant que scénariste, cette fois-ci.
Merci beaucoup Halim et à très vite.
Propos recueillis par Alexis Seny
Titre : Petite Maman
Récit complet
Scénario, dessin et couleurs : Halim
Genre : Drame familial, Sociétal
Éditeur : Dargaud
Nbre de pages : 192
Prix : 19,99€

Quand les animaux s’élèvent et prennent la parole dans ce monde humain, tout ne se passe pas toujours comme sur la planète des singes. Ainsi, Jack Wolfgang, nouvelle série de Stephen Desberg, Henri Reculé et Kattrin, décrit un univers où hommes et femmes cohabitent avec les animaux autour d’un équilibre alimentaire trouvé dans le… tofu. Sauf que forcément, il y a un pépin et le prétexte est donné à une aventure à travers le monde qui n’oublie ni l’espionnage ni l’humour et les références sur le quai. Le loup est dans la place et Henri Reculé en est le témoin amusé. Interview enrichie à forte dose de bonus.
Bonjour Henri, on attendait la suite des Mille et autres nuits, vous nous revenez avec un agent secret loup. Jack Wolfgang. Mais quelle est sa genèse?
En fait, le premier tome des Mille et autres nuits est passé assez inaperçu sans que nous sachions trop pourquoi. D’autant plus que les gens qui l’avaient lu l’avaient apprécié, nous n’avons pas vraiment reçu d’avis négatif. La question s’est donc posée de continuer ou pas cette aventure. Il nous a vite semblé indispensable, à l’éditeur et à nous-mêmes, de terminer Les Mille et Autres Nuits mais sous un format différent. Ce sera donc une intégrale regroupant l’histoire complète qui était prévue en trois tomes. Pour le moment, j’ai terminé ce qui devait être le deuxième tome. Il ne me reste plus qu’à conclure un semblant de troisième tome, 20-30 planches, dont Stephen réalise encore le scénario.

© Desberg/Reculé/Kattrin chez Le Lombard
Alors, comment Jack Wolfgang s’est pointé ? C’est la femme de Stephen qui a eu l’idée d’un univers animalier, anthropomorphe. Stephen a tout de suite trouvé l’idée intéressante. « Pourquoi, tu ne ferais pas ça? ». J’étais partant mais il nous fallait quelque chose qui soit vraiment original.

© Desberg/Reculé/Kattrin chez Le Lombard
De votre côté, un monde anthropomorphe, c’était une première, à peu de chose près.
J’avais quand même déjà fait ça dans les Immortels. Aussi dans le Dernier Livre de la Jungle, mais même si les animaux parlaient, ils restaient des animaux. Pour Jack Wolfgang, le scénario a connu plusieurs moutures. Au début, Jack était le seul animal qui parlait, le seul dans un monde d’hommes. Et nous racontions pourquoi : son enfance, une manipulation génétique, etc.
Dès le départ, il était prévu qu’il soit un agent secret, critique gastronomique, travaillant pour un journal. C’était assez sombre et il était question d’une mutation créée par l’homme, mais c’était un peu trop X-Men.

© Reculé
C’est vraiment en creusant l’idée originale que Stephen a décidé qu’il était plus intéressant d’avoir un monde où les animaux auraient évolués depuis le Moyen-Âge et les musiciens de Brême. Leurs corps s’étant humanisés, petit à petit. En tant que dessinateur, j’ai, du coup, dû faire des recherches approfondies. Il s’agissait moins de faire la différence entre le réalisme ou pas, entre le simple et stylisé et le sophistiqué, que de faire correspondre le dessin et l’histoire. En réalisant les premières planches, je l’ai trouvé ce style idéal qui fait passer l’histoire. Et de fait, il était devenu moins réaliste. J’ai opté finalement pour l’intérêt graphique.
Avec des difficultés pour certains personnages ?
J’ai beaucoup tourné autour d’Antoinette, le personnage féminin de ce premier tome. La faire trop animale dénaturait le propos. Peut-être un jour, reviendra-t-on à l’origine des personnages centraux ? Toujours est-il que j’ai cherché la meilleure manière graphique de les présenter. Il fallait trouver le bon compromis entre le mâle animal et l’humain et la femelle animale et humaine. J’ai accentué le côté fin et félin de celle-ci.

© Reculé
C’est d’autant plus difficile quand des animaux et des humains sont mêlés dans une même histoire. Il y a des libertés graphiques à prendre. Après, c’est vrai que si un jour, je dois expliquer comment les animaux ont physiquement évolué, je vais avoir des difficultés ! L’important était de prendre cet univers comme le monde d’aujourd’hui ! D’ailleurs, il est sans doute plus simple de faire la Planète des singes, ce sont les animaux les plus proches de nous.
Vous avez également pris des libertés par rapport à l’échelle des grandeurs.
Oui, et ça ne va pas aller en s’arrangeant (rires) : dans le tome 2, vous aurez affaire à un pigeon « à taille humaine ».
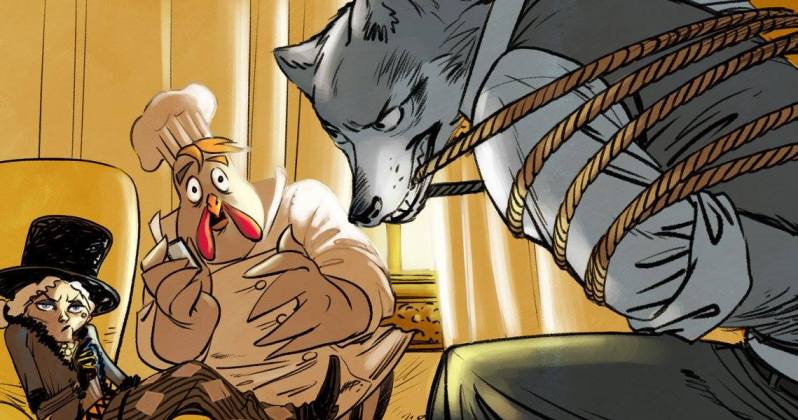
© Desberg/Reculé/Kattrin chez Le Lombard
Cela implique, en tout cas, de laisser tomber les animaux de… compagnie !
Et j’ai dû y veiller plutôt deux fois qu’une. Cette fois, je ne pouvais pas dessiner d’humains avec un chat ou promenant un chien en laisse dans la rue. Des trucs que je rajoute assez facilement dans mes autres albums pour rendre l’espace et le décor plus vivant. Ici, j’ai failli tomber plusieurs fois dans le panneau ! De même que je ne pouvais pas faire d’oiseau posé sur un fil électrique, tous les animaux devaient être logiques et anthropomorphes.

© Desberg/Reculé
Après, cela n’exclut pas un tome qui se passerait dans un pays où des chats veulent redevenir domestiques pour échapper à la pénibilité de gagner sa vie et de trouver un travail. Tout est possible.

© Desberg/Reculé/Kattrin chez Le Lombard
Aussi, pour que les humains et les animaux cohabitent en harmonie, vous avez pensé à tout. Et encore plus à l’équilibre et l’harmonie alimentaire qui doit régner.
Oui, mais là encore, ça pourrait vaciller : certains animaux dits prédateurs pourraient vouloir revenir à cet esprit de chasseur. Je me souviens d’une illustration préparatoire que j’avais réalisée avec un tigre-chasseur assis dans un salon décoré avec une quantité phénoménale de têtes d’animaux sacrifiés. L’instinct prédateur peut resurgir à tout moment et pourquoi pas une histoire prochaine dans l’esprit du Comte Zaroff. Ça pourrait s’envisager.

© Reculé
En attendant, Jack Wolfgang, c’est surtout une histoire d’espionnage.
Oui, lorgnant plus vers James Bond que vers Bourne et dégagé de thèmes déjà bien (et trop ?) présents dans nos vies. Nous ne voulions pas faire de la politic fiction !
Et le cinéma est bien présent !
Avec des clins d’oeil. Pas que cinématographique d’ailleurs. Avant les recherches sur cet univers, j’ai relu pas mal de comics, notamment Batman Le Long Halloween de Jeph Loeb et Tim Sale. Je me souviens avoir été marqué par ces double-pages d’action où quelques bulles venaient s’ajouter pour quand même faire avancer l’histoire. Forcément, ça marque ! J’ai voulu rendre Jack Wolfgang le plus cinématographique possible, dynamique, que les images ressortent. Au cinéma, une autre influence est celle de l’explosif Kingsman.

© Reculé
Vous disiez sur votre site (qui est un véritable making-of de votre travail) la difficulté de créer des personnages secondaires…
Alors que les héros ont plus de temps « à l’écran », les personnages secondaires apparaissent peu, il faut assez vite que le lecteur les distingue, qu’ils aient « de la gueule ». Car s’ils arrivent en planche 2 avant de disparaître et de revenir sur la planche 25, ils ne doivent pas être confondus. Ils doivent être directement identifiables.
À moins de jouer avec une caricature, typée, mais ce n’est pas toujours réussi. Le maître, c’est Uderzo, il a su user de ce gimmick avec une telle intelligence. Tout le monde a remarqué Kirk Douglas, Lino Ventura ou Sean Connery en agent secret dans Astérix.
Puis il y a John Travolta et Samuel L. Jackson, période Pulp Fiction !
On ne les voit pas beaucoup mais beaucoup de lecteurs me disent les avoir reconnus facilement. Les intégrer dans une histoire, c’est quelque chose que je n’aurais pas pu faire dans une série plus réaliste, cela aurait été du mauvais-goût. Jack m’en donnait la possibilité, un ton plus décontracté. En plus, dès qu’on les voit, on n’a pas besoin de les présenter, ils ont déjà une histoire, celle conférée par Tarantino, derrière eux.

© Reculé
D’autant plus que leur rôle dans Jack Wolfgang correspond à celui du film. Sans que cela gêne la lecture. C’est un jeu de référence et d’hommage. Comme je le fais avec une statuette de Tigresse (Kung Fu Panda) dans un coin d’une case. C’est un jeu avec le lecteur avec des hommages plus ou moins bien cachés dans l’album.

© Desberg/Reculé/Kattrin chez Le Lombard
Y’aura-t-il d’autres clins d’œil, arrivées de personnages bien connus du grand écran, dans la série ?
Ce n’est pas calculé. Pour le moment, j’ai découpé une trentaine de pages du second tome, vingt sont finies et je ne pense pas qu’il y ait des personnages du genre de Travolta et Jackson. Encore une fois, je n’ai pas envie que ce soit du mauvais-goût, juste une distraction. Cela dit, dans les scènes de foule, il y a certainement des clins d’œil.
Et un peu de Batman aussi, dans l’ambiance, non ?
Je suis un fan de Batman. Alors, quand je peux, je glisse une petite allusion ici ou là. Pas vraiment dans Jack. Cela dit, la scène d’entrée d’Antoinette évoque clairement Catwoman. Et notamment, cet album de Loeb et Sale, Catwoman à Rome. C’est en découvrant cet album et la travail de Tim Sale en gris (avant mise en couleur) que j’ai voulu faire de même sur Jack. On peut voir plus précisément une partie de ce travail sur Jack Wolfgang dans le tirage de luxe édité aux éditions Khani.

© Desberg/Reculé/Kattrin chez Le Lombard
C’est assez récurent avec moi. À chaque nouveau projet, avec Stephen, on essaye une méthode différente. La couleur directe sur les immortels, juste les crayonnés sur le Dernier Livre de la Jungle (tomes 1 et 2 encrés et mis en couleur par Johan De Moor). Sur Cassio j’étais revenu à un travail plus classique mais à l’ordinateur. Sur Jack, l’envie était de garder mon effet crayon, donner plus de profondeur à la couleur…
Des scénarii qui changent et sont modifiés autant de fois, vous en aviez vécu auparavant ?
Non, c’est la première fois que Stephen a dû revoir autant un scénario. Il y en a eu cinq ou six versions avant que nous en arrivions à un monde crédible où humains et animaux anthropomorphes cohabitaient. On a testé plusieurs approches car il nous importait d’aller au fond de la « bonne idée », à quelque chose qui avait tout son sens. Il ne suffisait pas d’importer des animaux dans une histoire d’humains.

Un extrait du tome 2, à l’opéra © Desberg/Reculé
Non, il fallait que l’histoire n’ait plus aucun sens si les animaux disparaissaient, s’ils étaient remplacés par des hommes. Le fait que des animaux soient nos héros devait donner la substance à l’histoire. Petit à petit, le fait que les animaux parlent et vivent dans un univers d’humains n’était plus un problème et il fallait surtout que le lecteur accepte ce postulat.
Entre-temps, il y a eu Zootopie.
Oui et on a un peu flippé. Quand j’ai eu vent de ce film Disney, notre projet était déjà bien avancé. Je ne me tiens pas toujours au courant des actualités cinéma et, à la sortie du film, je me suis rendu compte que les gens l’attendaient depuis… deux ans. Cette enquête dans un monde d’animaux qui ne se mangent plus entre eux, ça ressemblait à Jack Wolfgang. Stephen et moi-même, nous avons été le voir au cinéma… en gardant à l’esprit qu’en sortant de la salle, on abandonnerait peut-être notre projet. Ouf, l’aspect alimentaire était présent mais ils n’expliquaient pas de quoi les animaux se nourrissaient du coup. Nous, on a trouvé un substitut ! Et puis Zootopie c’est un monde purement animalier.

© Reculé/Kattrin
J’avais remarqué Sherlock Fox, paru chez Glénat en 2014, un autre album BD dans lequel la paix est de mise entre les animaux. Là encore, ce n’était pas comme dans notre histoire.
Cela dit, il y a plein d’autres dessins animés, BD avec des animaux…
… et arrive la difficulté de créer des personnages originaux. J’ai dû combattre ça. Après deux mois de recherches graphiques, je me suis ainsi rendu compte que je faisais mon loup comme je le faisais dans le Livre de la Jungle façon Disney… Notons que Jack Wolfgang est le seul loup de cette histoire et que je cherche des animaux plus rares : un tigre, un lion… Ceux qui auront des rôles importants.

© Reculé
Petit à petit, je me suis rendu compte que je ne devais pas enfermer mes personnages dans leur costume humanisés, les faire bondir, surgir, envoyer valser les chaussures et la cravate. Garder le côté animal, en fait ! Quant aux costards, c’est bien mais ça devait avoir un intérêt, pas juste être cool, encore plus quand nos personnages sont des animaux très poilus. Il ne fallait pas les enserrer. Sauf notre ours, l’un des méchants de l’histoire qui ajuste son costume pour jouer à l’humain !
J’ai eu pas mal de boulot pour le physique d’Antoinette, notre héroïne. J’ai beaucoup cherché, ça ne donnait rien. C’est en tombant par hasard sur une couverture de Tigresse Blanche de Didier Conrad, que j’ai été séduit par le côté moins réaliste et néanmoins élégant de son personnage féminin. Ça a été le déclic, la clé pour mieux développer notre panthère. On ne sait jamais d’où peut venir l’inspiration.

© Desberg/Reculé/Kattrin
Et Blacksad ? Oui, non ?
J’avais lu les deux ou trois premiers tomes à l’époque de leur sortie. Je n’ai pas voulu les regarder à nouveau, de crainte d’être trop influencé. C’est une BD animalière plus réaliste que ce qu’on peut voir habituellement. Quand Stephen est arrivé avec son histoire d’animaux, je ne pouvais pas refuser, j’ai toujours aimé dessiner des animaux. Mais étant donné que Blacksad reste une référence dans la BD dite animalière, il fallait absolument éviter toute ressemblance sinon l’aventure n’avait que peu d’intérêt. Jack Wolfgang existe pour ce qu’il est. Il n’est pas là pour réinventer le genre comme… Canales et Guarnido l’ont fait avec Blacksad.
Il ne fallait pas faire que ça, pas juste ouvrir une porte déjà ouverte. J’ai gardé ça à l’esprit dans mon approche graphique, plus personnelle, tandis que Stephen s’est efforcé d’approcher une histoire qui ne pouvait être racontée que dans cet univers mêlant humains et animaux.

© Desberg/Reculé/Kattrin
Jack Wolfgang rassemblera donc des tomes qui se veulent être à chaque fois des histoires complètes.
Exact ! Il n’y aura pas nécessairement de fil rouge. Dans une série, si tout se passe bien, les tomes 1 sont rarement les mieux dessinés. Mais quand on arrive au tome 10 d’une série à suivre, on se retrouve bien embêté de conseiller aux lecteurs de commencer par le tome 1 qu’on a depuis un peu renié. Le but est quand même de s’améliorer d’album en album. Depuis 1996, je n’avais jamais fait une histoire complète en un album, il était temps.
Autre première, ce fameux tirage de luxe. Le premier de votre carrière. Une sorte de reconnaissance ?
Une reconnaissance, je ne sais pas. Mais c’est sympa d’avoir un bouquin qui soit plus grand que la normale. Puis, dedans, en plus de l’album, il y a un dossier de 20 pages de recherches, et d’illustrations préparatoires.

© Reculé
Autre matériel ajouté, les couvertures. Aux prémisses, j’avais un seul projet de couverture que je pensais être le bon. C’était sans compter mon éditeur. J’ai donc fait deux propositions supplémentaires, assez définitives. Là encore, elles ont été recalées, parce qu’elles ne donnaient pas une idée assez précise de ce que véhiculait la série. Polar, aventure, thriller ? A partir de là le concept de la couverture, inspirée des James Bond des années 60 avec Sean Connery, est plus venu de l’équipe artistique du Lombard. Vous savez, ces affiches avec un personnage noir et blanc sur un décor dont la couleur était unie.
Du coup, il y avait le choix pour la couverture du tirage de luxe, avec une belle mise en valeur pour une des couvertures refusées. Sans doute donne-t-elle d’ailleurs mieux en grand format. Je dois avouer que j’aurais peut-être stressé si on m’avait demandé de créer directement une couverture pour le grand format.

© Desberg/Reculé/Kattrin chez Le Lombard
La suite s’annonce chargée : un tome 2 en 2018 et deux tomes en 2019.
Le deuxième tome sera Le Nobel du pigeon qui mettra en relation le Prix Nobel et, forcément, un pigeon. On va se dégager de la thématique alimentaire du premier tome, donc. Il y a eu un quiproquo, et on s’en est rendu compte lors de nos rencontres avec des journalistes [le second tome était déjà écrit], beaucoup pensaient que nous allions rester dans ce champ. Le côté gastronome leur parlait beaucoup. Mais pas du tout. Il y aura toujours quelques éléments dus à la profession de Jack mais sans s’épancher.
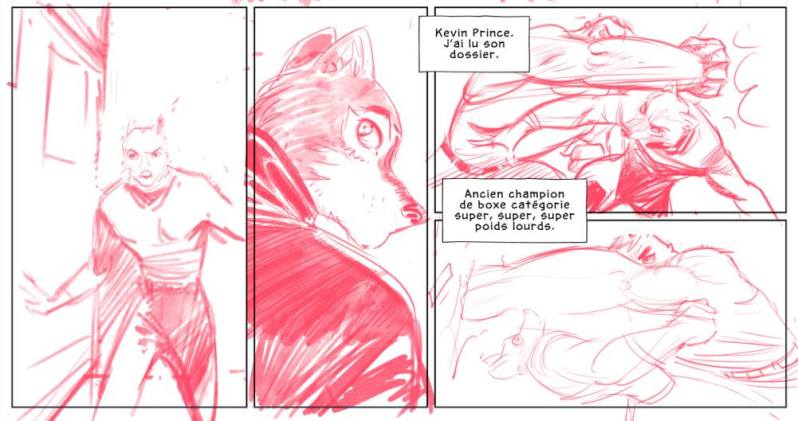
© Desberg/Reculé
Peut-être la recette présente en fin de tome et œuvre d’une candidate de Masterchef les a induit en erreur ?
La proposition initiale était de moi. Je trouvais ça chouette que, pour donner plus de vie à notre héros, on fasse comme si c’était vrai. En authentifiant son action via un article de critique, une recette. L’idée a fait son chemin et on s’est mis en tête de demander à quelqu’un dont c’était le métier d’intervenir. Et c’est ainsi qu’Audrey est arrivée dans l’aventure, a proposé sa recette de tofu qui s’est vue critiquer par Jack Wolfgang dans son prestigieux journal. L’idée au départ était de faire une recette par bouquin mais comme on se dégage de l’alimentation, peut-être devra-t-on trouver autre chose que l’alimentaire.
Ce deuxième opus va donc s’intéresser à la perception que l’on peut avoir des capacités d’un animal à l’autre. Un pigeon va être vu comme bête tandis qu’un renard sera rusé. Et un pigeon va vouloir changer les consciences… quitte à employer des méthodes radicales. On ne peut pas dire plus pour le moment.
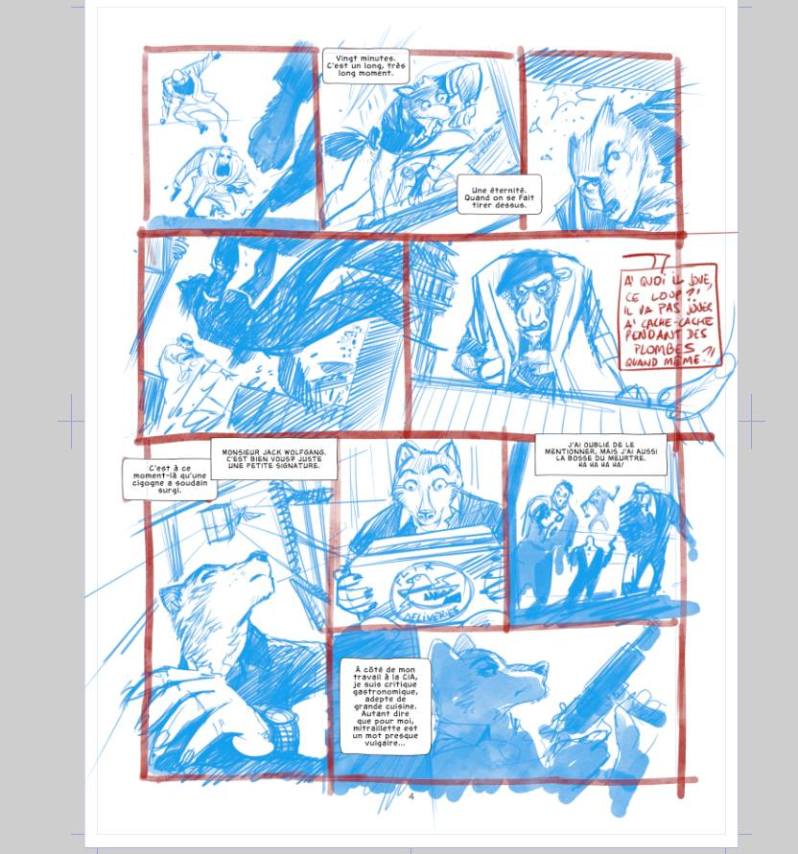
© Desberg/Reculé
Enfin, vous nourrissez un autre projet très personnel : Kunoïchi, un webcomic.
Une Kunoïchi, c’est une femme-ninja. C’est un projet que j’écris depuis quinze voire vingt ans, autour de ma passion du Japon. Forcément, il y a eu plusieurs versions de cette histoire mais cela fait un an ou deux que j’ai ma version définitive ou presque.
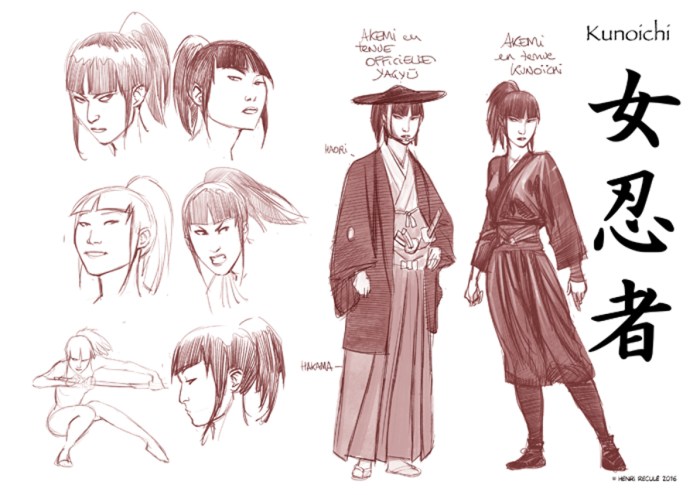
© Henri Reculé
C’est un projet très « fanboy » et donc très complexe à proposer. Et s’il n’y avait que moi que ça intéressait ? Dans un premier temps, je ne l’ai pas proposé aux éditeurs, je pensais qu’ils ne seraient pas intéressés. Or, le temps passant, j’ai vu différentes séries naître sur ce thème japonais. Certains auteurs avaient eu « moins de scrupule » que moi ! (Rires)
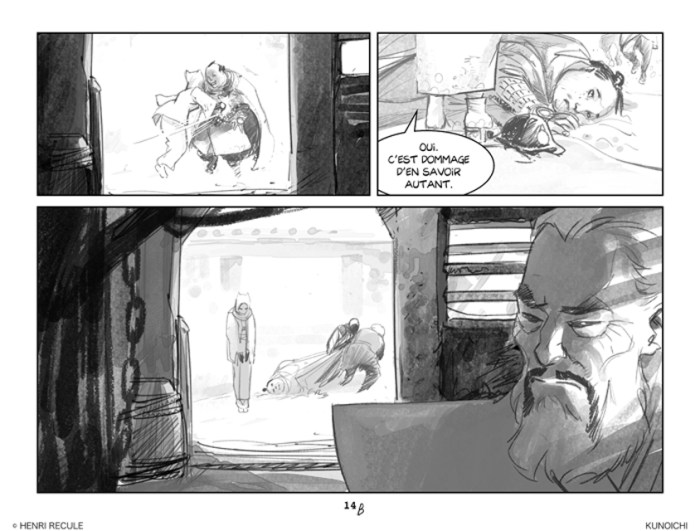
© Henri Reculé
Du coup, je n’ai plus voulu remettre mon projet au lendemain, de peur que le jour où je le ressortirais, le marché soit bombardé de séries de ce genre, qu’il se soit épuisé. Après, j’ai donc présenté mon projet à gauche et à droite, je n’ai pas vraiment eu de réponse positive. D’autant plus que je ne suis pas encore un dessinateur dont on peut acheter les yeux fermés tout ce qu’il fait juste sur son nom. Pour que les lecteurs viennent à moi, les thèmes que je mets en récit doivent plaire et je ne peux pas me permettre de faire n’importe quoi. Donc je réalise Kunoïchi, pour le moment, sous forme de webcomic, je le fais quand je veux et le peux surtout. 35 planches sont disponibles sur le site dédié.

© Henri Reculé
Cela dit, c’est compliqué à envisager puisqu’en tout l’histoire devait compter un ou deux gros bouquins. En faisant plein de concessions j’arrivais à 280 pages. Mais finalement, j’ai envie de raconter mon histoire comme je le sens sans tenir compte d’une pagination. Des pavés dans la veine des graphic novel américains. Avec peut-être 200, 300, 400 ou 500 pages qui ne compteraient que quelques images par planches. En noir et blanc, et gris, a priori.

© Henri Reculé
J’aime bien cette idée même si depuis que j’ai vu le dessin animé Miss Hokusai, très beau dans ses couleurs et ambiances, je me demande si je ne pourrais pas intégrer des couleurs qui ne soient pas trop sophistiquées à mon projet. Le problème étant le nombre de pages. Je me suis renseigné sur la possibilité de le faire en autoédition, ce n’est pas impossible que je passe par là, ça limite les frais.
Et l’histoire ?
Nous ne serions ni dans l’aventure, ni dans le récit de samouraïs ni même dans la philosophie japonaise trop souvent rendue cliché par les albums s’y intéressant. La prémisse c’est: « une femme assassin fait équipe avec un policier non-violent pour arrêter un tueur en série et découvre la valeur de la vie humaine. »
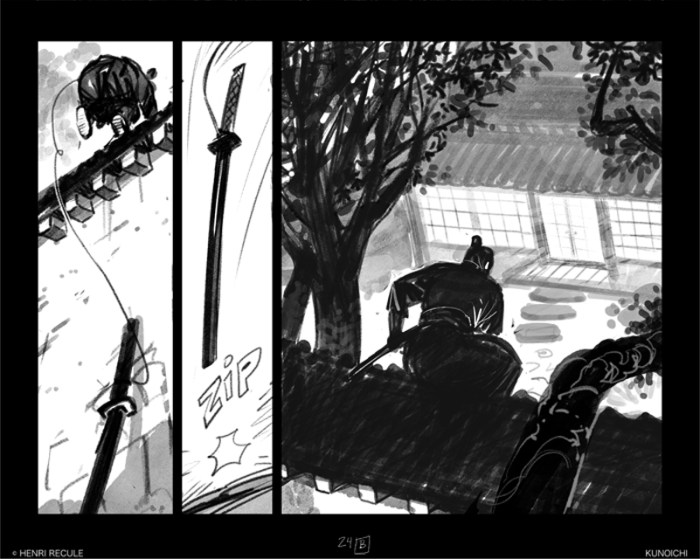
© Henri Reculé
Sur un fond historique, Edo au début du XVIIème siècle, nous suivons une enquête sur des assassinats menée par un duo composé d’une kunoïchi et d’un policier. Au fil des pistes, des suspects, j’ai envie de montrer le Japon de cette époque à travers des détails peu connus. Notamment le fait que les policiers, samouraïs de classe inférieure, devaient arrêter un samouraï présumé coupable sans le blesser. D’où en quelque sorte les arts martiaux permettant de combattre à mains nues et sans utiliser son sabre. Dans mon esprit, c’est plus un polar qu’une histoire de samouraï.
On a hâte de découvrir ça en tout cas !
Propos recueuillis par Alexis Seny
Série : Jack Wolfgang
Tome : 1 – L’entrée du loup
Scénario : Stephen Desberg
Dessin : Henri Reculé
Couleurs : Kattrin
Genre : Anthropomorphe, Action
Éditeur : Le Lombard (édition de luxe chez Khani)
Nbre de pages : 64 (80 pour la version de luxe)
Prix : 13,99€ (150€ pour la version de luxe)

Il y a quelques années, c’est marqué dans la chair et dans l’esprit que j’avais terminé de lire Le joueur d’échecs de Stefan Zweig pour l’école. Une nouvelle pour marquer le passé, le présent et sans doute le futur car on est jamais à l’abri des retours de flammes de l’Histoire. Laissant la force des mots, terribles, à Zweig, David Sala a opté pour la force des traits et du pictural pour livrer son adaptation formidable de sens. De ces bandes dessinées qui prouvent toute leur capacité à adapter un roman.

© David Sala chez Casterman
Bonjour David, cela fait quatre ans qu’on ne vous avait pas lu en BD. Votre retour fait plaisir, encore plus avec un album comme Le joueur d’échecs. Quatre ans, c’est le temps qu’a pris la réalisation de cet album ?
Non mais j’ai une espèce de travail à deux têtes. Je suis aussi illustrateur jeunesse, j’aime naviguer entre les deux formats.
Le joueur d’échecs, c’est une institution, quand même ! Vous vous rappelez de la première fois où vous l’avez lu ?
Et comment ! Mon amour pour ce roman date d’il y a très longtemps. Je l’ai lu quand j’étais étudiant. Je l’ai relu pour préparer cet album, et il m’a peut-être encore plus frappé. Par son thème, le monde décrit, le lien entre les années 40 et maintenant, la naissance d’une pensée nauséabonde jamais très loin.

© David Sala chez Casterman
Vous n’aviez jamais songé à l’adapter auparavant ? Ou, plutôt, est-ce le fait d’avoir adapté Cauchemar en rue pour votre précédent album qui a fait déclic ?
Oui, cette adaptation de Robin Cook m’a donné le courage. Il y a des appréhensions, j’étais rempli de doutes à l’idée de m’attaquer à un tel auteur, lu partout dans le monde.
Dès mes vingt ans, j’ai ressenti que c’était un texte fort mais je ne m’en sentais pas capable. Maintenant, par inconscience, je trouve que c’est bien de se faire peur, de se mettre en danger, de se donner un Everest.
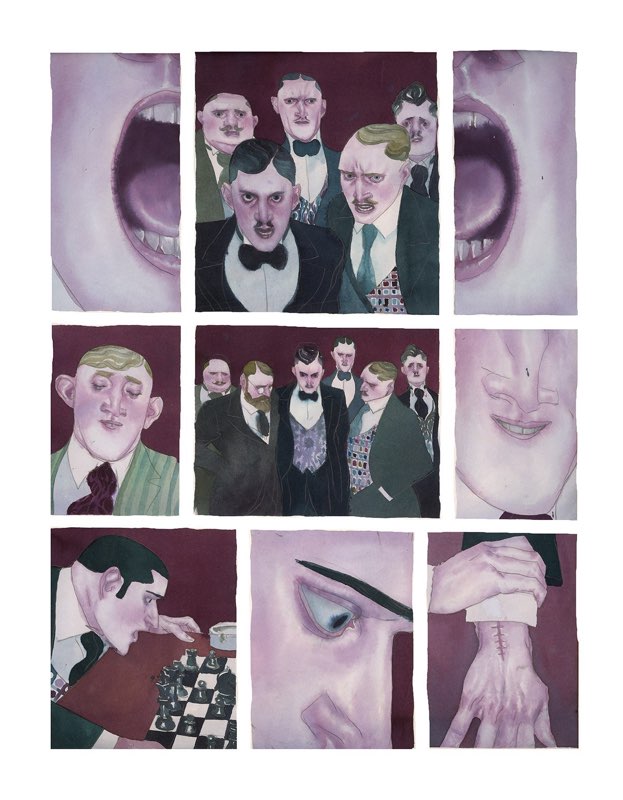
© David Sala chez Casterman
Du coup, comment vous y êtes-vous pris ?
Il faut ne pas y penser. J’ai une approche très instinctive, je ne suis pas un technicien. Il fallait être au plus juste, fidèle dans l’absolu. C’est un jeu de réflexion, on n’y parle pas beaucoup. Il y a cette scène de huis clos menée par les jeux de regard. Il s’agit de restituer l’atmosphère, la tension sans ennuyer le lecteur.
Du coup, comment naissent les personnages ?
C’est de l’ordre de la fulgurance. Monsieur B., Zweig en fait une courte description dans le roman, il est blanc et a les traits anguleux. À un moment, il m’est apparu. Je me fie à l’instant.
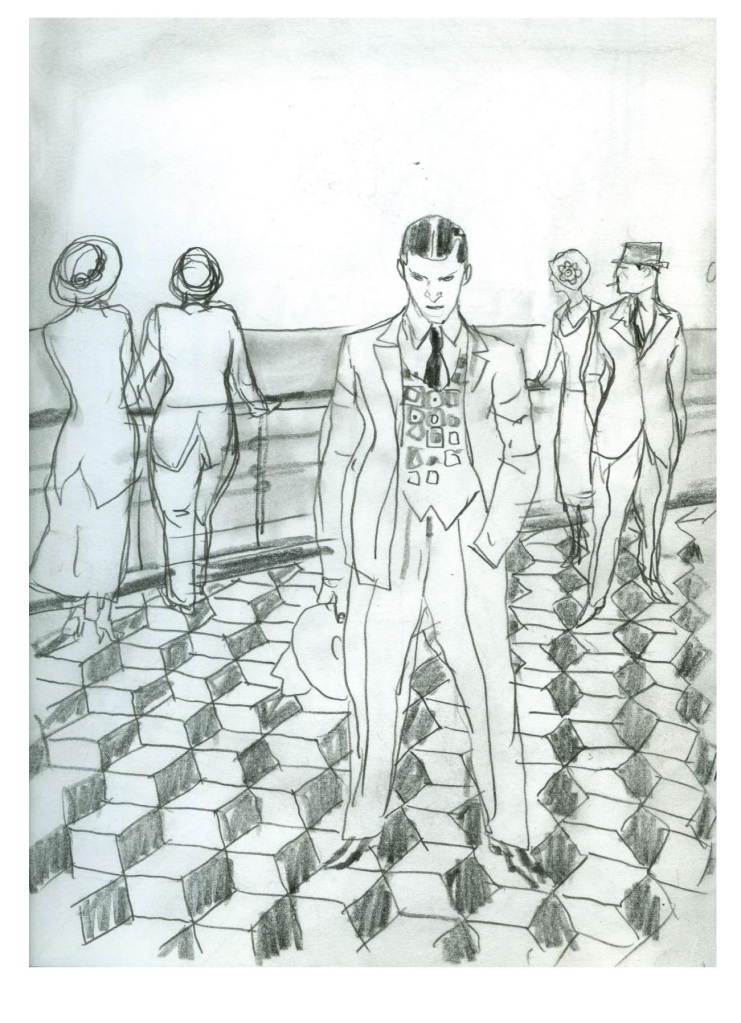
© David Sala chez Casterman
Finalement, ce Monsieur B. reste plutôt énigmatique, on ne le connait que durant le temps qu’il reste sur le bateau et ce qu’il veut bien dire de son passé. Comment le voyez-vous ?
Comme un homme brisé. Il y a eu un avant et un après son incarcération. Ce qu’il est désormais, il ne l’est devenu que par la violence et la brutalité de la Gestapo. Avant ce drame, on imagine un homme équilibré, cultivé, suffisamment brillant que pour s’en sortir?
Et au jeu des couleurs.
C’est un univers. Tout se passe sur un bateau. Je l’ai enrichi, j’ai créé une atmosphère. Avec des couleurs, qu’elles soient bleutées ou tirant sur le violet, le rose. J’aime raconter par les couleurs, qu’elle nous éblouisse sur le pont du bateau alors que dans le roman, ces scènes-là se passent plutôt de nuit.

© David Sala chez Casterman
Et les couleurs qui ont un rôle dans la manière dont vous insinuez les flashbacks.
Oui, je comptais sur les couleurs, tout en simplifiant au maximum le dessin avec le moins de traits possible, le moins de plis dans les vêtements, sans ombre portée. Quelque chose de très simple qui jouait sur les contrastes tout en essayant d’épurer.
Du coup, on sent bien que si les traits sont plus flous, ces images, marquantes, ne sortiront jamais de la mémoire de B.
Je voulais, par ce traitement graphique, aussi créer un contraste en le monde intérieur, torturé, et le monde extérieur, sur ce bateau où il y a de la joie, de la beauté, un côté luxueux et élégant. Il fallait aussi contrebalancer la noirceur de ce récit. B est seul parmi les autres, il porte son histoire de manière muette, plus subtile.

© David Sala chez Casterman
Vous documentez-vous ?
De manière générale, je me documente beaucoup. Pour le coup, ici, j’avais assez peu de choses, des bouts de photos pour reconstituer. Le but n’est pas que ce soit un livre historique. Alors oui, certains vêtements correspondent plus aux années 20 qu’aux années 40 mais je voulais plus coller aux années glorieuses.
Dans la manière dont vous faites ressentir l’enfermement, vous multipliez les cases et les plans sur le malheureux personnage, j’ai un peu pensé à ce qu’à fait Guy Delisle dans S’enfuir.
Ah, je ne sais pas, je ne l’ai pas lu. Toujours est-il que la mise en scène devait être au service de la narration. En mettant douze cases sur une même planche, je pouvais représenter la solitude, le temps qui passe sans avoir recours aux mots. Bien sûr, ceux de Zweig sont magnifiques et inimitables. Mais en BD, je devais m’en passer, raconter par l’image sans recours aux mots.
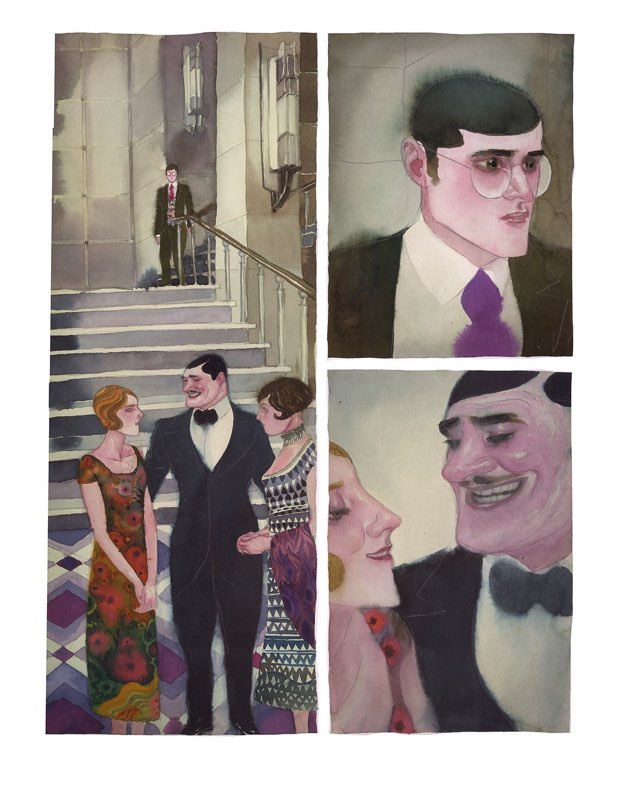
© David Sala chez Casterman
Vous jouez aux échecs ?
Je déplace les pions mais, non, je n’y joue pas.
Pourtant vous arrivez à reproduire ces parties d’échecs de manière mémorable. Et il y a finalement des damiers un peu partout, sur les tapis, les motifs des murs, la couverture d’un lit…
L’idée, c’est d’être enfermé dans cette histoire. Sans doute y’a-t-il dans ce que j’ai fait une part de conscience et une autre d’inconscience. Mais je voulais qu’on soit avec les personnages, qu’on traverse et qu’on se laisse aller. Mais toujours dans une seule et même direction, celle du dessin et des couleurs.

© David Sala chez Casterman
Il y a cette 85ème planche où B se démultiplie.
C’est une manière de retranscrire son état mental. Les mots sont plus forts que l’image, la littérature a cette force. Il me fallait quelque chose qui s’en rapproche et ce visuel s’est imposé assez rapidement.
Avec une scène plus dure à dessiner que les autres ?
Les scènes d’enfermement, quand le personnage sombre, qu’il faut faire ressentir le pourquoi.
Finalement, comment expliquez-vous qu’on parle encore aujourd’hui de ce qui fut la dernière oeuvre de Zweig ?
C’est quelque chose d’important, un texte qui parle de la dictature, de la victoire de la brutalité sur l’esprit. On ne peut qu’être sensible au personnage à la souffrance qui le traverse. Encore plus à l’heure où on parle tous les jours de replis identitaires, de la volonté de certains à imposer leur point de vue de la manière forte. Le Joueur d’Échecs, c’est un roman très original porté par une formidable plume.
Pour se rendre compte de votre travail, il y a ce chouette cahier bonus en fin d’album.
Ce sont les coulisses, l’arrière-cour.

© David Sala chez Casterman
Et si on va plus loin dans ces coulisses ?
Mon atelier est chez moi, sous les toits. Un espace assez confortable avec plusieurs tables, une table lumineuse, une grande table à dessin d’architecte. Un espace suffisamment vaste pour qu’un chevalet puisse y tenir et que je puisse ranger mes dessins. Il y a de la musique, la radio, des émissions, je laisse filer. J’ai des disques aussi. Mais, quand je dois mettre en place des choses importantes, je me mets dans ma bulle et ne laisse plus rien rentre de l’extérieur.

© David Sala chez Casterman
À d’autres moments, c’est du travail par petites touches. La nuit aussi. Il est fréquent que je me réveille pour aller à ma table à dessin… quand mes pensées me laissent dormir. L’entre-deux entre la veille et le sommeil est propice à l’imagination…
… fertile, dans votre cas ! Merci David et à bientôt.
Propos recueillis par Alexis Seny
Titre : Le joueur d’échecs
D’après la nouvelle de Stefan Zweig
Scénario, dessin et couleurs : David Sala
Genre : Drame psychologique
Éditeur : Casterman
Nbre de pages : 128
Prix : 13,99€

De New-York au Yucatan en passant par cette bonne vieille Europe, le monde bédéphile ne peut ignorer le millionnaire à la main sur le coeur, Largo Winch. Trois ans après sa dernière aventure scénarisée par Jean Van Hamme, l’aventurier n’a diablement pas dit son dernier mot et revient dans une histoire menée tambour battant et Dow Jones trébuchant. Nous avons rencontré Éric Giacometti (en quelque sorte, « l’héritier ») et Philippe Francq.
Bonjour à tous les deux, c’est un plaisir de voir Largo Winch revenir en si bonne forme. Et, mine de rien, ce tome 21, on en parle depuis très longtemps. Ça vous a mis la pression ?
Philippe Francq : Pas le moins du monde. Quand j’ai proposé à Éric de reprendre la suite de Largo Winch, il y avait des petites choses à éclaircir. Notamment, cette fameuse histoire du tome 20, cet attentat à Londres, qui se terminait sur un mystère, une fin non-élucidée. Jean Van Hamme terminait en dévoilant l’identité de celui qui avait perpétré l’attentat à Londres mais on restait sur notre faim par rapport aux réelles motivations du Russe. J’étais impatient de répondre à ces questions.
Les réponses, les aviez-vous, Éric ?
Éric : Non, j’ai pris six mois pour écrire ce scénario, beaucoup de temps. Un luxe que je pouvais me permettre parce que je suis, par ailleurs, romancier et que je m’étais pris de la marge. Ça m’a demandé beaucoup de temps parce qu’il fallait trouver une nouvelle histoire pour ce personnage si fort qu’est Largo Winch. En soi, il y avait déjà cette pression. Puis, en plus, il fallait que je trouve une solution à un problème que je n’avais pas initié. Ça a pris du temps.

Photo © Chloé Vollmer
Pourtant, à l’inverse du temps que vous avez pu prendre pour concevoir cet album, je trouve que Largo est ici confronté, avant tout, à la vitesse, à l’ère de la rapidité. La vitesse à laquelle la bourse et le Dow Jones peuvent s’écrouler. Mais aussi la vitesse des réseaux qui peuvent répandre très vite une photo du milliardaire en mauvaise posture face à des manifestants. Peut-être n’y était-il pas si habitué que ça, à cette vitesse. Si habitué que nous, en tout cas, hommes modernes que nous sommes.

© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
Philippe Francq : Cet album est voulu comme un reflet plus exact de notre réalité quotidienne.
Éric : L’irruption de la technologie, qu’elle soit quotidienne ou haute-technologie, dans le monde de Largo, c’est véritablement cette ère de la vitesse. Puis, vous savez, maintenant, il y a les séries télé, elles sont rapides, tout va très vite. Je ne veux pas faire du 24h chrono, mais oui, c’est intentionnel, parmi d’autres choses.
Philippe Francq : C’est ce que j’avais laissé sous-entendre, il y a trois ans, quand Jean avait annoncé sa volonté d’arrêter la bande dessinée pour se consacrer au théâtre. J’avais laissé sous-entendre qu’on ferait rentrer Largo dans le XXIème siècle. C’est chose faite !

© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
Est-ce facile de faire rentrer un héros qu’on a l’impression de connaître depuis toujours dans une époque plus moderne ?
Éric : Oui ! Parce que ce héros créé il y a quelques décennies, il est terriblement moderne. Par rapport à d’autres héros défraîchis, Largo est toujours en plein coeur de l’actualité. C’est ça qui est génial dans ce qu’a fait Van Hamme avec ses personnages. Parce que c’est un chef d’entreprise, un grand patron… pétri de contradictions, il a des valeurs éthiques, par-dessus tout. Et ça, c’est plus que jamais d’actualité.
Quand il dit qu’il ne veut pas délocaliser, qu’il veut se refiscaliser et payer ses impôts – il y a eu les Panama Papers entre-temps, tous ces scandales sur les paradis fiscaux -. On peut donc le faire évoluer dans cette modernité. Il n’est pas figé dans le temps. Quand on le fait se balader dans l’univers de la haute technologie, de la finance ou de la bourse, c’est tout à fait cohérent : son groupe n’a jamais été coté en bourse, il se croyait protégé mais non, pas du tout, on peut maintenant être vulnérable. Pour un scénariste, c’est un personnage presque éternel, parce que le monde financier, le monde économique ne va cesser de bouger au fil des décennies.

© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
Cela dit, le monde de la finance, de l’économie, ne va-t-il pas plus vite que le temps de création d’un album ?
Philippe : Ça, c’est sûr ! Quand Éric a écrit le scénario, il y a deux ans, le Dow Jones était à 16 000, 17 000 points, et au moment de clôturer la couleur de l’album, on m’a appelé pour me dire qu’il fallait réactualiser les chiffres. Depuis la victoire de Trump aux élections, le Dow Jones avait gagné 3000 points, nous étions donc dans les sphères de 19 000 à 20 600. J’ai rectifié le tir pour que l’album, à sa sortie, soit le plus proche d’une réalité du… moment, qui peut évidemment être très vite dépassée par une nouvelle actualité.
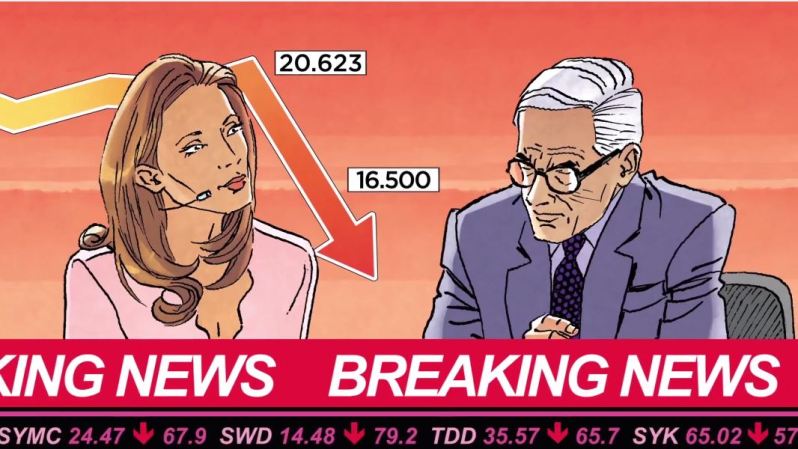
© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
D’autant plus qu’avec L’étoile du Matin, vous revenez à un propos économique costaud. Ce n’est pas la bande dessinée qu’on lit avant de dormir et sur laquelle on va s’endormir après dix planches. Il faut s’installer et être concentré.
Éric : Je me suis inspiré de ce qu’avait fait Van Hamme. L’ADN de Largo est dans des albums comme O.P.A. avec des planches entières sur les techniques d’O.P.A. C’est un album qui alterne des temps de lecture différents. Certains plus courts, d’autres qui demandent de se poser un peu. Une sorte d’alchimie. On ne peut pas faire que de la pédagogie ou que de l’action. C’est un dosage qui fait que, tous les X pages, on va proposer de raconter quelque chose sur le monde qui nous entoure. Ou du moins, une certaine vision de l’univers économique.
Vous, Éric, comment êtes-vous tombé dans ce monde de l’économie que vous avez intégré que ce soit en tant que journaliste ou romancier ?
Éric : J’ai été journaliste dans la presse grand public, j’ai fait plusieurs domaines : dans l’investigation en matière de scandale en santé publique, des sujets de société puis, les dernières années, j’ai été au service économique – je n’étais pas économiste de formation – comme chef de service, je travaillais avec d’autres journalistes, et j’ai découvert un univers extrêmement riche. C’est ce qui m’a fasciné, loin de certaines caricatures. L’économie, ça peut être très conflictuel, ça peut être dur mais des choses incroyables s’y passent également. Des success story formidables comme des saloperies infinies aussi.
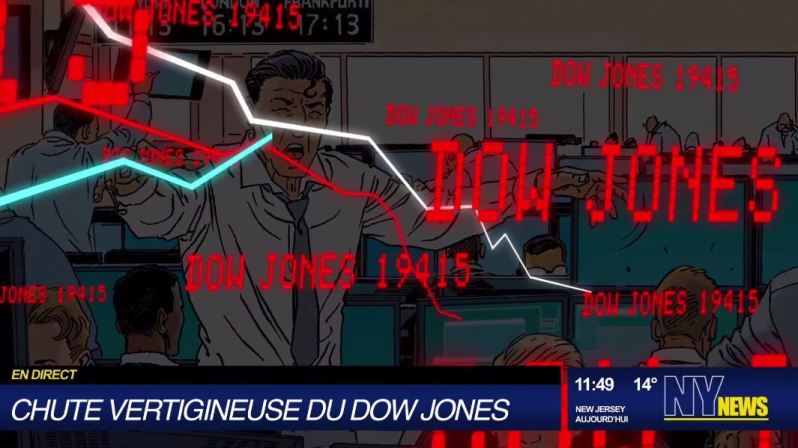
© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
Cette richesse-là profite au scénario. Ainsi, dans l’album, on commence par un flash-crash, le Dow Jones chute et puis rebondit. Ça, je l’ai vécu en direct le 6 mai 2010. À l’époque, l’information officielle voulait qu’un trader fou qui a confondu billion et million. Tout le monde a gobé ça avant qu’on ne se rende compte que le coupable était le trading à haute-fréquence, des algorithmes, ce qui n’a fait que témoigner de la puissance des ordinateurs qui avaient pris le pouvoir dans ce milieu. Ordinateurs qui travaillent d’eux-mêmes, avec toutes sortes d’intelligences artificielles. Bref, c’était un fantastique sujet qui a fait son chemin jusqu’au présent album.

© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
Par rapport à vos précédents albums et romans; avoir le personnage de Largo Winch en mains vous permet-il de lâcher du lest, de pouvoir aborder n’importe quel sujet économique, ou de manière plus précise, parce que le lecteur sait à quoi s’attendre ?
Éric : Depuis 2012, je ne suis plus journaliste, je suis désormais auteur de thriller. Avec Jacques Ravenne, nous avons déjà utilisé des thèmes comme les zones de hautes-technologies, de manipulation… Je m’en suis toujours servi et nourri mes romans avec de l’économie. Nos romans sont publiés dans dix-huit pays et mon co-auteur vient de partir au Japon, on lui a fait tout un article prouvant qu’ils ont, là-bas, les mêmes préoccupations que nous. On se nourrit donc en permanence de l’actualité.

© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
La seule différence étant que mes thrillers sont plutôt ésotériques et technologiques tandis qu’avec Largo, on est dans le domaine économique. Mais, le cheminement de pensée, l’extraction d’une réalité économique vers la fiction, c’est le même processus.
Et vous Philippe, dans cet album, au-delà de la première séquence saisissante, le spectaculaire et l’action en tant que tels n’arrivent véritablement que plus tard dans l’album. Avant ça, c’est dans la chute du Dow Jones, au coeur de la Bourse, que le spectacle et la tension se font. Comment avez-vous appréhendé cette séquence ?
Philippe : (Il sourit) C’est avant tout de l’observation. La représentation que je peux m’en faire, les films que j’ai pu voir… et un ancien trader libanais qui est à la retraite – enfin, c’est un grand mot quand on a trente ans – et s’est reconverti dans la production de confitures de luxe. Parce qu’il avait fait le tour du monde du trading et que c’est une activité épuisante, 24h/24. Il nous a donc amenés, très gentiment, à Londres et nous a permis de visiter certains étages de banques où le trading à l’ancienne est encore d’actualité, les ordinateurs, les écrans et toute l’imagerie d’Épinal qui est générée et que tout le monde a en tête. Le reste, c’est évidemment un travail d’imagination. Je greffe là-dessus mon action.
Notez que ce jour-là, nous sommes arrivés vers midi, assez tard finalement, on m’a par exemple expliqué que l’ambiance n’était pas extraordinaire entre les traders encore présents sur le plateau parce que la moitié des traders s’étaient fait dégager et avaient repris leurs cartons, comme on voit dans les films. Nous serions arrivés un peu plus tôt, nous les aurions croisés dans les ascenseurs.
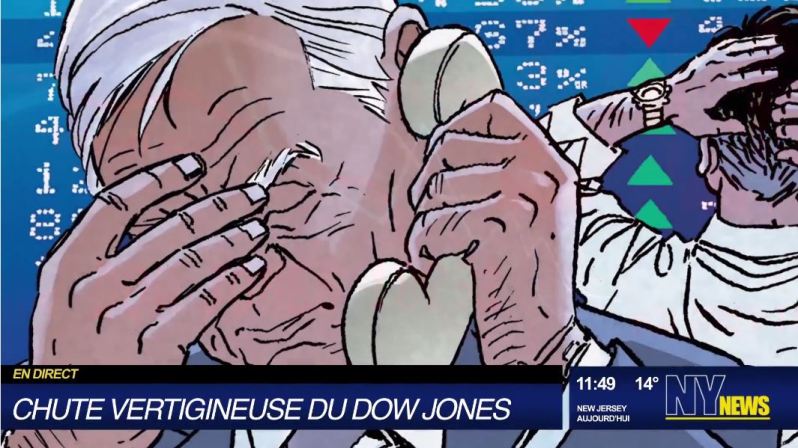
© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
Pensez-vous que Largo Winch a éveillé des passions, des envies de travailler dans ces mondes qu’ils traversent ?
Éric : C’est la première fois qu’on parle de trading dans Largo Winch. Ce côté finance à l’état pur, on l’a vu évoluer au début avant que Jean n’emmène le personnage vers d’autres sphères : l’aéronautique, la marine marchande… Là où ça devient fascinant, c’est ce côté glamour que Largo a revêtu, lié à la lourde responsabilité de Philippe.
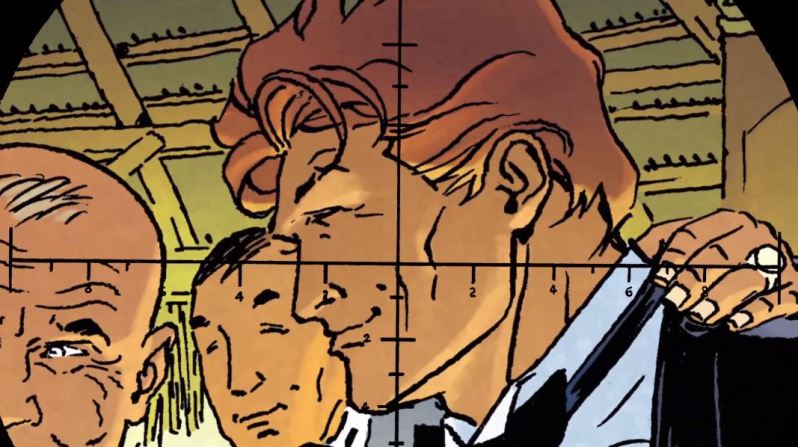
© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
Philippe : On a évidemment une connaissance des lecteurs à travers les chiffres que communique l’éditeur mais on a rarement l’occasion de les rencontrer, si ce n’est lors des séances de dédicaces. C’est un de ces jours-là, il y a très longtemps, qu’a choisi un lecteur pour venir me parler. Il m’a dit : « Je vous dois mon avancement et une situation professionnelle extraordinaire grâce à la lecture de L’Héritier, du Groupe W. » Je l’ai regardé éberlué: « Comment? » Il m’a expliqué être désormais inspecteur des impôts après avoir longtemps été dans un petit bureau sombre de Bercy où il faisait de l’inspection d’entreprise. Et, un jour, après avoir lu les premiers Largo Winch, il s’est intéressé au cas de quelques sociétés à Levallois-Perret qui, apparemment, avaient une fiscalité douteuse avec des comptes offshores aux Îles Caïman. Il les a redressées avec un taux de réussite et de rendement plus important que ses collègues.
Peu après, devant son petit bureau, le directeur de Bercy s’est pointé en le félicitant pour ses chiffres étonnants, qui l’avaient mis en valeur, et en lui proposant de travailler avec l’IRS à l’international. Il n’a pas dit non. Un exemple bien concret d’un lecteur qui a changé son destin grâce à Largo.

© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
À l’heure où la bande dessinée raconte de plus en plus de choses sur le monde qui l’entoure, que ce soit en documentaires, en reportages ou en ouvrages historiques ou autobiographiques, cette sorte de docu-fiction qu’est Largo Winch ne fait-elle pas office de précurseuse ?
Philippe : Jean Van Hamme a été précurseur de beaucoup de choses en bande dessinée, non ? C’est vrai qu’après les tout premiers Largo, il y a eu une sorte de renouveau du Neuvième Art. Beaucoup de scénaristes se sont engouffrés dans cette veine, en se rendant compte qu’on pouvait raconter autre chose que des histoires historiques ou futuristes et on a vu fleurir un certain nombre de séries aux préoccupations très contemporaines.
Tous les deux, quels albums vous ont marqué ?
Éric : J’ai biberonné, quand j’étais gamin, à Spirou. Après quoi, je suis passé aux comics américains ainsi qu’aux tout grands que tout le monde connaît : Blake et Mortimer, etc. Récemment, je me suis remis sur le tard sur d’autres séries de Van Hamme, notamment. Le jour du soleil noir, le premier des XIII, par exemple. C’était il y a dix-huit ans et ça m’a redonné le goût à la BD. J’apprécie de tout mais j’ai tendance à relire des classiques, avec une passion particulière pour tout ce que fait Alan Moore, ça n’a rien à voir avec l’économie et l’univers de Largo. J’ai aussi récemment découvert une excellente BD, dans le style docu-fiction, sur mon ancien métier de journaliste : La machine à influencer de Brook Gladstone qui décrit les pratiques journalistiques, l’évolution… J’ai appris plein de chose sur mon métier.

© Gladstone/ Neufeld chez Ça et là
Je suis assez éclectique mais je dois admettre que je suis très sensible au dessin. Si le dessin ne me plaît pas, je suis incapable de rentrer dans l’album. Et peut-être ai-je un peu de mal avec certains romans graphiques où le dessin est très elliptique. Moi, j’ai besoin que le dessin soit, si pas sophistiqué, travaillé. Parce que quand votre imaginaire a été façonné par des grands noms de la BD, des Pratt, des Hergé ou Kirby; venir après avec un dessin un peu à l’emporte-pièce, même si le scénario est excellent et qu’une nouvelle génération en a fait sa marque de fabrique, ce n’est pas évident. Quand je suis revenu à XIII, un des éléments qui l’expliquaient, c’était le dessin de Vance, j’avais lu Bruno Brazil avant. C’est ce qui m’a amené aux scénarii imparable de Van Hamme. Je suis peut-être old school et je sais que tout le monde ne partagera pas mon avis, mais le dessin, c’est ma porte d’entrée vers un album.
Philippe : De mon côté, plein de choses, très hétéroclites, également. Manu Larcenet, tous les classique de Cossey, Hermann, Hergé… J’ai lu énormément de choses quand j’étais jeune, tout et même n’importe quoi. Ce qui permet de se faire une culture BD vaste et large. Je dis toujours : on n’apprend plus de choses en lisant des mauvais albums qu’en lisant des très très bonnes. De la même manière qu’on voit plus facilement les défauts d’un mauvais film que dans un chef-d’oeuvre. Pour évoluer dans ce métier, il faut s’inspirer de tout.
Éric : En y réfléchissant, ce que je vous ai cité est un peu vieux, mais j’ai dévoré récemment L’Arabe du futur de Riad Sattouf. J’ai plus appris sur la Syrie avec ce bouquin que dans les reportages, parole d’ancien journaliste. Vraiment, j’ai été bluffé. Comme avec Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle. Effectivement, le dessin n’est pas à comparer à celui de Philippe mais il y a autre chose, un vrai contenu. Puis, en matière économique – il n’y a pas tant de BD que ça consacrées à ce champ -, j’ai beaucoup aimé IRS, c’est bien fait.

© Riad Sattouf chez Allary Éditions
Vous, Philippe, je lisais que vous aviez une structure, une grammaire que vous avez imposée à Éric : pas plus de 10-11 cases par page, un nombre maximum de lignes de texte… Comment êtes-vous arrivé à ces règles ?
Philippe : C’est un encombrement juste physique : après onze images, la douzième, je ne saurais pas où la caser. C’est vrai qu’en moyenne, une planche normale contient entre sept et huit images. On peut aller jusqu’à onze. Pareil pour le nombre de caractères. Il faut se limiter à un certain nombre de lignes. Ce qui est plus difficile, finalement, c’est de caser la totalité d’une histoire en 46 planches. Une approche sans doute plus difficile pour Éric, plus habitué aux romans où le découpage n’est pas déterminé à l’avance. En BD, le nombre de pages détermine le prix qui lui-même détermine le nombre de planches. Et si on ne veut pas augmenter le prix de l’album d’un quart ou un tiers, il faut se tenir à trois cahiers de 16 pages. Sous peine de vendre l’album plus cher et de perdre une partie des lecteurs.
Il y a quand même une double-planche quasiment muette dans cet album. Enfin muette… l’action parle pour elle, au pied du temple, Largo doit fuir une horde de manifestants.
Philippe : Je vois laquelle ! Il y a des moments comme ça où j’aime surprendre le lecteur et amener de la tension. Une scène de poursuite, ça s’y prête bien à côté de planches beaucoup plus plan-plan où le dessin compte moins que ce qui est expliqué.

© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
Donc, je préfère ne pas trop distraire mon lecteur et le garder dans un plan très classique et monotone. Peut-être que beaucoup de gens confèrent beaucoup d’importance au dessin en bande dessinée, à tort, parce que ce qu’on lit en tout premier lieu dans une case, c’est le texte tandis que l’oeil balaye très rapidement l’image. On attaque le texte avant tout, et à la deuxième case, rebelote. On lit une BD de manière pas si différente qu’un roman. Avec juste un balayage rapide. Ce n’est qu’à la deuxième lecture, quand on connait l’histoire, qu’on commence à s’intéresser au dessin. Une méconnaissance de ce fonctionnement serait dommageable pour l’histoire, la fiction en elle-même. Si je ne respectais pas cette mécanique, il aurait peut-être plus de mal à finir l’album. La place du texte est primordiale.

© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
Pour terminer, je lisais que Largo pourrait encore plus rentrer dans l’actualité avec Facebook, Google… C’est le menu des prochains épisodes ?
Philippe : C’est prévu, on va réorganiser quelque peu l’organigramme du groupe Winch. Regardez ne fût-ce qu’aux côtés du pétrole qui est une vieille source d’énergie. On devrait peut-être y rajouter certaines subdivisions. Se priver de certaines et en faire rentrer d’autres, comme des start-up. Effectivement, certaines pourraient avoir des airs d’Amazon, Facebook ou Google. Plus moderne, quoi ?

© Van Hamme/Francq chez Dupuis
Et vous, Éric, ce premier tome (peut-être refondateur tout en restant dans la continuité) vous a-t-il libéré. Les prochains tomes seront-ils plus faciles à écrire ?
Éric : Quand j’ai planché sur ce nouvel album, j’ai décrypté le précédent avec l’oeil du professionnel. Il faut savoir que, pour devenir scénariste, j’ai fait des formations (au cinéma aussi). Et je me suis aperçu que les mécanismes de narration de Van Hamme sont redoutables et diaboliques. Complet et simple, à la fois. Un véritable savoir-faire qu’il faudra continuer de faire valoir quitte à l’intégrer à d’autres univers. Mais ça va demander du boulot. Ce challenge à relever m’a pris plus de temps que prévu. Quand j’écris un roman, si j’ai besoin de cinquante pages de plus, ce n’est pas un problème, l’éditeur n’ira pas contre. Avec Largo, tout doit rentrer dans deux fois quarante-six planches. La mécanique est là, il faut y mettre la rigueur et une hyper-créativité pour ne pas refaire ce qu’a fait Van Hamme. L’exercice de style n’était pas si simple. Comme je ne suis pas un génie, ça me prend du temps.
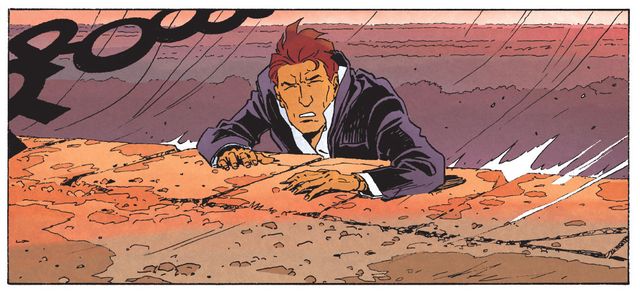
© Giacometti/Francq/Guillo chez Dupuis
Merci beaucoup à tous les deux et merci d’avoir emmener Largo là où on ne l’attendait peut-être plus !
Propos recueillis par Alexis Seny
Série : Largo Winch
Tome : 21 – L’étoile du matin
Scénario : Éric Giacometti
Dessin : Philippe Francq
Couleurs : Philippe Francq et Yoann Guillo
Genre : Aventure, Thriller, Économie
Éditeur : Dupuis
Nbre de pages : 48
Prix : 13,95€

À petits pas de petits rats de l’opéra ou dans les mouvements amples de danses plus urbaines, Jérôme Hamon et Léna Sayaphoum écrivent et dessinent l’histoire d’Emma et Capucine, deux danseuses que tout pourrait peu à peu séparer si elles n’étaient pas soeurs. Dans cette série jeunesse mais pas que, les deux héroïnes, pas toujours bien dans leurs chaussons et leurs baskets, doivent parfois s’affranchir des rêves de leur mère, lâcher du lest, faire face aux déconvenues, travailler toujours plus, tester les limites de leurs envies… C’est beau et souriant, le deuxième tome vient de paraître, nous en discutons avec les deux auteurs.
Bonjour Léna, bonjour Jérôme, avec Emma et Capucine, vous nous emmenez dans l’univers de la danse. Bien plus loin que l’aspect sportif, cette série regroupe des thématiques comme les choix, les rêves d’enfants et les projets de vie d’adolescents mais aussi la pression que peuvent mettre les parents…
Léna, d’où nous venez-vous ? Quand vous avez choisi un métier artistique, vos proches vous ont-ils suivie ?
Léna : Tout le monde dessine un peu dans ma famille. Et mes parents ont très vite compris que je n’étais pas fait pour les études. Ils étaient inquiets que je choisisse le dessin mais ils m’ont encouragé quand il le fallait. J’ai aussi reçu l’aide de Reno Lemaire, l’auteur du manga français Dreamland, il m’a donné des cours, des astuces. J’ai dû m’en souvenir en arrivant dans l’univers d’Emma et Capucine. Loin de mon travail dans le cinéma, ici, je devais travailler sur tout et toute seule. C’est peu dire que j’étais incertaine sur chaque étape. Sur le tome 2, ce fut beaucoup plus libre.

Recherches © Léna Sayaphoum
Vous, Jérôme, je crois que vous avez connu un revirement total dans votre vie, vous qui étiez… analyste financier avant d’écrire des BD.
Jérôme Hamon : C’est vrai, à un moment de ma vie, j’en suis arrivé au constat que je ne me projetaispas dans ma vie professionnelle. J’avais l’impression de mener la vie de quelqu’un d’autre. Bien sûr, mes études je les avais bien réussies mais elles ne m’avaient pas amené vers le job de mes rêves. Est venue la fatidique question : que vais-je faire de ma vie, maintenant ? Dans ce questionnement, c’est l’envie de raconter des histoires qui m’a le plus parlé.
Vous arrivez tel Billy Elliot dans la BD !
Jérôme : J’ai très vite eu envie de collaborer avec elle autour d’une thématique commune. Et il se trouve que j’étais fasciné par la préparation de ma fille aînée avant de partir à son cours de danse. Je la voyais s’installer, en tutu, devant le miroir et se regarder… se projeter ! La part de rêve est impressionnante chez cette gamine qui se mettait à rêver à quelque chose si loin de sa réalité, à être danseuse étoile.

© Hamon/Sayaphoum chez Dargaud
Il faut dire que quand j’ai quitté New York, j’étais un peu dans la même situation qu’Emma et Capucine. Je pense que les parents ont le rôle d’accompagner leurs enfants, d’amener leur rêve à être plus réaliste. Que ce soit dans la danse ou d’autres domaines, à appréhender la vraie vie, celle derrière les paillettes qui peuvent séduire, pour éviter toute désillusion. Cet album, c’est une manière de prendre conscience et de faire prendre conscience.

© Hamon/Sayaphoum chez Dargaud
Moi, je n’ai pas vraiment eu d’aide dans mes choix. Je n’ai pas eu de retour, je me suis retrouvé livré à moi-même, sans avoir pu considérer le fait qu’un jour je devrais choisir un métier. J’ai été laissé extrêmement libre, en fait. J’ai étudié mes cours sans en voir la finalité. J’étais attiré par le domaine scientifique, j’aimais comparer les sociétés, les cours de la bourse. C’était très intéressant jusqu’à ce que ça devienne… ma vie. Ce n’était plus un jeu, on ne fait pas de l’analyse financière comme on résout un sudoku.
Jérôme, l’analyste se cache-t-il encore parfois dans l’ombre du scénariste ?
Certainement, dans les points positifs, je pense que cela influence ma manière d’être très structuré, cartésien, rationnel. Mais, d’un autre côté, je dois parfois mettre cette casquette de côté, me laisser porter par les choix dont je suis maître. Il ne faut pas tout analyser. S’il faut des lignes narratives, il faut aussi ressentir les choix des personnages; voir, au-delà des coups sur le jeu d’échec, toutes les pièces qui peuvent encore bouger.
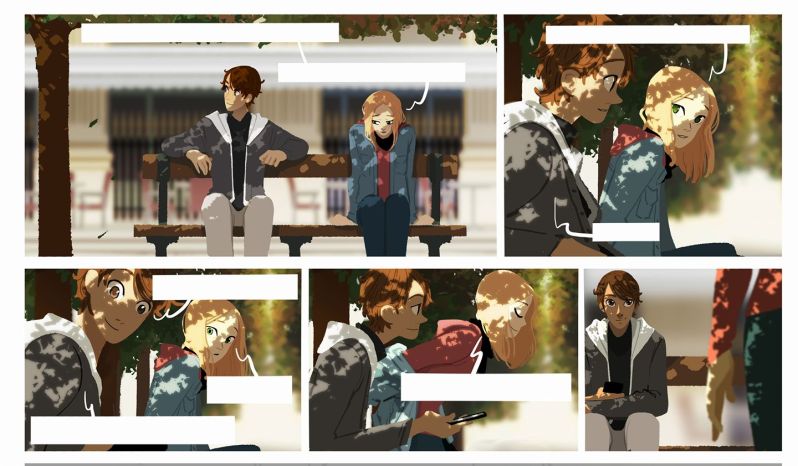
© Hamon/Sayaphoum chez Dargaud
Léna, pour vous, c’est donc votre première série, vos premiers albums.
Léna : Oui et, pour tout dire, quand Jérôme est arrivé avec son projet, j’ai eu un peu peur et j’ai… refusé. Il m’a tanné, j’ai fini par accepter.
Jérôme : Je n’avais pas vraiment en tête d’en faire une série. Ce devait être un one-shot concentré sur un personnage qu’on a ensuite différencié en deux soeurs.

© Hamon/Sayaphoum chez Dargaud
Léna : Cela nous a permis d’avoir deux personnalités différentes, indissociables – j’aime les deux – mais aussi de nous intéresser à la diversité de danses. J’en ai fait pendant six ou sept ans, du jazz, du contemporain, de l’urban jazz, du ragga mais aussi du classique.
Il vous a du coup été plus facile de mettre ces deux danseuses en scène ?
Léna : Il m’a fallu me replonger dans ce monde. Refaire quelques mouvements, aussi, parfois. Le papier, ça ne bouge pas !

© Hamon/Sayaphoum chez Dargaud
Et cette rencontre avec Léna ?
Jérôme : On s’est rencontré, on s’est entraidé, on a échangé, on s’est surtout poussé l’un et l’autre. Les retours de Léna m’ont ainsi permis d’ajouter plein de choses. Léna, c’est l’oeil du metteur en scène. Au moment où j’étais en quête de collaboration, j’ai vu ses dessins sur Instagram. C’était très personnel, sa gestion de la lumière m’a séduit.

© Hamon/Sayaphoum
Puis, c’est animé ?
Jérôme : Oui, très cinématographique, et ça, c’est aussi ma culture.
Léna : C’est dans ce monde-là que j’ai commencé, dans la modélisation 3D. Je m’occupais de la modélisation des corps, des personnages avant de passer mon travail à d’autres. Je devais attendre la fin de la création pour vraiment voir le résultat du film sur lequel nous avions bossé.
Mais je préférais le dessin qui, à vrai dire, ne m’a jamais lâché. Mais ce passage à la 3D l’a amélioré. J’ai complètement changé ma manière d’éclairer les scènes, par exemple, dans la texture, la manière dont la peau réagit à la luminosité.
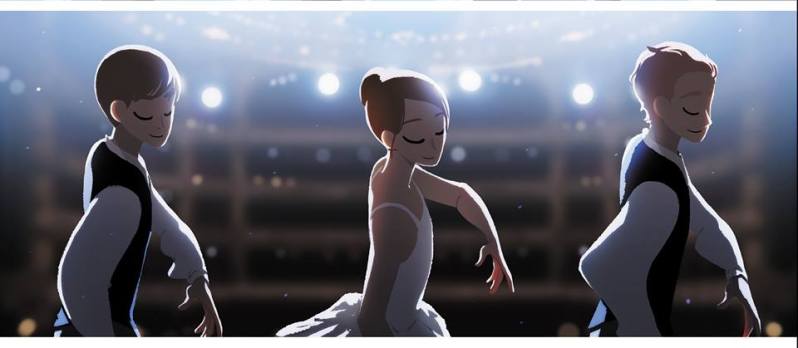
© Hamon/Sayaphoum chez Dargaud
Et les regards !
Léna : Les expressions, ce fut aussi du boulot. Parce que finalement, tout leur travail, les sacrifices et les heures d’entraînement, devait passer dans le regard des deux héroïnes, dans les différents sentiments qui vont les accompagner.
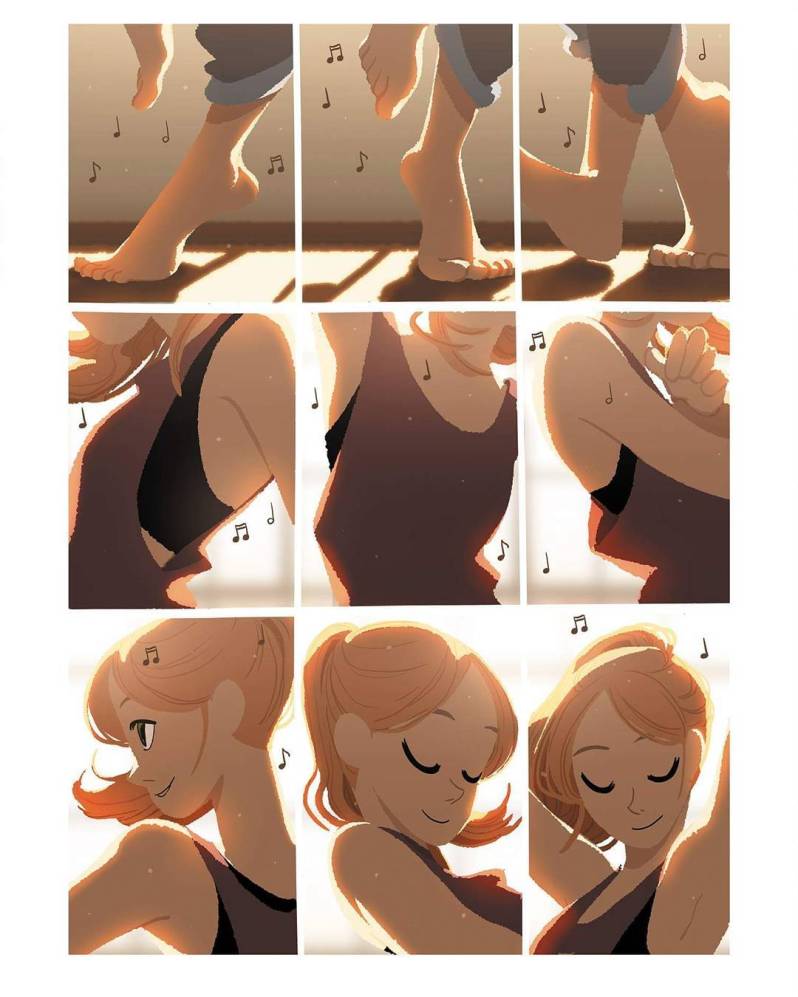
© Hamon/Sayaphoum chez Dargaud
Puis il y a les ombres auxquelles vous semblez accorder beaucoup d’importance ?
Léna : L’ombre et la lumière sont les deux faces d’une seule et même chose. L’un met en valeur l’autre, et vice-versa.
Par contre, j’ai beaucoup plus de mal avec les décors. Comme l’Opéra. Nous avons d’ailleurs voulu nous y rendre… Pas de chance, c’était fermé !

© Hamon/Sayaphoum
Cela dit, le cinéma s’est intéressé à la danse, des films vous ont-ils inspirés ?
Jérôme : Je pense inévitablement à Black Swan et Billy Elliot. Puis, il y a le magnifique documentaire sur Benjamin Millepied, La relève : histoire d’une création, et qui s’intéresse au processus de création du ballet “Clear, Loud, Bright, Forward”.
Si on quitte le grand écran, il y a aussi cette série documentaire, Graines d’étoiles, qui suivait une année scolaire à l’école de l’Opéra de Paris. Des professeurs aux élèves, en montrant toute la vie mais aussi la réalité et l’envers du décor, des paillettes.
J’ai l’impression que c’est un monde dans lequel on peut être les meilleurs amis tout en étant ennemis. La concurrence est rude, non ?
Jérôme : La danse, c’est un monde magnifique, j’y ai vu tellement d’enfants heureux. Mais, la concurrence est bel et bien présente et il y a peu d’élus. Je pense que malgré la fraternité qui peut régner, ce constat reste présent dans l’esprit des enfants, quand ils se regardent, qu’ils se comparent. C’est difficile à gérer, sans doute. Rien n’est tout noir ou tout blanc, on peut être amis, certainement, mais il y aura toujours cette dose de chacun pour soi.

© Hamon/Sayaphoum chez Dargaud
Pour revenir à ce que je disais tout à l’heure, je pense qu’il est important que les parents laissent rêver leurs enfants. Et si, à un moment, ce rêve devient plus concret, les parents doivent être là en garde-fou, préserver leurs enfants tout en montrant leur soutien. C’est si dur de réaliser un rêve ! Il faut un équilibre, ne pas y aller à coups de clichés mais apporter de la nuance, de l’enthousiasme. Et que ce soit les personnages qui l’amènent : je m’efforce de ne pas prendre position dans la BD tout en veillant à ce que si un personnage dit quelque chose, un autre puisse lui opposer un avis différent.

© Hamon/Sayaphoum chez Dargaud
Des avis, il y en a pas mal. Votre travail très suivi sur les réseaux sociaux, non ? Tant sur la page d’Emma et Capucine que sur votre page personnelle, Léna.
Léna : C’est vrai. Au départ, j’ai commencé à partager mon travail pour trouver du boulot. Aujourd’hui, ça me permet de tenir au courant ceux qui me suivent, de montrer des bonus.

© Sayaphoum
Sur combien de tomes est prévue cette série ?
Jérôme : Six, sept, huit… le temps qu’il faudra pour faire évoluer les personnages. C’est agréable d’avoir ce luxe, ce confort, de pouvoir compter sur plusieurs tomes pour raconter une histoire. Comme Nils qui sera une trilogie.
Merci à tous les deux ! En attendant le troisième album, on ne peut donc qu’encourager le lecteur à vous suivre sur la page Facebook dédiée à Emma et Capucine.
Propos receuillis par Alexis Seny
Série : Emma et Capucine
Tome : 2 – Premiers doutes
Scénario : Jérôme Hamon
Dessin et couleurs : Léna Sayaphoum (Page Facebook)
Genre : Jeunesse, Sport, Initiatique
Éditeur : Dargaud
Nbre de pages : 56
Prix : 9,99€
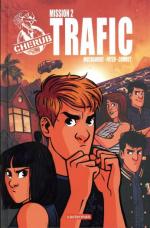
Il n’y a pas que les grands qui peuvent être des espions. La preuve avec Cherub, une série littéraire jeunesse initiée par Robert Muchamore qui voit des agents âgés de 10 à 17 ans intégrer un département ultrasecret des services de renseignement britanniques. L’idée a fait son chemin et s’est retrouvé en BD. La deuxième mission, avec Baptiste Payen et David Combet aux commandes, amènent nos espions en herbe doivent infiltrer un véritable cartel de la drogue, le plus puissant du Royaume-Uni. Sans poudre aux yeux, interview avec les deux auteurs et adaptateurs.

© Payen/Combet chez Casterman
Bonjour à tous les deux. David, on vous a déjà vu dans des ouvrages collectifs comme Axolot ou We are the 90’s, mais c’est votre premier véritable album. Quel effet cela fait-il ?
David Combet : Je suis très content ! Les neuf mois de création n’ont pas été de tout repos, mais c’est tellement chouette de voir le livre imprimé et entre les mains des lecteurs !
Avant d’en parler, si vous nous disiez d’où vous nous venez et qu’est-ce qui a éveillé en vous le virus de la bande dessinée ? Avec des coups de foudre pour certains auteurs ?
David Combet : J’ai grandi en Savoie et je vis maintenant à Lyon. J’ai passé mon enfance à lire Picsou Magazine et mon adolescence à lire les comics Top Cow (Tomb Raider, Witchblade etc). J’étais un gros fan de Michael Turner, Francis Manapul et Andy Park.

© Payen/Combet chez Casterman
Mais alors à partir de quel moment avez-vous voulu en faire votre métier ? Avec quel parcours ? Des mentors vous ont-ils aidé ?
David Combet : Justement quand j’étais ado. Mes parents m’ont bien soutenu et j’ai pu faire un Bac Arts Appliqués et ensuite l’ENAAI, une super école d’art sur Chambéry. C’est là que j’ai rencontré Baptiste, qui était mon prof de BD. On a monté un projet ensemble et c’est en démarchant Casterman qu’on a eu l’occasion ensuite de bosser sur Cherub.

Un essai pour l’adaptation d’une série de romans jeunesse en BD © David Combet
Si le Caire est un nid d’espions, l’ENAAI de Chambéry est un repère de talents. Tous les deux vous sortez de cette école. Vous nous en parlez ?
David Combet : C’est une école d’arts appliqués à taille humaine et riche en enseignements. J’y ai suivi le cursus spécialisé en BD, illustration, animation et graphisme. C’est une vraie force d’avoir tous ces domaines différents car on apprend à gérer un projet complet, du dessin à la mise en page et au graphisme. Le tout avec une ambiance et des prof super chaleureux.
Est-ce facile pour un jeune auteur comme vous de débarquer dans ce monde en pleine métamorphose ?
David Combet : C’est loin d’être évident. Mais j’avoue avoir eu beaucoup de chance ! Entre les rendez-vous pro du festival BD de Lyon et les soirées de la librairie Expérience j’ai pu faire plein de belles rencontres.
Avec des (dés)illusions ?
David Combet : Pas vraiment. Je me suis rendu compte à quel point c’est un métier chronophage, et cet aspect-là du job n’est pas toujours simple à gérer. Mais à part ça tout roule !

© David Combet pour Axolot
Quand on commence, recherche-t-on un style, son style, ou cela vient-il naturellement ?
David Combet : Quand j’étais étudiant, je ne recherchais pas grand-chose et je me laissais porter par ce que je savais à peu près faire. C’est une fois sorti de l’école que je me suis mis à expérimenter des encrages et des techniques de couleurs différentes. La base du dessin reste à peu près la même mais le résultat final change selon les projets.
En tout cas le vôtre, David, on le reconnait au premier coup d’oeil. C’est déjà une victoire, non ? Qu’y avez-vous mis ? Tant au niveau du dessin que des couleurs, d’ailleurs…
David Combet : Au niveau de la base du dessin, j’imagine que c’est un mix d’influences que j’ai accumulé depuis que je dessine, les comics au début et des artistes plus graphique aujourd’hui (je pense notamment à Ines Longevial ou Alexandre Clérisse). Pour les couleurs, j’ai toujours adoré les ambiances de la photo argentique, où l’herbe et le ciel ne sont jamais vraiment vert et bleu. Je trouve ça super intéressant à travailler, et c’est vraiment un plus pour la narration.

Extrait du Vice d’Émile, une histoire courte pour le Projet Bermuda © David Combet
En tout cas, il y a un sens aiguisé de la composition chez vous, non ? Une envie que les planches soient des tableaux mais aussi bien plus que des planches. Pour que ce que vous racontez s’en échappe, non ? Qu’il y ait déjà de la vie avant même qu’on entre dans ce qu’il se passe dans les cases…
David Combet : Je suis très content si tu perçois les choses comme ça ! J’aime les belles planches et j’essaie de faire au mieux. Sur mes projets perso, je travaille avec peu de couleurs et ça demande un effort de plus pour la lisibilité. J’ai aussi une grosse névrose sur la symétrie que j’essaie d’atténuer un petit peu…

Recherches de couleur pour We Are the 90’s © David Combet
Pour Cherub c’est différent car Baptiste fait les storyboards. Je les modifie ensuite mais
c’est vraiment le résultat de nos deux visions.
Et votre art ne transpire-t-il pas un esprit comics plus que franco-belge ? Très sérigraphie aussi, non ?
David Combet : Vu que j’ai vraiment commencé à dessiner pendant ma période comics c’est possible qu’il en reste un peu ! Et maintenant oui, ça fait quelques temps que je me rapproche de choses plus graphiques et la sérigraphie m’inspire beaucoup.
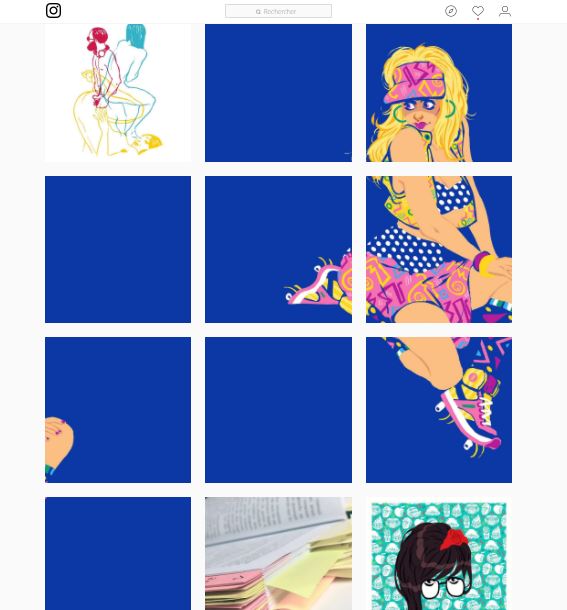
Un tour sur l’Instagram de David Combet prouve que l’auteur aime les expériences
Votre travail des ombres est également impressionnant. Jusque sous les arbres ? Une obsession ou un côté maniaque de représenter la réalité au plus proche malgré des personnages moins réalistes ?
David Combet : J’essaie de faire en sorte que les couleurs racontent quelque chose en plus du dessin : qu’on ressente la chaleur, l’humidité, le lieu, ou l’émotion de la séquence.
À côté de ça, on sent une réelle envie (sur votre site en tout cas) de parler de sujets très contemporains : des MILFS qui doivent chercher leurs enfants sur une île thaïlandaise pour les besoins d’une télé-réalité, la vie d’un moche ou encore un plan-cul ? Puis il y a des chansons actuelles d’Orelsan ou Lilly Wood and the Prick. Tout est donc bon pour vous inspirer ? Que faut-il du coup pour que ça donne lieu à une histoire courte ou longue ?
David Combet : Il faut que ce soit fun (comme les Huîtres de Mai Lan et Orelsan), mais plus souvent que ça me touche personnellement, que ce soit un sujet dans lequel je me projette facilement. J’écris depuis pas très longtemps donc c’est plus facile pour moi de raconter ce que je connais bien. D’où les sujets contemporains j’imagine (je suis d’ailleurs très fan des séries Girls, Master of None et Please Like Me qui sont vraiment des chef d’oeuvre en la matière).
Comment êtes-vous arrivés dans Cherub ? Vous connaissiez cet univers bien connu des jeunes ados ?
David Combet : Pas du tout ! En fait, j’avais fait un test pour une adaptation d’un autre roman jeunesse chez Casterman, et comme ça ne s’est pas fait ils m’ont proposé Cherub. Du coup j’ai lu les bouquins, j’ai trouvé ça plutôt fun alors j’ai voulu essayer.
Pour vous, Baptiste, c’est une nouvelle corde à votre arc, un nouveau genre, non ? Il y avait de l’appréhension ?
Baptiste Payen : Il y avait évidement pas mal d’appréhension. Je me retrouve avec la responsabilité de créer un scénario adapté d’un best-seller alors que jusque là je n’avais été édité qu’en temps que dessinateur et coloriste. J’ai été bien accompagné sur cet album par l’éditeur, ça m’a rassuré. Le fait que ce soit un nouveau genre pour moi ne m’a pas posé de problème : j’aime raconter des histoires, le genre ne m’importe pas tellement, j’ai fait de la BD jeunesse, historique, sportive, aéronautique, policière, et maintenant de l’espionnage. Ça me permet de découvrir de nouvelles choses et de me cultiver.

© Baptiste Payen
Que Baptiste soit avant tout dessinateur, ça se sent dans sa manière d’écrire ?
David Combet : C’est mon premier job avec un scénariste du coup je ne peux pas vraiment faire de comparaison. Mais je pense que ça contribue au fait que la collaboration se passe très bien : il me comprend bien et il connaît bien les enjeux auquel un dessinateur se confronte.
Naturellement, c’est un tome 2, mais cela pourrait très bien être un tome 1, non ? L’histoire est reprise à zéro et le code de conduite au sein de ce département d’espions remis au goût du jour. Néanmoins, est-ce facile d’arriver sur une série en cours ? D’autant plus quand le premier tome date de … 2012 ?
Baptiste Payen : Nous nous sommes posé beaucoup de questions par rapport à la continuité de la série, puis nous avons décidé de ne pas tenter de coller absolument au tome précédent : nous aurions pris le risque de ne pas maîtriser ce que nous aurions fait. Nous avons pris le parti de rappeler les informations nécessaires à la définition de l’univers de CHERUB dans ce tome 2, et c’est aussi ce que fait Robert Muchamore dans le roman avec le texte d’introduction. Lire le tome 1 enrichit la lecture du tome 2, mais n’est pas absolument nécessaire à la compréhension. Le fait de considérer ce tome 2 comme « notre » tome 1 nous a permis de ne pas avoir réellement la sensation de poursuivre une série, mais simplement de proposer notre vision de cet épisode.

© Payen/Combet chez Casterman
Comment vous êtes-vous approprié l’univers de Robert Muchamore ? En le lisant d’abord ? Comment passe-t-on de lecteur à adaptateur ? Est-il question de représenter au mieux ce que notre esprit a imaginé au fil de la lecture ?
Baptiste Payen : Évidement, j’ai lu quelques fois les premiers tomes de la série, que je ne connaissais pas avant que l’adaptation soit proposée à David. Je ne sais pas si je me suis réellement approprié l’univers de Robert Muchamore, j’ai surtout essayé de le comprendre afin que notre adaptation soit respectueuse de son travail.

© Payen/Combet chez Casterman
Pour passer de la lecture à l’adaptation, il faut être très pragmatique : j’avais un nombre de pages à respecter, et une histoire à raconter. À partir de là il s’agit de trier les informations : que peut-on transmettre seulement par le dessin, que peut-on éluder, et quelles informations sont absolument nécessaires ? Une fois ce travail fait, la marge de manœuvre se réduit considérablement et on peut se concentrer sur la manière de raconter l’histoire.
Le roman Trafic est paru en 2004, il y a déjà une génération de lecture, au moins. Cela veut-il dire qu’il a fallu un peu rafraîchir la substance (et la manière dont les personnages se comportent entre eux, par exemple) pour coller à l’attitude et ce que vive les jeunes d’aujourd’hui ?
Baptiste Payen : Je n’ai pas tellement touché au comportement des personnages, CHERUB repose sur des stéréotypes qui sont encore d’actualité pour véhiculer des messages simples, j’aurai eu du mal à changer cela et j’aurai sans doute eu l’impression de ne pas respecter le roman. De son côté, David a modernisé l’univers en faisant coller son dessin à des références un peu plus contemporaines.

© Payen/Combet chez Casterman
Adapter en bande dessinée (comme en film, d’ailleurs), n’est-ce pas briser le pouvoir de l’imagination ? Comment contourner cela ? Qu’est-ce qu’une adaptation en images peut apporter de plus, du coup ?
Baptiste Payen : L’adaptation en image n’apporte sans doute rien de plus que le roman. On change simplement de média afin de raconter la même histoire différemment. On propose « une » vision de cet univers, sans prétention d’en faire « la » vision. Une lectrice nous a dit récemment : « Je sais que James est décrit comme blond dans les romans, mais je préfère l’imaginer brun. », la BD la prive sans doute un peu de cette liberté. J’espère qu’on n’a pas brisé le pouvoir de son imagination, et quelle sera capable de ne voir la BD que comme une proposition.

© Payen/Combet chez Casterman
On voit beaucoup d’histoires d’espionnage portées à l’écran (avec en têtes de gondole les James Bond, Jason Bourne ou autres aventures d’Ethan Hunt ou des Kingsman), comment la bande dessinée rivalise-t-elle avec le spectacle du cinéma, les effets spéciaux etc. Quelles sont les armes de la BD ? Que permet-elle de faire passer que le cinéma est incapable ?
Baptiste Payen : Je ne crois pas qu’on puisse rivaliser. La BD apporte un univers graphique et narratif propre, le rythme se fait par la forme et l’emplacement des cases, par la composition, par la mise en scène, puis le lecteur décide de passer le temps qu’il souhaite sur chaque scène, il maîtrise sa lecture, il a le droit, s’il le souhaite, de revenir trois page en arrière ou d’aller voir trois page en avant, c’est possible en littérature, en BD, mais pas au cinéma. En BD, on ne peut que suggérer un mouvement, un bruit, ou le passage du temps, il faut être assez habile pour que le lecteur puisse instinctivement comprendre nos intentions. La lecture de BD est une lecture active, devant un écran on peut être passif. Selon le public ce sera un atout ou un handicap pour la BD.
Au niveau des effets spéciaux, en BD nous n’avons aucune limite, il faut juste des idées, du
temps, de l’envie et parfois du talent.

© Payen/Combet chez Casterman
Cela dit, il ne manque pas grand-chose pour que vos personnages s’animent sous nos yeux. Ça vous parle le cinéma d’animation ?
David Combet : Carrément ! C’est d’ailleurs la grosse influence du parti-pris graphique.
En matière d’espionnage, quelles sont vos références, vos films/histoires cultes ? Et en BD ?
David Combet : C’est pas exactement de l’espionnage, même s’il y en a un peu, mais la série de détective Veronica Mars que j’ai regardé pendant toute mon adolescence (… et encore maintenant, en fait), et j’ai une grosse passion pour Élise Lucet et le journalisme d’investigation qu’elle représente. En BD, j’avais adoré Danger Girl !
Naturellement, c’est une BD pour les jeunes ados, il y a un canevas à respecter ? À quoi faut-il veiller quand on s’adresse à un tel public ?
Baptiste Payen : Nous avons le roman comme garde-fou, les choses y sont décrites de manière à être adaptées aux adolescents. En respectant cela, on reste dans les limites. C’est même un peu sage à mon sens, les ados peuvent encaisser bien pire avant qu’on passe dans le subversif.
Quelles sont les différentes étapes du scénario à la planche finale ? Quelle est votre méthode? À l’ancienne ou à l’aide d’une tablette graphique ?
David Combet : J’utilise les boards de Baptiste pour faire mon crayonné en proposant, si besoin est, des modifications. J’en profite pour faire le lettrage et le gros de la mise en page. Ensuite l’encrage, les aplats, et la mise en couleurs. Pour ce projet je bosse exclusivement en numérique, notamment pour des raisons pratique et de planning.
L’album est également paru en Angleterre. Pas mal, hein ?
David Combet : Plutôt cool oui !
Quelle est la suite pour vous ? D’autres projets ou toujours du Cherub ?
David Combet : On travaille en ce moment sur le tome 3 de Cherub, Arizona Max. Ensuite, j’enchaîne avec un autre album qui n’aura rien à voir et qui sera très cool aussi, mais je ne peux pas en parler pour l’instant…
Baptiste Payen : Nous avons un projet commun qui restera en stand-by pour encore quelques temps car nous sommes tous les deux très occupés, mais nous ne l’abandonnons pas. C’est un récit qui commence comme toutes les histoires de super-héros, mais qui dégénère « légèrement », je pense être assez vague avec ça pour ne pas trop en dévoiler !
Merci à tous les deux !
Propos recueuillis par Alexis Seny
 |
©BD-Best v3.5 / 2025 |