
 Flux RSS
Flux RSS

FRNCK ! Kézako ? Vous n’êtes pas les premiers ni les derniers à vous demander comment prononcer le titre imprononçable de cette nouvelle série d’Olivier Bocquet, Brice Cossu et Yoann Guillo, qui a fait sensation dans les pages de Spirou. Certains essaient Frequeque tandis que d’autres s’abstiennent. De quoi asseoir un peu plus le mythe naissant, l’histoire d’un garçon hyperconnecté qui, du jour au lendemain, se retrouve à devoir survivre dans un monde hostile et préhistorique qui n’a pas encore appris les voyelles. Heureusement, Olivier et Brice n’y ont pas perdu leur Français. Interview plus que sympathique de ce tandem délirant autour d’une série ambitieuse et généreuse.
Bonjour à tous les deux, jamais auparavant vous n’aviez collaboré, comment vous êtes-vous connus ?
Brice : En fait Olivier m’a contacté via F…..ahem, une célèbre plateforme de réseaux sociaux, ayant vu une de mes séries en cours chez Soleil et pensant que mon dessin pour faire l’affaire pour FRNCK , et j’avoue être immédiatement tombé sous le charme du projet.
Comment définiriez-vous l’autre ? Qu’est-ce qui fait qu’à vous deux, vous faites la paire ?
Brice : Pour résumer, je dirais que coup du hasard ou du destin, en tout cas ça a matché immédiatement, et on est toujours aujourd’hui surpris de cette «complicité » qui s’est nouée finalement.
Olivier : Voilà. On est très exactement sur la même longueur d’ondes. À tel point que plus on avance dans les albums, plus mes descriptions dans les scénarios sont succinctes. Je sais qu’il sait.

© Bocquet/Cossu/Guillo
À vous trois, même, puisque Yoann est arrivé dans l’aventure. Assez vite ?
Brice : Quasi immédiatement même ! Dès l’essai de pages pour Dupuis, j’ai pensé à Yoann, avec qui j’ai travaillé à plusieurs reprises et avec qui j’ai un vrai feeling. Et encore une fois ça a matché à tous les 3, a tel point que je n’ai aucune hésitation à dire que je pense qu’on a constitué la Dream Team pour ce projet.
Que vous êtes-vous apportés mutuellement ?
Brice : Beaucoup de choses ! En ce qui me concerne, FRNCK, c’est l’essence même du type de récit qui me touche et que je voulais faire depuis longtemps… Disons, pour résumer, que scénario, dessin et couleur se complètent et s’influencent.
Olivier : Brice est tellement impliqué dans l’histoire qu’il peut me donner des idées de scénario très importantes. Pas juste « oh tiens, à ce moment-là il pourrait se mettre le doigt dans le nez », mais des éléments qui peuvent redéfinir l’axe dramatique d’un album entier. Pour un scénariste, c’est très « challenging », et très motivant. Quant à Yoann, sur certaines planches, c’est lui qui apporte la note juste. Il révèle l’émotion contenue dans le dessin de Brice.

© Bocquet/Cossu
FRNCK, une série dans laquelle la moitié des dialogues (au moins) sont amputés de leurs voyelles. L’idée est folle, non ?
Olivier : Folle ? Non non, nous sommes des gens très rsnnbls. Et puis ça donne un petit quelque chose d’immédiatement séduisant, quand on résume l’histoire : « Franck arrive au début de l’humanité. Mais vraiment au début : l’Homme n’a encore rien inventé, même pas les voyelles. » Tout de suite vous faites sourire les gens.
Brice : On a essayé en amputant des consonnes mais une BD qui s’appelle A , c’est beaucoup plus obscur.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis
C’est ce concept qui a guidé l’aventure ou est-il arrivé plus tard dans la conception de l’histoire ?
Olivier : C’est venu pendant l’élaboration. J’ai avant tout cherché à faire ce que je ne trouvais plus en BD, et qui personnellement me manquait : une série d’aventure humoristique tous publics. Qui s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes. Comme les Astérix, les Lucky Luke, les Tintin, ou les Spirou que je lisais dans mon enfance. Qui fait ça aujourd’hui ? Les mangas, certes. Mais en BD belgo-française, je pense que la dernière nouveauté marquante du genre, c’est Lanfeust de Troy. C’était donc il y a presque 25 ans…
Ce langage tronqué se base donc sur la capacité du cerveau à reformuler des mots même incomplets. Vous nous expliquez ?
Olivier : J’ai entendu dire que si on garde la première et la dernière lettre des mots à leur place, on peut mélanger toutes les autres, ça ne gêne pas la lecture. Je pense cependant que les exemples que j’ai vus sont très orientés pour être faciles à déchiffrer, mais je ne suis pas un expert. Sur Frnck, l’exercice consistait surtout pour moi à essayer de ne pas faire de phrases qui pouvaient générer des contresens si on plaçait d’autres voyelles que celles que j’avais prévues.
Cela ne risquait-il pas de heurter, décontenancer les lecteurs ? Avez-vous fait des tests avec un échantillon pour voir si ça « marchait » ?
Olivier : Non, aucun test. J’avais suggéré qu’on mette une traduction en dernière page, mais Benoît Fripiat, notre éditeur chez Dupuis, m’a dit « Si le lecteur ne comprend pas, il sera aussi perdu que Franck, ce sera très bien ». La seule chose que j’ai « testée », même si j’en avais l’intuition très forte, c’est le côté ludique de la chose. Expliquez à des enfants le concept, ils commencent tout de suite à imaginer leurs noms sans voyelles et à parler sans voyelles. Juste parce que c’est marrant !

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis
Cela dit, les plus petits peuvent totalement faire l’impasse sur la compréhension du langage de ces hommes préhisto, non ?
Olivier : Oui, rien de ce qu’ils disent n’est vital à la compréhension globale de l’album. Ce sont juste des subtilités en plus. C’est l’avantage de travailler avec l’image : beaucoup de choses peuvent se passer de mots. D’ailleurs – petit hors-sujet, pardon – c’est un des grands plaisirs de la BD, de pouvoir montrer une chose dans l’image et dire autre chose par le texte.
À l’origine de cette aventure, un personnage trop accaparé par son GPS. Une invitation à se déconnecter, FRNCK ?
Olivier : Beaucoup d’adultes qu’on a vus en dédicace achètent l’album pour leur fils ou filles qui sont à leur goût trop scotchés sur leurs portables. Tant mieux si ça permet aux parents d’en parler avec eux sans en faire un drame ! Personnellement, je n’ai de leçon à donner à personne. J’ai pu constater que, le plus souvent, les ados ne font pas n’importe quoi avec leurs téléphones. En général, ils communiquent avec leurs amis. Qu’y a-t-il de mal à ça ? Frnck est plutôt une façon marrante de se rappeler que, si on sait très bien se servir des outils qui sont à notre disposition, on ne saurait pas les recréer. On est en fait très ignorants des bases mêmes de la survie. Essayez de faire un feu sans briquet ni allumettes. Essayez de chasser. Essayez juste de trouver quelque chose de comestible dans la nature. Je ne parle même pas de trucs extrêmes à la Bear Grylls : la plupart d’entre nous serions incapables de survivre dans la forêt de Fontainebleau.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis
La préhistoire, faut savoir, c’est bien ou c’est nul (comme le dit votre héros)?
Brice : C’est très plaisant à dessiner. À vivre, je demande à voir… ou pas !
Olivier : Moi je suis « Team Ou Pas » ! À mon avis c’est assez atroce. C’est une des raisons pour lesquelles Frnck existe, d’ailleurs : c’est intéressant de placer un héros dans un monde hostile. Mais je pense que c’était bien pire que ce que raconte la série : rien que les moustiques, tu tiens deux heures avant de devenir fou.
Un univers dans lequel vous vous sentez bien ?
Brice : Hooo oui !! Étant plutôt habitué aux univers urbains un peu sombres sur mes précédents titres, c’est une vraie bouffée d’air frais de dessiner la nature !!! Ensuite, comme nous ne nous plaçons pas forcément dans une préhistoire « historique », on peut se permettre quelques libertés quant à la faune et la flore.
Olivier : L’univers de cette BD est un univers dans lequel je me sens merveilleusement bien. Si je peux m’y promener encore pendant quelques années avec Brice, je pense que je serai très heureux.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis
Si vous pouviez voyager dans le temps, où voudriez-vous vous retrouver ? Et pourquoi ?
Brice : Houlà , question difficile. Pour ma part il n’y a pas qu’une époque. À vrai dire, j’aimerais remonter le temps pour voir de mes propres yeux ce qu’on a dû mal à expliquer de nos jours (comment les dinosaures ont disparu, l’érection des pyramides de Gizeh, les statues de l’Île de Pâques etc ).
Olivier : Moi, je n’ai pas besoin de remonter le temps pour voir des érections, mais c’est un autre sujet. Je choisirais probablement de voyager dans le futur. Faire des bonds de siècle en siècle, pour voir ce qu’on va devenir, et surtout à quel moment on va rencontrer des extra-terrestres.
Après, ce genre de voyage dans le temps et dans la préhistoire a déjà été maintes fois exploité dans la littérature populaire. Par quel angle attaque-t-on un tel projet ? On se désinhibe ou au contraire on tourne ces références à son avantage ?
Olivier : Depuis mon adolescence j’ai lu plein d’histoires de ce type. Il y a un potentiel énorme à la fois de fun, d’émotion, d’action, de réflexion… Il y mille manières de l’aborder. Mais franchement, je ne pensais que je trouverais un angle original pour investir ce genre. Et puis voilà, Frnck est arrivé, et j’ai tout de suite su que c’était une bonne histoire. Mais curieusement, il m’a fallu des années pour découvrir ce qu’elle était vraiment. Je n’étais pas écrasé par mes références, j’étais juste… éparpillé. Au début, je ne me suis pas rendu compte que la partie « voyage dans le temps » était importante. J’ai failli la gâcher, cette histoire, en en faisant juste une série de gags courts sur des anachronismes. Mais aujourd’hui, je pense qu’avec Brice on a l’occasion de faire notre Retour vers le futur. Peut-il y avoir un métier plus cool que ça ?
Brice : Pour moi, l’essentiel ici a été de se faire plaisir, et si on arrive à faire ressentir ça au lecteur par la suite , c’est gagné .
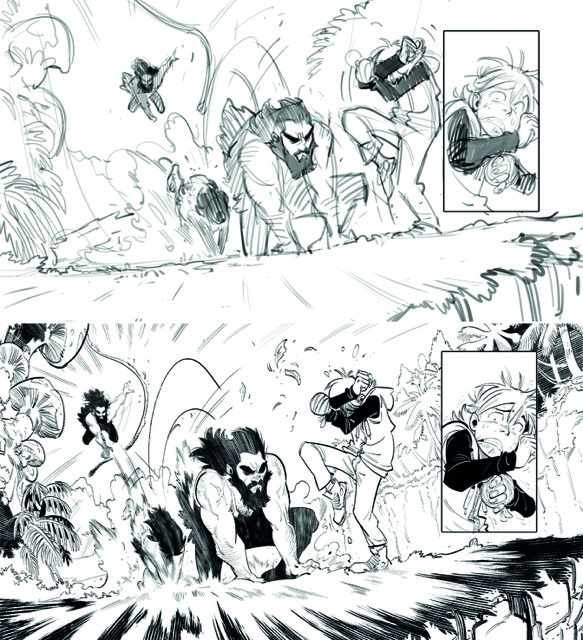
© Bocquet/Cossu
Quelles sont vos références ? Vos histoires (romans, films, bd…) se passant dans la préhistoire (ou faisant des ponts avec notre époque) préférées ?
Olivier : Sur la préhistoire, j’ai beaucoup aimé une série de gags courts pour la télé. Ça s’appelle Fred des Cavernes, je vous la conseille !
Il y a aussi une nouvelle de Rosny Ainé, l’auteur de La guerre du feu, où il imagine que les hommes préhistoriques rencontrent les extra-terrestres. Dans mon souvenir, c’est très puissant. Et bien sûr, enfant j’étais un grand fan de Rahan ! J’avais même son coutelas d’ivoire… enfin, de plastique, mais bon, que ça reste entre nous.

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis
Dans FRNCK, on est quelque part entre Voyage au centre de la terre, RRRrrrr!!! et Le monde perdu. Ça vous parle ?
Olivier : Jules Vernes, je suis fan. Il a vraiment le sens de l’émerveillement. J’espère qu’on arrivera à faire écarquiller les yeux au lecteur comme Verne nous fait écarquiller le cerveau. Le monde perdu, je suis sûr de l’avoir lu quand j’avais une dizaine d’années, mais tout ce dont je me souviens, c’est la couverture du livre. Quant à RRRrrrr!!!… il y a quelques très bons gags, mais c’est dommage qu’ils se soient contentés de ça. Il y avait vraiment le potentiel d’aller plus loin tout en restant drôles. En revanche, un des personnages de Frnck est directement inspiré du look de Marina Foïs dans ce film !

© Bocquet/Cossu
Brice, vous, vous avez totalement réadapté votre graphisme, plus « jeunesse », plus « manga », plus speedé aussi. Vous avez mis du temps à trouver le bon calibre ?
Brice : Holàlà non, ça a même plutôt été immédiat ! Mon dessin dans FRNCK est en fait bien plus « naturel » pour moi, car bien plus proche de mes sources profondes d’inspiration et des pistes de dessin que j’explorais quand j’étais un ado qui dessinait dans les marges de ses cours de maths. (rires)
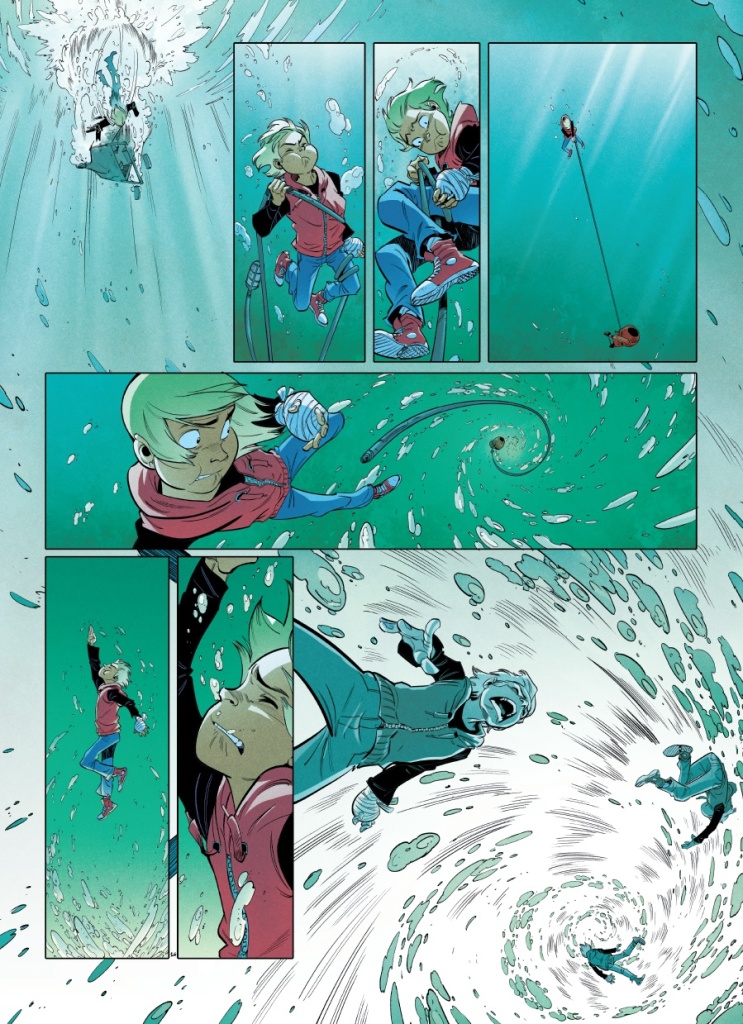
© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis
Olivier : Moi aussi je dessinais sur mes cours de maths. Surtout des b… non rien. (re-rires)
Qu’est qui vous plaisait dans l’histoire d’Olivier ?
Brice : Le premier réflexe a été un franc fou rire sur le titre de présentation du dossier, ce qui est un très bon point. Ensuite, c’est réellement l’aspect aventure humaine du récit qui m’a touché, car même si l’humour est omniprésent, on parle d’un petit gars qui cherche d’où il vient, ce qui est une problématique très sérieuse. Et par la suite on verra qu’il ne sera pas confronté qu’à des situations qui vous feront rire mais CHHHHT.

Trombinoscope © Bocquet/Cossu
Y’a-t-il eu des défis sur cet album ?
Brice : Olivier essaie à chaque fois de me donner les situations les plus abracadabrantesques à dessiner mais j’aime le défi 😀
Comment avez-vous « designé » les personnages centraux ?
Brice : À la base, J’avais simplement un descriptif pour Franck et les trois premiers antagonistes du tome 1. En ce qui concerne la tribu dans laquelle Franck arrive , je me suis juste dit « tiens il faudrait un gars qui ait l’air un peu fou, et puis tiens des jumeaux frère et sœur un peu balourds avec des gros sourcils, etc. etc. J’ai eu pas mal de liberté finalement et ça a été aussi ma façon de m’approprier le récit.
Olivier : J’étais insistant sur le fait que tout le monde en dehors de Franck devait avoir la peau foncée. Mais en dehors de ça, Brice a vraiment inventé tous les personnages. C’est même lui qui a déterminé combien il y en aurait !

Recherches initiales pour le personnage de FRNCK © Bocquet/Cossu
Tous les deux, vous lancez avec FRNCK une perche à un public que vous ne touchiez pas encore vraiment, les pré-ados sans laisser sur le côté les autres. Exercice périlleux ? À quoi avez-vous dû veiller ?
Olivier : En matière d’exercice périlleux, j’ai fait bien plus risqué en reprenant le Transperceneige avec Jean-Marc Rochette. Là, c’est beaucoup plus simple. Pour Frnck, je veille surtout à garder un niveau de langage correct, sans vulgarité et sans tics de l’époque. Pour le reste, je ne m’interdis rien, car le ton de la série impose lui-même des limites à ne pas dépasser. Dans le gore, par exemple, ou le sexe. Et très franchement, ça ne demande aucun sacrifice. Avec Brice, il y a aussi des thèmes qui nous sont chers et qu’on fera passer dans les albums. Avec légèreté, bien sûr, sans faire de pensum. Mais par exemple la tolérance, le respect de la différence, le féminisme, l’écologie, l’honnêteté… Des trucs de base, hein, mais qui semblent parfois complètement relégués au second plan quand on regarde l’actualité. Si on a des lecteurs jeunes, autant leur montrer des exemples à suivre !
Frnck fait partie de ces quelques séries qui voient à long terme. Vous planchez déjà sur le quatrième tome ? Un rythme soutenu ? Cela ne vous déconnecte-t-il finalement pas de la parution du premier tome ?
Brice : Olivier vient de finir d’écrire le quatrième tome et pour ma part j’en ai dessiné un peu plus de la moitié ! Disons qu’on a décidé de geler la sortie du tome 1 pour pouvoir enchaîner les tomes et proposer le 1er cycle dans un délai plus court que d’habitude
Olivier : C’est un rythme soutenu, mais on est portés par notre enthousiasme, et par le soutien de notre éditeur, Benoît Fripiat, car c’est lui qui prend le risque de nous faire confiance, et c’est lui qui a allumé l’étincelle qui a mené Dupuis à faire de Frnck son projet numéro 1. On ne va pas commencer à se plaindre ! La seule frustration quand on parle aux lecteurs du tome 1, c’est que parfois on a envie de leur dire « et tu verras, après il se passe ça, et ça, et là il va y avoir tel coup de théâtre… »
Un selfie dans le tome 4 © Bocquet/Cossu
Avant ça, il y a eu la prépublication dans Spirou, un petit événement pour vous ? Ça permet de prendre la température ?
Brice : Un immense honneur même ! On a été très touchés !!
Olivier : La prépublication permet de recevoir en dédicace des gens qui ont déjà lu l’histoire, et c’est très plaisant. Les enfants en particulier ont souvent des questions très précises sur tel ou tel aspect de l’album, des théories sur ce qui va se passer ensuite. J’adore ce public !
Puis il y a eu cette série de strips annonçant la série. Chouette à faire ?
Brice : On a dû trouver l’idée assez rapidement mais au final c’était un exercice super rigolo.
Olivier : C’était totalement imprévu ! On a eu une semaine pour trouver le concept puis écrire, dessiner et mettre en couleurs les 8 strips. J’avais toujours voulu m’essayer au strip, donc j’étais content du challenge, mais c’est quand même un exercice très particulier. J’ai bien transpiré pour faire des histoires en 3 cases !

© Bocquet/Cossu/Guillo chez Dupuis
Passer dans le journal, un rêve de gosse ?
Olivier : Pour moi, c’était un rêve d’adulte, plutôt. Mais voir Frnck en couverture de Spirou a été le moment le plus émouvant de ma carrière de BD. J’en ai eu les larmes aux yeux.
Y’aura-t-il des allers-retours avec notre époque contemporaine ? Je vois que vous allez notamment expliquer l’origine du… Selfie !
Brice : Clairement, le voyage dans le temps est une piste qu’on songe à explorer dans les cycles suivants.
Olivier : L’origine du selfie se situe à la préhistoire, donc pas besoin de revenir de nos jours… Mais disons qu’on a évoqué l’idée de revenir au XXIème siècle (Brice a même déjà dessiné les personnages dans leurs costumes contemporains). Cependant on sait déjà que ça n’arrivera pas avant… longtemps ! Si les dieux de la BD nous prêtent vie, on a déjà un arc dramaturgique qui est prévu sur 3 cycles de 4 albums… et ce n’est qu’après qu’on envisagera le débarquement de toute notre petite tribu de nos jours. Vu d’ici, ça semble extrêmement lointain comme perspective, mais on va probablement garder un rythme de parution assez soutenu, histoire de ne pas devenir vieux avant nos personnages !
Le retour du tigre à dents de sabre dans le tome 2 © Bocquet/Cossu
Quels sont vos (autres) projets
Brice : Un One Shot chez Glénat avec mon compère d’atelier et ami Alexis Sentenac, pour les éditions Glénat ; plus deux autres projets de one shot encore secrets… et SURTOUT plein de futurs FRNCK, espérons !!!
Olivier : On a aussi un projet commun hors Frnck, qui sortira en 2018 et ne devrait pas passer inaperçu, mais c’est un peu tôt pour communiquer dessus. Et de mon côté j’ai Le Tailleur de Pierre ma troisième et dernière adaptation de Camilla Läckberg avec Léonie Bischoff, qui devait sortir en février chez Casterman mais a été retardé.
Et Jean-Marc Rochette, qui est en train de travailler sur son magnum opus, Ailefroide, un album autobiographique de 280 pages que je l’ai aidé à écrire et qui sortira en avril 2018, toujours chez Casterman. Quant à Frnck, on va faire une petite pause, mais sauf catastrophe industrielle, à la rentrée on va attaquer le deuxième cycle !
Propos recueuillis par Alexis Seny
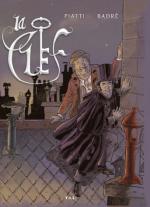
Tant de nouveautés, tant de choix, c’est vrai qu’il n’est pas triste ce monde de la BD dans lequel on ne compte plus les auteurs talentueux dans tous les domaines, poussés en têtes de gondole ou tentant toujours plus de s’extirper de l’arène où ils sont de plus en plus nombreux à défendre leur rêve. Alors, parfois, on quitte les allées royales pour aller frapper aux portes dérobées. Encore plus quand on a la… Clef. La Clef, c’est ce formidable récit gagnant amplement à être connu que nous ont livré Pascal Piatti et Pascal Badré. Une histoire où se croisent les ombres de Lupin, d’un Poe ou d’un Stevenson et où se révèle un peu plus le trait fabuleux de Bradé (quelque part entre Boucq, Léturgie et Alary, sans oublier les maîtres de la Ligne Claire, vous allez voir). Raison de plus pour aller à leur rencontre, au-dessus des toits, auprès d’un Paris en construction.

© Piatti/Badré chez Y.I.L.
Bonjour Pascal et… Pascal. Tout d’abord, questions classiques mais essentielles. Qui êtes-vous ? D’où nous venez-vous ?
Pascal Piatti : Je suis auteur BD originaire de Toulon, pays où les cigales chantent et où règne un soleil de plomb.
Pascal Badré : Ardennais d’origine, je suis né il y a 46 ans à Sedan. Marié je suis père d’une fille de 19 ans, Solenne qui est étudiante à Besançon.
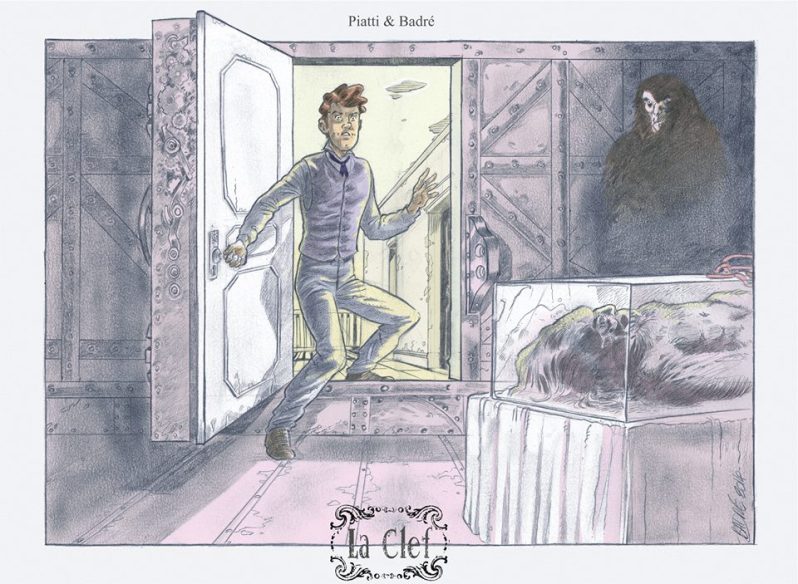
© Piatti/Badré chez Y.I.L.
Vous destiniez-vous à devenir auteur de BD, un jour ?
P.P. : Oui en effet, depuis tout petit, j’aspirais fortement à être auteur BD. C’était dans mon ADN.
P.B. : Il y a une dizaine d’années, nous avons quitté nos vertes Ardennes pour tenter l’aventure dans l’Allier où nous sommes restés 3 ans puis nous avons atterri dans le Jura. La BD est pour moi une passion qui ne me fait pas vivre. Pour remplir le frigidaire, je suis pétrisseur dans une usine agroalimentaire qui produit des pâtés croûte (je fais la pâte) et je travaille de nuit ce qui me laisse du temps pour m’adonner à ma passion.

© Badré
Qu’est-ce qui vous a filé le virus ?
P.P. : Mon père m’a montré Tintin, Astérix et Lucky Luke que je lisais déjà à 7-8 ans.
P.B. : Du plus loin dont je me rappelle, j’ai toujours dessiné. Ma mère reproduisait les dessins de Dubout et j’essayais de les recopier.

© Piatti/Badré
Et quels ont été vos premiers émois ?
P.P. J’ai adoré Tintin et Astérix quand j’étais haut comme trois pommes. Puis à l’adolescence, j’ai découvert Boule et Bill et le Marsupilami. Et c’est bien plus tard à 18 ans que j’ai eu ma première claque graphique en dévorant Largo Winch et XIII. Mes maîtres sont à chercher du côté d’Hermann, Marini, Bec, Meyer, Francq, Abolin et Alice, en dessin; et de Bec, Marazano, Dufaux et Van Hamme, au scénario.
Comment avez-vous appris à faire de la BD, que ce soit au scénario ou au dessin ? De manière autodidacte ou soutenues par des aides extérieures.
P.P. : J’ai appris à faire de la BD en lisant beaucoup de BD. Je me suis beaucoup inspiré et j’ai absorbé une quantité énorme de BD.
P.B. : Disons que le monde de la Bd s’est ouvert à moi par le biais de Hergé, Franquin, Morris et Uderzo. Pour apprendre à dessiner, je recopiais leurs dessins.
Un projet « Ligne Claire » resté dans les cartons

©Chanoinat/Marniquet/Badré
Qu’est-ce qui vous a permis de passer du rêve à la réalité ? Des rencontres ont-elles joué ?
P.P. : J’ai rencontré Georges Abolin, en 2007 qui m’a poussé et boosté en me disant que j’étais sur la bonne voie. Puis Alain Janolle, en 2009, qui m’a donné de très bons conseils. Après par la suite, j’ai réussi à frapper aux bonnes portes en croyant en moi et à mes projets BD futurs.
P.B. : Moi, c’est avec Paul Glaudel que j’ai collaboré sur un projet de gags à la page sur un routier à qui il arrive beaucoup de mésaventures qui n’a pas abouti mais pendant cette collaboration, j’ai encore et toujours glané des conseils. Ensuite j’ai participé au collectif d’OPALE BD « Le p’ti Ch’ti qui monte ».

© Glaudel/Badré
Pascal Piatti, vous avez déjà signé quelques albums, dans divers genres. Cela vous plait d’être éclectique ?
P.P. : J’adore toucher à tous les genres en effet. Je ne me laisse aucune limite du moment qu’il y a une bonne histoire derrière. Je prends énormément de plaisir à passer du thriller à l’historique ou au western. Mais j’ai quand même une grande préférence pour l’historique et la SF, genres que j’affectionne grandement. Je commence depuis peu à être assez calé en histoire médiévale, le XIIIème siècle pour être précis.

© Piatti/Verbecq/Mannicot
Quels sont les bonnes conditions pour susciter et activer l’imagination ?
P.P. : Il n’y en a pas forcément. Depuis peu, certains films m’inspirent et certains romans historiques m’influencent. J’ai aussi l’habitude de lire des revues scientifiques ou historiques, et j’arrive à imaginer une histoire originale.
Les différentes collaborations avec les dessinateurs (Frappier, Guengant, Mor…) vous ont appris et fait évoluer ?
P.P : Oui ces collaborations m’ont fait évoluer dans ma technique narrative, m’ont appris à gagner en rapidité d’écriture tout en gardant une réelle efficacité. Mais j’ai surtout appris à croire en mon histoire et à collaborer pour rechercher la meilleure façon de raconter une histoire graphiquement.

La bête de Jumièges © Piatti/Mor chez Tartamudo
Si on reprend le fil, vous, Pascal Badré, on vous retrouve en 2003 sous le synonyme de Bader pour Désiré Galopin. Un premier acte et puis plus grand-chose, malheureusement. Il est dur ce monde-là ?
P.B. : Longtemps après ma rencontre avec Paul Glaudel, j’ai eu l’occasion de rencontrer Servais à plusieurs reprises (il n’habitait pas très loin de chez moi). Avec d’autres rêveurs, nous avons créé notre fanzine : le CAID (Club des Amis d’Images Dessinées). Cela m’a permis de rencontrer d’autres dessinateurs – scénaristes et de me lancer dans ma première BD : Galopin aux éditions DEMGE publiée en 2003.
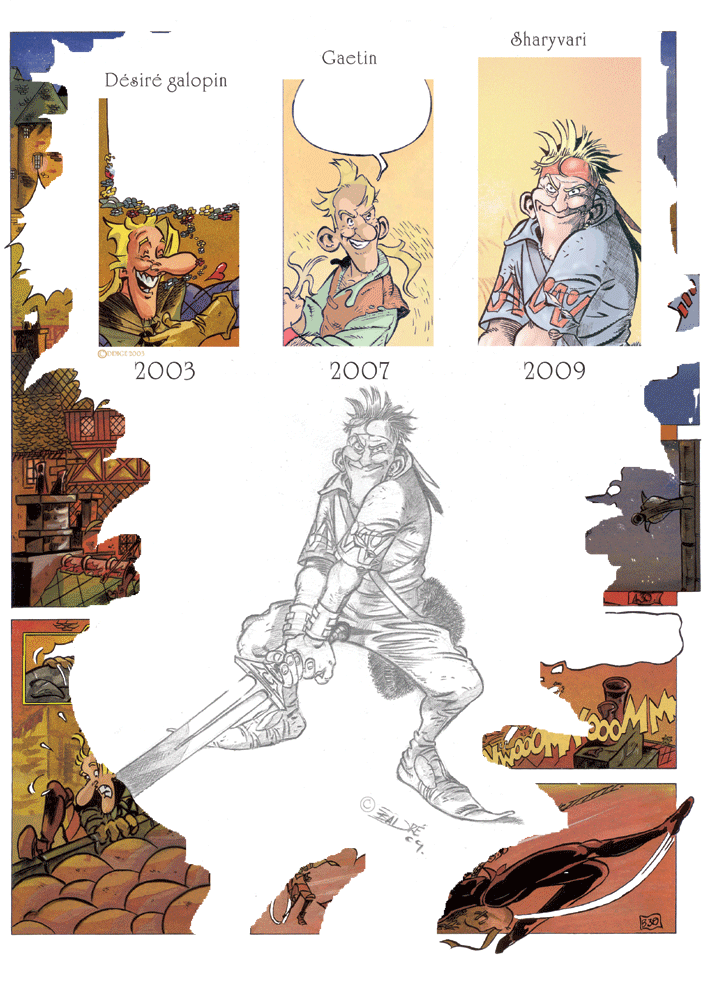
Évolution du personnage fétiche de Pascal Badré de Galopin à Sharyvary (Trinidad) ©Badré
J’ai enchaîné en participant à un collectif « Aux portes du passé » (chez le même éditeur) qui réunissaient de grands noms tels Hermann, Ramaiolli, Rollin. J’ai même colorisé les planches de ces deux derniers auteurs… J’ai ainsi été invité au festival d’Illzach où j’ai pu recevoir de nombreux conseils de pros.
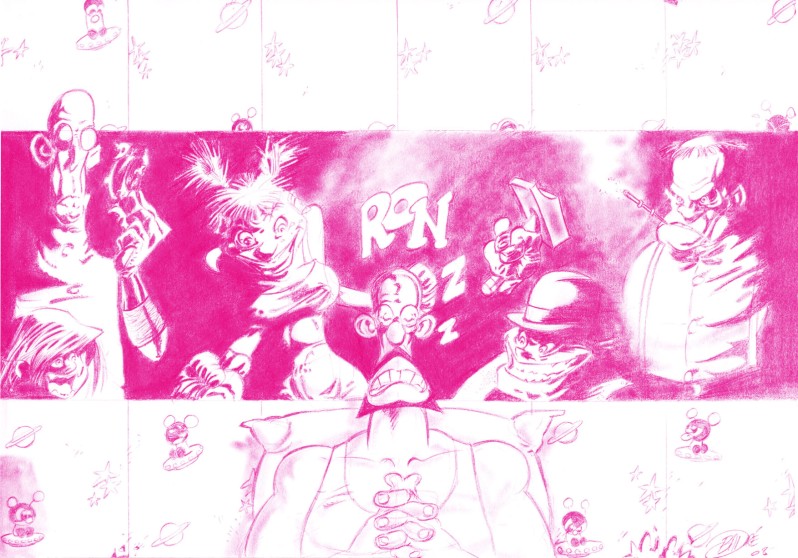
Marcel le super-héros éphémère © Badré
J’ai toujours continué à dessiner et, par le biais d’Internet, j’ai rencontré Joris Chamblain qui m’a proposé une histoire courte de quatre planches : Blake qui a été publié dans le Lanfeust Mag. Un deuxième volet de cinq planches a été, à nouveau, publié quelques mois plus tard.

© Chamblain/Badré
J’ai enchaîné avec un projet de BD avec Philippe Chanoinat et Frédéric Marniquet au scénario. Malheureusement, l’éditeur n’avait pas les reins assez solides et 32 planches dorment dans un tiroir.
Plus tard, c’est aux-côtés de Pascal Piatti qu’on vous a revu pour ce qui, à la base, était votre projet : l’histoire courte Trinidad. Une belle expérience ?
P.B. : Toujours via internet, j’ai rencontré Pascal Piatti à qui j’ai proposé mon idée de BD intitulée Trinidad, une histoire de pirate-fantasy dont nous avons publié un extrait dans un collectif « Envies d’ailleurs » sous l’égide de Katia Even pour ensuite nous concentrer sur « la clef ». Le pitch ? Deux inséparables flibustiers sont contraints par la force des choses de retrouver l’épée Al’ Batar qui est en réalité la neuvième clé manquante pour ouvrir les neufs portes du grand frêne…

© Piatti/Badré
P.P. : J’ai rencontré Pascal, en janvier 2012, après avoir laissé une annonce sur le Café Salé, Pascal m’avait contacté pour faire une page test sur un projet de SF. Et puis quelques mois plus tard, on démarrait un autre projet, « Trinidad », donc. Cet album d’aventure, de pirates sur une légende viking. J’appelais ce genre de la « pirate fantasy » à l’instar de la franchise « Pirates des Caraïbes ». Finalement, Pascal me recontacta en juillet 2014 pour démarrer un album sur le Paris du XIXème siècle, histoire que Pascal avait développée, des années auparavant, et dont il voulait remanier.

© Piatti/Badré
Trinidad, cela a été comme une évidence, une envie de prolonger la collaboration sur un format plus long et plus abouti.
Ainsi, sur les toits, tel un nouvel Arsène Lupin, Anatole semble voler vers un nouveau méfait. Or non, on n’y est pas du tout : il est en réalité… serrurier refusant s’introduisant dans les maisons pour évacuer la frustration de ne pas savoir ce que les clés qui passent dans ses mains ouvrent. L’idée est brillante mais d’où vient-elle ? Quelle est la genèse de cette histoire ?
P.B. : L’idée de La Clé est partie de l’objet clef. Je voulais en faire une histoire avec comme point central, une porte camouflée (la fameuse porte !) et j’ai commencé à broder mes personnages tout autour de cette idée (serrurier curieux, porte cachée…).

© Piatti/Badré
À l’époque, peut-on dire que vous aviez trouvé en Pascal Piatti l’allié parfait ?
P.B. : Pascal Piatti est effectivement un allié parfait, il a un bon découpage, un style d’écriture qui m’inspire et il a l’esprit ouvert, nous foisonnons tous les deux d’idées et il sait en extirper le meilleur. J’aime beaucoup travailler avec lui.
Il y avait résolument de très belles choses à faire avec le dessin de Badré ? Comment le décririez-vous, ce dessin ? Quel effet vous a-t-il fait ?
P.P. : C’est un dessin très nerveux, un peu dans la lignée d’une « ligne claire » mais en gardant la nervosité et l’humour d’un Franquin. Les trognes de ses personnages gardent une certaine fraîcheur et une drôlerie sans pareil. J’ai adoré travailler avec Pascal, son dessin m’inspirant à chaque fois. Comme la scène de la découverte du petit chat dans « La clef » partie d’un délire commun que j’ai pris au mot en intégrant ce petit animal qui fait bien le lien entre l’aspect sérieux de la quête du personnage d’Anatole et le côté comique qu’avait Anatole en lui donnant la réplique et étant son confident.

© Piatti/Badré
Pascal Badré, comment définiriez-vous votre dessin ? Quelle est votre méthode de travail ? Des difficultés sur cet album ?
P.B. : La plus grande difficulté pour moi est le manque de temps (du fait de mon emploi) ce qui m’empêche d’être à 100% sur la BD et m’oblige à me reprendre en plusieurs fois sur un dessin. Ma méthode est simple : croquis au crayon papier pour aller vers un dessin plus poussé, cadrage en feutre noir puis dessin définitif à l’encre de chine : plume et pinceau.

© Piatti/Badré chez Y.I.L.
Dès le départ, le ton est donné, vous jouez malicieusement avec l’ambiguïté et les apparences, non ?
P.B. : Cette idée provient de Pascal Badré et je l’ai poussé encore plus loin afin de surprendre encore plus le lecteur.
Si vous aviez le « pouvoir » d’Anatole, chez qui aimeriez-vous vous introduire ?
P.P. : Partout. J’aimerais découvrir la vie des gens qui vivent à proximité de chez moi et découvrir leur moindre secret.

© Piatti/Badré
P.B. : Le pouvoir d’Anatole n’est pas complet pour moi car avec ses clefs, il me faudrait l’invisibilité : je me pencherais alors sur l’épaule de mes maîtres en BD pour leur « piquer » quelques techniques de dessin.
Naturellement, tout ça n’est pas sans risque et la surprise guette. Et qui sait ce que la prochaine porte pourrait ouvrir. La clef nous emmène dans des univers riches et variés : on pense à la quête du yéti, à Dr Jekyll et Mr. Hyde mais aussi, pourquoi pas, à King Kong. Des références qui vous parlent ?
P.P. : Oui la volonté était de surfer sur les récits de Jules Verne, de Stevenson pour son Dr Jekyll et Mr Hyde, sur Alan Edgar Poe, car le XIXème siècle était un siècle riche en découverte et en progrès technologique. Ce siècle ouvrait forcément une multitude de possibilités d’histoires plus étonnantes les unes des autres.
C’est aussi l’occasion de nous promener dans le Paris de la fin de 1800, la Tour Eiffel est en bonne voie, vous aimez voyager dans le temps du bout de votre stylo ou de votre crayon ? Documentation à l’appui ? Des films, des dessins… ?
P.P. : Peu de documents, à peine quelques photos d’époque du Paris de la fin XIXème. Le reste a été surtout sorti de notre imagination commune autour du XIXème siècle et fortement inspiré des récits de Jules Verne ou d’Arsène Lupin.

© Piatti/Badré chez Y.I.L.
Autre voyage, celui entre la nuit, le jour et des souvenirs des Alpes Bavaroises. Et le jeu des couleurs qui va avec. Comment vous y êtes-vous pris ?
P.B. : Au départ, j’avais colorisé en couleurs simples et c’est Pascal qui a eu l’idée des couleurs avec effet ancien pour les flashbacks.
Arrivé à la fin de cet album, on se dit qu’il y aurait bien d’autres portes à ouvrir. Une suite pourrait-elle voir le jour ?
P.P. : Nous nous ne sommes jamais posé cette question, en tout cas pour mon cas pensant que cette fin suffisait à elle-même. Anatole part en effet vers d’autres horizons. Cette fin ouverte permet aussi d’imaginer une suite mais elle me plait dans le sens que le lecteur pourrait très bien imaginer par lui-même cette suite. Pour l’instant je n’éprouve pas le besoin d’imaginer une suite… mais on verra bien comment cet album est accueilli…
P.B. : Je ne suis pas enclin à créer une suite et je suis totalement le raisonnement de Pascal : comme d’habitude, on est d’accord.

© Piatti/Badré
Quels sont vos autres projets à tous les deux ?
P.P. : Une série historique se passant dans le XIIIème siècle, un album sur le Périgord en 1398, un album érotique, une série de SF, deux westerns et d’autres sujets d’histoire à développer.
P.B. : Mon prochain projet est une BD qui se déroulera dans les années 60. J’ai également sous le coude une histoire courte en collaboration avec ma fille.
Merci à tous les deux, et bonne route, qu’elle soit faite de passion mais aussi de reconnaissance porteuse de projets, on l’espère. En attendant, nous ne pouvons qu’inciter nos lecteurs à visiter vos blogs (Callusworld pour Pascal Piatti et Dans ma bulle pour Pascal Badré) et d’y découvrir plein de chouettes choses.
Propos recueillis par Alexis Seny

C’est un fait, l’expression Adieu monde cruel a souvent été reprise pour prêter à rire ou pour souuligner un drame. Cette fois, l’expression reprise et adaptée par Titeuf, on s’en souvient, donne le titre d’un album qui emmènent quatre héros malgré eux et suicidaires sur la route d’un suicide raté. Une aventure rocambolesque rendue par Nicolas Delestret sur un scénario d’Olivier Massard et Jean Rousselot. Ce dernier, scénariste mais avant tout cinéaste (couronné par un Ours d’or à Berlin pour le court-métrage « Hommage à Alfred Lepetit »), ajoute une corde a son arc, tout en continuant de cultiver l’amour des gens ordinaires, de l’ombre. Nous l’avons rencontré.

© Bamboo
Bonjour Jean. La première question est inévitable, comment va Alfred Lepetit ?
(Il rit). Bien, bien, je crois. Ces derniers temps, je n’ai plus trop de nouvelles. Mais je crois qu’il est toujours stagiaire sur les plateaux de cinéma.
En effet, aujourd’hui, c’est loin des plateaux de cinéma qu’on vous retrouve, sur les planches… de bande dessinée. Comment y êtes-vous venu ?
Je n’en suis pas un spécialiste, pas même un connaisseur. J’en achète, j’en lis, j’aime ce média. Et, pour tout dire, cette incursion dans la BD n’est pas une idée qui venait de nous, mon compagnon de route, Stéphane Massard, et moi-même. À la base, il y a une histoire écrite. Vous savez, les écrits restent ou pas. Ici, il est resté. Jusqu’au jour où une connaissance nous a mis en contact avec Bamboo. De fil en aiguille, notre projet s’est avéré mieux convenir à la collection Grand Angle. On l’y a proposé et l’aventure pouvait continuer.
Avant cette rencontre avec le Neuvième Art, il y avait une histoire orpheline de médias, si je comprends bien ?
C’est ça. Elle avait été écrite naturellement, comme un scénario.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle
Quelle est sa genèse ?
À la base, il y a ce phénomène dramatique au Japon : chaque année, des dizaines de gens désespérés organisent leur suicide avec d’autres personnes, qu’ils ne connaissent pas généralement, à bord de voitures closes dont ils actionnent le réchaud pour s’asphyxier. Ce qui nous a mis la puce à l’oreille, c’est une tentative de suicide collectif similaire, en France. Sauf que ça a foiré. Pour X ou Y raison, ils se sont engueulés.
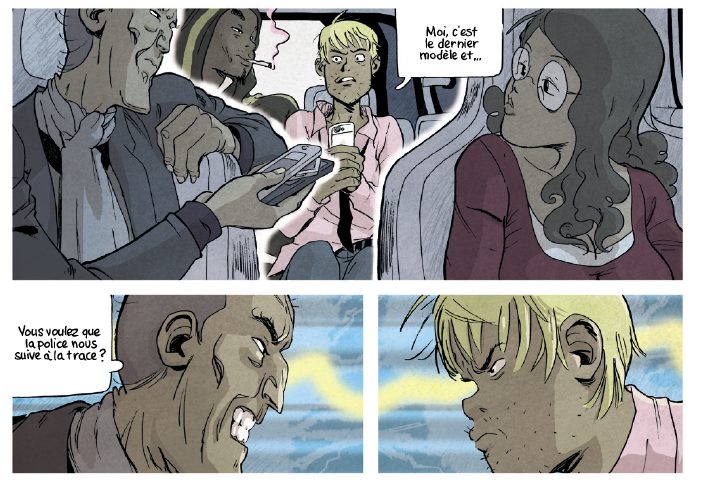
© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle
Ça me plaisait d’imaginer pareille situation dans une histoire. Mais le traitement final n’est pas du tout celui que nous avions imaginé, au début. Nous nous avancions plus dans une histoire policière. Un mauvais fait divers.
Puis, l’idée est venue de voir ça sous un autre angle et de suivre un quatuor aux horizons totalement différents et qui se serait formé anonymement grâce à Internet. Et de leur mettre plein d’embûches entravant leur volonté d’en finir. Naturellement, dans un groupe, il y a toujours quelqu’un qui veut aller jusqu’au bout. Nous allions voir ce qu’il en était. Peut-être, pourrions-nous amener ces personnages à accepter la vie telle qu’elle est, malgré les pépins.
Ils sont d’ailleurs très contemporains, ces protagonistes, minés par des phénomènes réellement en prise avec le monde d’aujourd’hui : la maladie, la perte d’un emploi…
Oui, si nous les réunissions dans une seule et même voiture, nous voulions qu’ils viennent de quotidiens totalement différents. Et qu’ils soient tellement bloqués sur leur propre misère qu’ils soient incapables de voir les malheurs des autres. D’autant plus qu’ils ont comme objectif de se suicider dans l’anonymat le plus complet et chacun en en sachant le moins possible sur les trois autres.

© Rousselot/Massard/Delestret
Mais, dans son égoïsme, chacun a une histoire très forte et est convaincu que celle des autres n’en vaut pas la peine. Jusqu’à ce que nous trouvions, comment les relier. Mais, oui, nous voulions des gens normaux.
… et anonymes.
Oui, dès le départ, nous aimions cette idée. Nous imaginions quatre personnes à l’aube, sur une terrasse. Avec une surprise : ils ne se connaissent pas mais veulent… se suicider et ont choisi une méthode sans douleur, sans violence. Ce ne sont pas des gens qui veulent souffrir. Ils estiment déjà avoir souffert dans leur vie, avec des tracas qui ont démoli leurs grandes entreprises. Et, au moment où ils ne veulent plus de cette vie, elle continue, elle s’accroche, de toute son ironie.

Recherches de personnages © Rousselot/Massard/Delestret
Vous aimez vous intéresser aux hommes et femmes de l’ombre, communs, non ?
Clairement, ces gens qu’on ne voit pas et qui, pourtant, se donnent, chaque Jour. On parlait d’Alfred Lepetit, tout à l’heure. Je suis en train de préparer un autre faux-documentaire. Je recherche un partenaire pour ce faire. On explorera encore une fois l’ombre dans le monde artistique en général. Ce sera un long-métrage, le faux se mêlera au faux.
Au fond, c’est une pièce théâtre en road movie, non?
C’est vrai, nous nous le sommes dit avec mon coauteur. Cet album procède en quelque sorte par tableaux, d’un endroit à l’autre, tous reliés par un déplacement qui tourne… en rond. Pas si loin d’En attendant Godot, en fait.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle
Grand Angle a comme slogan « La BD comme au cinéma », ça ne pouvait pas mieux vous parler.
Cet album, c’est la rencontre d’une collection avec nos envies. Une histoire avec un côté Little Miss Sunshine, absurde mais dans laquelle les personnages apprennent à se connaître, comme un rite initiatique.
Et, justement, quelle force, quel impact trouvez-vous à la BD par rapport au cinéma ?
D’abord, la BD possède une immédiateté. Ça existe, c’est palpable. Si on veut aller plus loin, j’ai appris, avec Hervé Richez et Nicolas Delestret, le découpage. Au départ, j’imaginais une scène en plusieurs cases, je les démultipliais. Puis, j’ai compris qu’on pouvait être plus fort en une ou deux cases, seulement. J’y ai gagné en fluidité. C’est devenu mon obsession.

© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle
Et votre expérience de cinéaste, elle vous a servi ?
J’étais comme un collégien, très en attente face à cette impression de nouveau média. Ce qui pourrait relier les deux arts, c’est le storyboard. Bon, je ne sais pas dessiner. Mais ce storyboard, c’est l’occasion de se demander le plan qu’on va utiliser, le temps qu’on va y passer. Dans le cas d’une BD, le storyboard va avoir un impact direct sur la forme finale, sur les planches, les cases que Nicolas va dessiner. Le dessin, que ce soit pour un court- ou un long-métrage, est un outil. Alors que dans la BD, c’est lui la fin.
Au dessin, on retrouve Nicolas Delestret qui n’avait plus sorti d’album depuis quelques années.
S’il avait fait ses armes dans la bande dessinée historique, il a eu un vrai coup de coeur pour cette histoire. Nous avons beaucoup échangé, Nicolas nous a appris avec beaucoup de bienveillance son savoir-faire. Notamment pour rendre une séquence beaucoup plus dynamique et y mettre plus d’énergie, ce que je ne trouvais pas évident, quand certaines planches étaient trop longues, qu’une scène était trop serrée dans une planche.
De chaque côté, il y a eu de l’humilité, de la simplicité. Et cet album qui aurait pu être glauque ne l’est pas du tout tant il est vivant et très coloré. Tout de suite, nous avons tous les trois eu la même vision, il n’y a pas eu à se pousser dans la direction qu’un seul membre de l’équipe souhaitait. Nous avons passé beaucoup de temps à peaufiner l’expression, le rendu.
Recherches de personnages © Rousselot/Massard/Delestret
Qu’est-ce que ça fait de tenir dans les mains son premier album ?
Oulala, on ne sait plus rien faire, c’est imprimé, définitif. (rires) L’objet est assez beau, j’aime cette sensation de pouvoir le tenir. Je suis heureux de l’emballage comme du contenu.
Lui donner une couverture fut tout de même assez fastidieux, non ?
C’est vrai que ce processus fut assez long. Pour le coup, on n’a pas toujours été d’accord. La volonté de l’éditeur était une couverture qui rassure. Il fallait que l’enjeu se retrouve sur cette couverture mais avec le sourire. Nous avions envie que les personnages nous interpellent : « Venez avec nous ! » On a bien cru ne jamais y arriver, ce fut complexe et long.
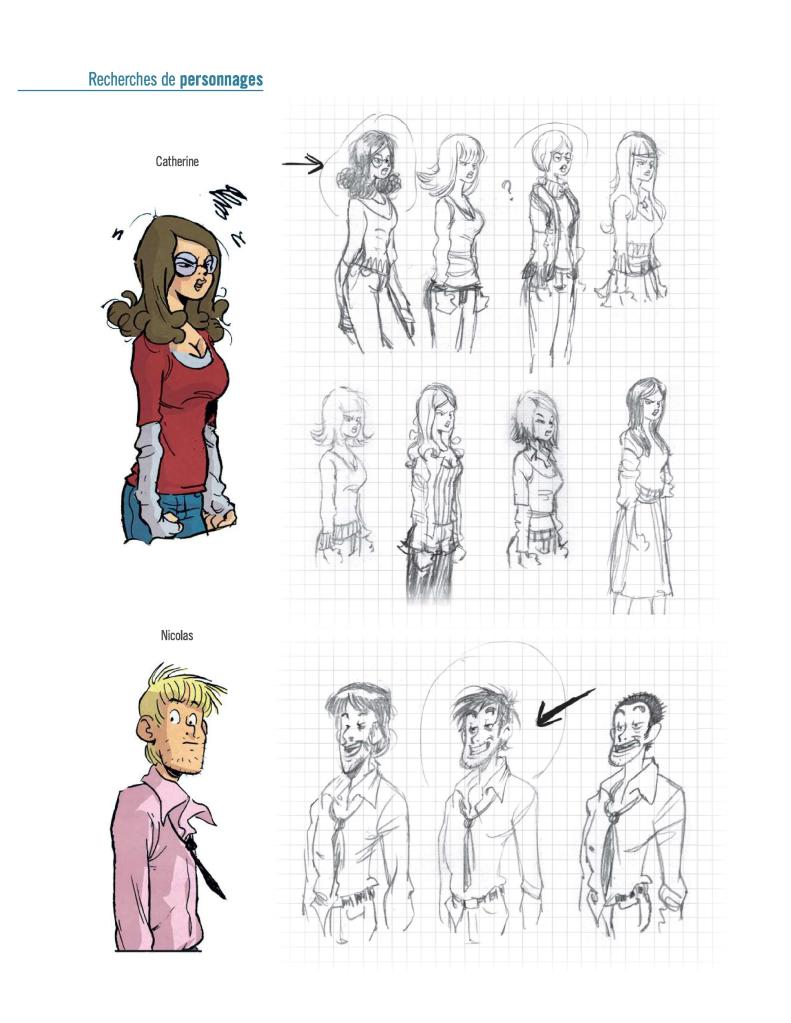
© Rousselot/Massard/Delestret chez Grand Angle
Quelle est la suite, du coup ? Encore de la BD.
Oui, nous avons un autre projet BD avec Stéphane, aussi chez Bamboo : Le monde selon Jacques. Une comédie sur un homme de 25 ans qui croit tout ce qu’on lui raconte, qui voit la fleur au-dessus du tas de boue. Nicolas était occupé sur « Adieu monde cruel », donc nous avons fait appel à un autre dessinateur. Puis, nous mûrissons un autre projet avec la même équipe qu’Adieu monde cruel.
On va garder ça à l’oeil, un grand merci, Jean !
Propos recueillis par Alexis Seny

Thierry Gloris, scénariste, nous a accordé un entretien téléphonique passionné et passionnant. En voici la première partie consacrée à sa nouvelle série événement : Une generation française.

Thierry Gloris
Bonjour Thierry. « Nous vaincrons », premier album de la série « une génération française », raconte le destin de Martin Favre. Qui est-il ?
C’est un étudiant ordinaire, qui a une petite vingtaine d’années en 1940 que l’on pourrait situer au centre gauche. Il est issu d’une famille socialiste de la petite classe moyenne, affichant même quelques affinités avec les communistes de l’époque.
En 1938, Martin est étudiant en civilisation Allemande. Il côtoie des camarades Allemands sur les bancs de l’université. Il y avait donc déjà dès cette époque des passerelles internationales entre les facultés. Une sorte d’Erasmus avant l’heure ?
Non… Dans l’absolu, son camarade d’université, Kurt, comme d’autres jeunes Allemands à cette époque, est destiné à occuper des responsabilités au sein du parti nazi. Dans les années 30, ces futurs cadres étaient envoyés un peu partout en Europe pour étudier, et par la même occasion nouer des contacts et créer des réseaux, souvent dans l’optique de pouvoir servir d’espions ultérieurement. Il y en avait partout, en Russie, en Angleterre, en France. C’est pour cela que par la suite les services de sécurité de ces pays ont bouclé tous les Allemands même s’ils n’étaient pas nazis. La peur d'une cinquième colonne.
Gloris/Ocana/Garcia/Koehler
Kurt Dietrich fait entendre à martin les sirènes d’appel au IIIème Reich. Les principaux acteurs de cette politique ont-ils tenté dans les années 30 une invasion pacifique, comme cela pourrait l’être dans une secte avant d’employer la force ?
La situation était un peu paradoxale. Droite et extrême-droite avaient des sentiments anti-germanistes dus aux ressentiments liés à la Première Guerre mondiale. Mais il existait une fascination des partis d’extrême-droite français pour l’Allemagne nazie. Le phénomène n’est pas propre à l’époque, il suffit d’ouvrir les yeux sur le FN actuellement. De nos jours encore, il existe un bal annuel en Autriche qui réunit des membres de partis d’extrême-droite issus de plusieurs pays européens. Malgré les rivalités qui peuvent exister entre les partis d'extrême droite de ces différents pays, on constate une sorte de solidarité entre eux (Marine Le Pen y a participé en 2012). Dans l’album, Martin, le héros, de par son amitié avec Kurt, est amené à côtoyer un peu ces milieux, sans toutefois y entrer. Il a plus un rôle de spectateur. Il aime bien son camarade allemand, avec qui il partage la passion des femmes. Il n’en sait pas plus sur lui. D’ailleurs, dans l’album, Kurt n’est encore qu’un étudiant. Il va aller là où il doit aller. Contrairement à un cliché répandu, tous les nazis n'étaient pas que des brutes incultes. Certains étaient des universitaires avec un haut degré d'instruction,
Y a-t-il eu de ces étudiants Allemands en France qui ont pu choisir de rejoindre les rangs Français ?
Au niveau des étudiants, je ne sais pas. En revanche, il y a eu des soldats durant l’Occupation, qui sont rentrés dans la résistance française en tant que soldats Allemands, donc sous uniforme Allemand, souvent par ferveur communiste. Ce sont des communistes allemands qui ont réussi à « passer sous le radar », car les communistes étaient envoyés en camps ou rééduqués, et sont donc entrés en contact avec la résistance française une fois que l’Allemagne nazie est entrée en guerre contre l’Union Soviétique. Donc il y a eu des soldats Allemands occupants qui ont aidé la résistance française. J’ai recensé au moins deux cas, un qui a écrit un livre, l’autre qui a fait pas mal de témoignages en télévision ou en presse.
© Gloris/Ocana/Garcia/Koehler Quadrants
Martin, tout d’abord plus préoccupé par les marivaudages, se rend compte qu’il est obligé de s’impliquer. Il défend ses amis Allemands contre un groupe de l’action Française et c’est Otto Abetz, chargé de promouvoir la politique du IIIème Reich, qui le sort de garde à vue. Pour Martin c’est à en perdre le Nord…
Oui. Au milieu des années 30, on trouve beaucoup de similitudes avec la situation actuelle, même si de nos jours il n’y a pas la menace de l’Allemagne nazie aux portes de la France. Les gens étaient complètement déboussolés. Ils ne réagissaient qu’à l’instinct, un peu comme actuellement, les gens réagissent à chaud à telle ou telle information qui sort dans les médias. Il n’y a pas de réflexion sur le long terme, il n’y a souvent pas de raisonnement politique réfléchi et structuré. Martin est dans cette logique-là. Du fait de l’implication politique de sa famille qu'il subit depuis l’enfance, il est dans le rejet de l'engagement, du militantisme. Il est dans la logique du « je ne veux pas m’impliquer », alors que les circonstances l’obligeront à s’engager. Pourtant, il ne réagit qu’à l’instinct, car pour l’instant il est jeune et sa conscience politique n’est même pas éveillée alors que l’Allemagne nazie est là et que déjà retentissent les bruits de bottes. C’est un peu comme actuellement, avec les gens qui ne s’impliquent pas, même pour aller voter. Mais là, l’enjeu est complètement différent. Le parallèle fonctionne du point de vu de l'attentisme psychologique pas vis à vis du contexte historique. Mais le rôle du scénariste n'est-il pas de créer de l'empathie entre un lecteur contemporain et un héros du passé en leur faisant partager un même « état psychologique » ?
Martin est incontestablement un pacifiste. Malgré un père socialiste, ayant subi la grande guerre, et souhaitant que tout soit fait pour éviter une nouvelle invasion, Martin espère que la situation va s’apaiser toute seule.
Oui, Martin est pacifiste, mais il a une véritable passion pour l’Allemagne. D’un point de vue psychologique des personnages, le père à une telle répugnance pour ce pays qu’il a combattu, que le fils en éprouve une véritable passion. Dans ce sens-là, il arrive à comprendre pourquoi le conflit de 14/18 a eu lieu sans voir arriver celui de 39. C’est cela qui l’intéresse. Finalement, celui de 39 ça ne l’intéresse pas puisque ça le touche directement alors que celui de 14/18 fait partie de l’Histoire. On peut bien reconstruire sur quelque chose qui est ancien, mais voir le futur est complexe. C’est le concept de la paille et de la poutre. On voit la paille dans l’œil du voisin mais on ne voit pas la poutre que l’on a dans le sien. Martin n’arrive pas à se projeter…ou il ne veut pas.
Dès 1938, des hommes politiques comme De Gaulle et Reynaud, ministre de la défense, voient en Hitler un réel danger et s’apprêtent à aller au conflit armé, alors que Daladier, président du conseil serait plutôt prêt à collaborer…
Non, je ne suis pas tout à fait d’accord. En 1938, nous avons des politiciens au pouvoir. On n’est pas sûr que la guerre va arriver. Ils ne la voient que comme un événement politique et non comme un événement qui pourrait être criminel. Si ça arrive, il va falloir créer une union sacrée de tous les partis politiques français. Si on crée cette union sacrée, il va falloir en exclure les communistes parce que les soviétiques ont une position ambiguë vis à vis de l'Allemagne nazie en 1938. Les politiciens ne réfléchissent qu’en terme politique et non pas en terme militaire ou en terme de guerre totale. Ils ne perçoivent pas le danger mortel pour la République de l'Hitlérisme.
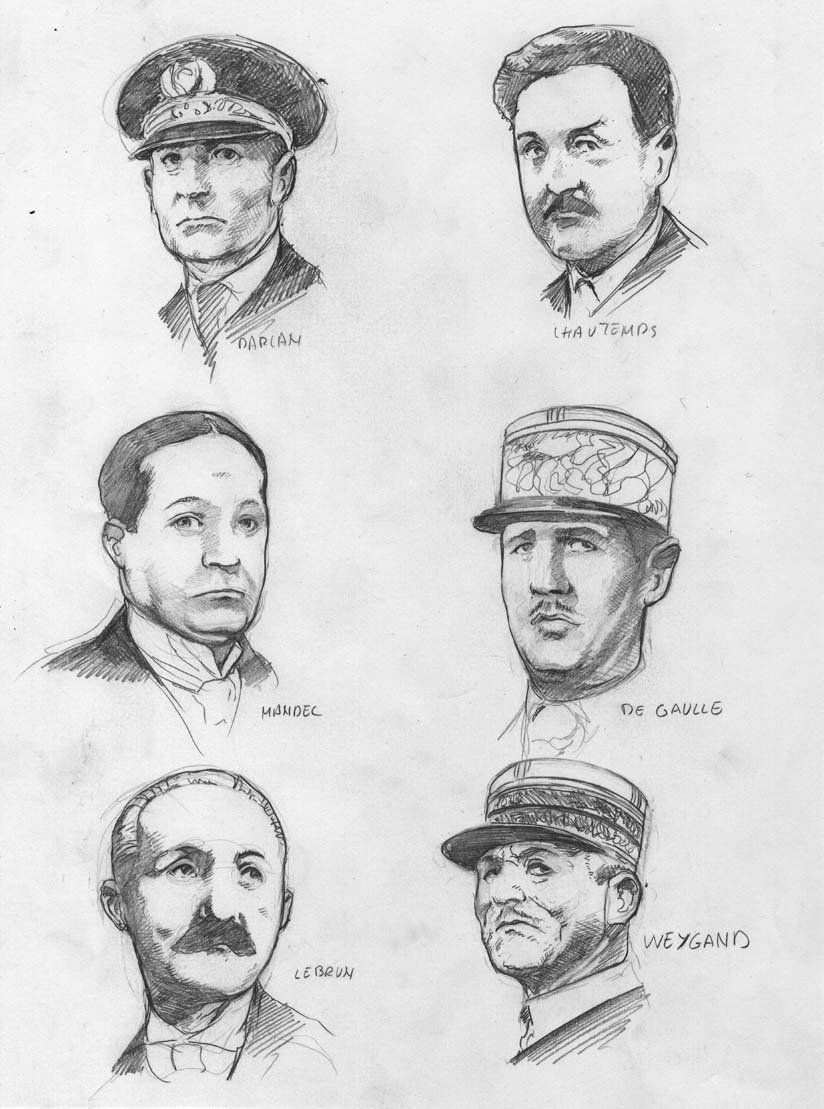
© Gloris/Ocana/Garcia/Koehler - Quadrants
La guerre totale, c’est totalement nouveau. C’est Hitler qui l’invente. Ça n’existait pas avant. Lorsqu’il y avait une guerre, on envoyait le peuple se faire déchirer sous les canons. C’était le cycle normal de l’Histoire. L'un des protagonistes arrachaient des gains, souvent territoriaux, à l'autre. Un traité venait officialiser l'état de fait. Puis on attendait la guerre suivante. Là, sur cette guerre qui va arriver, on est sur quelque chose de complètement différent. L'industrialisation fait que la masse démographique n'est plus la donnée primordiale. Le seul qui a cette vision sur la mécanisation de la guerre pouvant amener à des catastrophes, c’est De Gaulle. C’est un théoricien militaire. En se disant que rien n’arrêtera une armée de chars, ce qui a été une réalité en 40, il arrive à penser que l’état, ou tout du moins une armée, peut complètement s’effondrer. Mais il est le seul parce que les autres sont des politiciens. Ils réfléchissent en terme de carrière, de placement des copains. Quand arrive le régime de Vichy avec le Maréchal Pétain, on a à peu près le même marigot politique qui se reconstitue. Malgré la présence des Allemands, malgré l’armée Française qui est complètement détruite, ils réfléchissent toujours en terme politique. Ils font de petits arrangements, de petites combinaisons. Même si au fur et à mesure la politique de Pétain va exclure de plus en plus pour révéler sa vraie nature : Un pouvoir réactionnaire et raciste à la botte des nazis.
Martin va inévitablement se trouver mobilisé. Cet épicurien garde le sourire mais il va se trouver sous les ordres du sergent Lemark, véritable tyran pour ses troupes. Est-ce un cliché ou la majorité des gradés étaient-ils de cette trempe ?
Lemark est un sous-officier, pas officier. Il est relativement proche de ses hommes, même si c'est une peau de vache. Il y a une petite différence. Dans son livre L’étrange défaite, l’historien Marc Bloch raconte qu’en 1940 il a été mobilisé en tant qu’officier de réserve. Il a connu la défaite. Cet ouvrage est très intéressant car il a été écrit par un intellectuel, à chaud avec pourtant un recul extraordinaire. Ce recul-là, les historiens l’auront quinze ans après la fin du conflit. Lui l’a quasiment immédiatement. Il explique que les sous-officiers, étant proches de la troupe, étaient d'excellents rouages de la chaîne de commandement. Lemark, par exemple, dans tout ce qu’il a de gueulard, voulant que ses hommes se fassent violence pour aller toujours plus vite, plus loin, est dans une logique de préservation de ses troupes. La sueur épargne le sang. Du côté des sous-officiers il n’y avait pas de problème. Ils étaient là. Ils étaient professionnels. La troupe, c’était comme les conscrits de 14, ils n’avaient pas trop envie de se bouger. Mais avec les sous-officiers qui étaient là pour les encadrer, il n’y a pas eu de réels soucis. Ils ont fait leur « devoir ». En revanche, du côté des officiers, c’était n’importe quoi. Le problème ne venait donc pas des sous-officiers ou de la troupe mais du haut commandement. Il y a plusieurs témoignages de Bloch racontant ne pas avoir de nouvelles de son officier de commandement, disparu pendant trois semaines. D’un autre côté, il disait aussi qu’au niveau du commandement, en fonction des différents corps qui sont censés collaborer ensemble, chacun était jaloux de sa propre autorité. Chacun faisait donc des notes qui devaient remonter plus haut à la hiérarchie. Moralité, ça prenait un temps monstrueux et rien ne se faisait. Cette situation se retrouvait au plus haut du commandement français, le général Gamelin ne supportant pas son principal second, le général Georges. Les deux hommes communiquaient quasi uniquement par notes écrites pour ne pas s’adresser la parole.
©Gloris/Ocana/Garcia/Koehler - Quadrants
Dans le régiment, il y a un soldat juif en la personne de Léon Cohen. On y apprend que même en France les Juifs pouvaient être victimes de racisme.
En 1940, l’antisémitisme est partout en Europe. Ce n’est pas l’antisémitisme de maintenant. Aujourd’hui, il y a une espèce de confusion entre juifs et Israéliens qui amène autre chose. A l’époque, c’est un antisémitisme soit raciste, venant d’extrême-droite, parce que « c’est une race sans terre », parce que « c’est une race qui vient corrompre la race blanche », soit traditionnel, chrétien, parce que « c’est le peuple qui a tué le Christ ». Cet antisémitisme ambiant est partout en France, notamment dans l’Eglise et l’armée où il est présent, notamment au niveau des officiers.
Les scènes de guerre sont d’une boucherie sans nom. Corps explosés, victimes entassées, on sent même les odeurs de chairs brulées. A côté de cela, les survivants ont le choix entre deux attitudes que tu montres bien : la panique, comme ce soldat voulant fuir devant l’arrivée des panzers, ou la banalisation de l’horreur. Y avait-il une alternative entre ces deux attitudes ?
Je ne pense pas. Dans l'album, nous sommes là où a lieu le « schwerpunkt », le centre de gravité allemand, là, où les nazis décident de percer la ligne Française. Là, c’est un combat à forces inégales. Avec l'élite des troupes mécanisées nazis d’un côté et de l’autre des conscrits avec quasiment que des fusils pour les stopper. En fait, sur cet album-là, et encore plus sur le second, ce qui m’intéressait c’était de mettre en avant la guerre de 40. L’image d’Epinal que l’on en a, c’est le film La Septième Compagnie et le saucisson à l’ail. La vérité, c'est que la campagne de 40 n'a pas été une partie de plaisir. Le bilan est là pour l’attester : en 45 jours, 552 900 soldats furent tués ou blessés dans les deux camps, dont 342 000 Français. Pour la France, 92 000 morts au champ d’honneur, pour l’Allemagne, 50 000, plus qu’à aucun moment de la première guerre mondiale. Les pertes quotidiennes allemandes y furent supérieures à celles de la campagne de Russie de 1941. Sur les 3000 chars allemands, 1100 furent détruits ou endommagés. Tout cela est très bien remis en perspective dans le bouquin de Dominique Lormier, « Comme des lions - Mai-Juin 1940, le sacrifice héroïque de l’armée française. » Calmann-Lévy 2006.

©Gloris/Ocana/Garcia/Koehler - Quadrants
Quand L’Etat français est arrivé au pouvoir, ils ont fait en sorte que la campagne de 40 soit vue comme le résultat du ramollissement moral de l’esprit Français. Pour ce gouvernement, la force morale de la France a été sapée par la gauche depuis 1936 et le Front Populaire. La propagande de Vichy a donc induit que la défaite de 40 était due à une dégénérescence de l'esprit guerrier français. C'est de la pure propagande. Elle est restée dans l’imaginaire français. Alors que non, la campagne de 40 est avant tout une défaite militaire. Si nous avions eu des chefs militaires un peu plus prévoyants, clairvoyants, ou tout simplement un tout petit peu plus professionnels, ça n’aurait pas été ce désastre total. Quand on voit le nombre de morts français, on comprend bien que des gens se sont battus, ont résisté. Notre héros Martin est pile poil positionné sur le « schwerpunkt », le point fort allemand, l’axe de progression. Les gars ne pouvaient rien faire, c’était impossible. Nous avions les tirailleurs sénégalais qui chargeaient à la baïonnette sur des chars blindés allemands.
C’était de la chair à canons.
C’était juste totalement inadapté. Le problème est que là où ont attaqué les Allemands, les Français en face n’avaient que ça. On avait bien des canons, des chars des avions modernes, mais ils avaient été envoyés se promener en Belgique. Les allemands ont été plus malins. Ils nous ont attaqués par la Lorraine, dans la zone de Sedan. En face, il n’y avait rien de consistant. Il y avait des conscrits avec des fusils et leur courage. Leurs seules solutions étaient de se sacrifier ou de courir, ou d’être prisonniers.
Dans cette série, je suis vraiment sur l’idée que la défaite de 40 n’est pas morale, mais militaire avant tout. Un civil ne devient pas un militaire en trois mois. Martin est un civil qui se fiche de l’armée et de la politique. Il se retrouve là et une fois qu’il y est, puisqu’il faut faire la guerre, il la fait comme la majorité des français l’on faite : Avec courage et esprit de sacrifice.
Quand on parle d’une guerre quelle qu’elle soit, on n’imagine pas que tous les acteurs impliqués ne savaient pas pour combien de mois, combien d’années, ils en avaient avant d’entrevoir la fin du conflit. Comment prendre en compte cette donnée dans un récit comme une génération Française ?
Dans « Une génération française », comme dans mon autre série « Malgré nous », j’ai travaillé sur la base de témoignages. Des anciens m’ont accueilli gentiment et j’ai pu discuter avec eux. C’est émouvant, ils racontent leur vie. Souvent, ceux qui ont fait 39-40 ont fait l’Algérie après. C’est une matière un peu complexe à utiliser mais toujours est-il que c’est très intéressant. Ce qui m’a vraiment frappé c’est que chacun a sa propre vision de la guerre. Parfois, des gens qui sont des héros, qui se sont battus, qui ont fait des choses extraordinaires, vous avez beau leur dire que historiquement il s’est passé tel événement et que ce qu’ils vous racontent ne peut pas avoir eu lieu à ce moment précis, eux sont convaincus de l’avoir fait et sont convaincus d’avoir raison. Je ne dis absolument pas que la personne ment, c’est juste qu’individuellement le témoin a sa vérité et a sa vision sur cette guerre-là. J’ai trouvé ça extrêmement intéressant et c’est pour cela qu’est née « Une génération française ». Chacun fait sa guerre, chacun a son propre point de vue, ce qui peut opposer les gens alors que sur le fond ils sont d’accord. Par exemple, les visions que chacun avaient de Pétain différaient, en fonction du moment où ils s’étaient ralliés avec la France libre. Certains le voyaient uniquement comme un traître, d’autres étaient plus modérés et l'idée que Pétain avait « préservé » la France d’une défaite pire en signant l’armistice n'était pas loin.
© Gloris/Ocana/Garcia/Koehler - Quadrants
La page de garde montre trois personnages : Martin, sa sœur Zoé, et le lieutenant Tanguy. Martin est le personnage principal de cet album alors que Zoé apparaît dans deux courtes scènes et Tanguy à deux planches de la fin.
Martin est le frère de Zoé. Tanguy va venir télescoper le destin de Martin. Le concept de la série est de suivre dans trois diptyques les destins de ces trois personnages. D’un point de vue purement scénaristique, c’était complexe et jouissif à faire. Dans la deuxième partie de l’histoire qui sera consacrée à Tanguy, on suivra Martin sous les traits d’un autre dessinateur, pas très longtemps, mais pendant une dizaine de pages.
On retrouve également ces trois personnages en 4ème de couverture attablés à la terrasse d’un café parisien. C’est une situation qui va pouvoir se rencontrer ?
On est dans l’onirisme. Ça me parait difficile. Il y aurait une possibilité mais on serait très loin dans la série.
C’est ta deuxième série concept après Champs d’honneur. Est-ce un phénomène de mode ?
Le problème est qu'actuellement les lecteurs ont du mal à attendre un album. A moins d’être un monstre de rapidité ou un très grand auteur comme Marini ou Rosinski, le public ne veut plus attendre un an. On se retrouve donc dans un paradoxe où, alors que pour essayer d’installer une série il faut trois ou quatre albums, les éditeurs ne laissent la possibilité de n’en faire financièrement que deux.
Dans cette série-là, on n’est pas vraiment dans un concept. On est dans une histoire de destins durant la seconde guerre mondiale. Mes personnages sont là. Ils vivent comme dans toute histoire de bande dessinée, sauf qu’en ayant plusieurs dessinateurs et en travaillant rapidement, nous avons réalisé six albums qui vont sortir en moins de deux ans.
As-tu écrit tous les scénarios ?
Quand on travaille sur une série de ce genre, tout est déjà balisé. Les trois premiers tomes sont entièrement terminés. Je viens de finir le découpage du quatrième, qui est déjà à moitié dessiné. Pour le cinquième, il ne manque plus que la couleur. Il ne reste que le sixième album à terminer. Je ne l’ai absolument pas commencé mais je sais où je vais.

© Gloris/Ocana/Garcia/Koehler - Quadrants
Comment s’est fait le choix des dessinateurs ?
Il y a eu plein de tests, et des refus pour différentes raisons. Je pense qu’il y a une espèce de hasard. Edouardo Ocana, je l’ai simplement contacté. Il m’a fait un essai et ça a été validé par tout le monde. Manuel Garcia, le dessinateur des albums sur Tanguy, m’a été présenté par Jaime Calderone en Belgique sur un festival. Nous avons sympathisé, et quand on a eu l’opportunité de travailler ensemble, je l’ai contacté. On a fait un test qui s’est avéré concluant. Anna Luisa dessine les albums consacrés à Zoé. Cela faisait très longtemps que j’avais remarqué son boulot. Elle fait normalement de la bande dessinée en couleurs directes. J’avais trouvé ça très chouette et je m’étais dit qu'elle pourrait peut-être reprendre un jour « Malgré nous » (fantasme). On a fait un test et ça a marché. Il faut une homogénéité mais il ne faut pas que ce soit un produit. Nous n’avons demandé à aucun des dessinateurs de faire comme l’autre. Chacun a travaillé isolément. Le seul à avoir une vue d’ensemble, c’était moi. Cela crée parfois des séquences qui se recoupent où il y a deux points de vue d’un album à l’autre. Graphiquement, ce n’est pas une science exacte. Les dessinateurs ont travaillé uniquement en fonction de mon découpage. Ils ont donné une vision singulière sur chaque séquence. C’est le choix que nous avons fait. Le dessin de l’histoire de Zoé est différent, moins réaliste que les deux autres, mais cela donne un résultat très intéressant.
Que ce soit sur cette série ou sur une autre, as-tu été embêté par des puristes, pinailleurs de détails sur les uniformes, les armes,… ?
Oui, évidemment. Mais, à la limite, je ne m’adresse pas à eux. Bien sûr, je suis satisfait s’ils sont contents. Mais si tout n’est pas parfait, qu’ils aient au moins l’intelligence de se dire que le sujet a été traité par un auteur. Ce dernier a sa vision subjective. Et c'est humain. Tout simplement humain. S'ils veulent de l'Histoire, je peux leur envoyer ma bibliographie de travail !
J’ai toujours écrit de la bande dessinée par rapport à l’enfant que j’étais. L’Histoire est devenue ma passion grâce à la BD. Ce n’était pourtant pas l’Histoire exacte. Si l’on prend l’exemple d’Astérix et Obélix, les vrais gaulois mangeaient du chien et vénéraient les sangliers. Ce n’est pas vraiment l’image que la BD en donne.
Fabrice Le Henanf va-t-il être chargé de toutes les couvertures pour une unité de la collection ?
Il va pour l’instant nous faire les trois premières.
S’il y avait une saison deux, que raconterait-elle ?
Plein de choses. D’autres personnages viendraient se greffer. On ne serait plus dans les mêmes années. Les six albums forment une mini-série première saison. Elle se termine en 41. Le titre veut tout dire : c’est une génération. Tous les albums vont se terminer par des événements historiquement clés.
La seconde guerre mondiale a rebattu les cartes. Nous sommes toujours sous le programme de la résistance. Actuellement, en voulant libéraliser l’économie, les politiciens vont contre ce programme. Ils changent le paradigme. Nous avons connu l’occupation. Nous nous sommes libérés par nous-même, au moins d’un peu de vue idéologique, même si d’un point de vue militaire ce n’est pas tout à fait vrai. Les américains ne nous ont pas amené leur constitution comme dans d’autres pays. On s’est reconstruit par nous-même et la reconstruction s’est faite par le programme de la résistance. S’il y a une autre saison d’ « Une génération française », il y aurait tout cela.
La Seconde Guerre Mondiale est un thème qui a été maintes fois traité en BD. Y a-t-il eu une série qui t’a plus particulièrement marqué ?
Il était une fois en France, de Nury et Vallée. Mais ce qui est drôle, c’est que pour moi ce n’est pas un album sur la Seconde Guerre Mondiale. C’est un polar sur le destin d’un escroc. Mais c’est actuellement la meilleure série sur la période.
Et s’il y avait un film ou une série télévisée à retenir sur le thème ?
Le meilleur film est L’armée des ombres de Melville. C’est ce qu’il y a de mieux sur la résistance et cette période-là. En télévision, la série Un village Français est très bien faite.
Merci Thierry. A très bientôt pour la suite de cet entretien.
Propos recueillis par Laurent Lafourcade
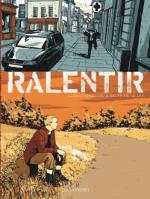
À l’aube d’un prometteur printemps, entre la pluie et l’éclaircie, Delphine Le Lay et Alexis Horellou nous sont revenus avec un album qui préface le changement et fruit des temps qui courent alors que tout a toujours tendance à toujours s’accélérer. Et si on ralentissait ? En se servant d’une route vers la belle Bretagne pour croiser les destins de deux héros bien différents. Un ouvrage simple et qui fait pourtant tellement écho à nos aspirations les plus folles même s’il ne tient qu’à nous de forcer le destin. Nous en avons profité pour nous entretenir avec Delphine et Alexis.

© Le Lay/Horellou chez Le Lombard
Bonjour Delphine, bonjour Alexis. Quand avez-vous eu, pour la dernière fois, envie de ralentir ?
Delphine & Alexis : Tout à l’heure… Nous nous faisons souvent la réflexion que nous devrions ralentir un peu, d’autant plus depuis ce livre, mais nous avons toujours beaucoup de projets et l’irrésistible envie de les voir aboutir.
Avant toute chose, qui êtes-vous, d’où nous venez-vous ?
Delphine & Alexis : Nous venons de Pau (Alexis) et de Douarnenez (Delphine). Nous nous sommes rencontrés à Bruxelles, où nous avons vécu quelques années. À notre retour en France, nous avons choisi un endroit au hasard, au milieu d’un triangle Pau/Douarnenez/Bruxelles. C’est ainsi que nous nous sommes installés en Mayenne, à Niafles.

Dessin pour le journal communal de Niafles © Alexis Horellou
Qu’est-ce qui fait qu’à vous deux, vous faites la paire ?
Delphine & Alexis : À peu près tout. Nous nous complétons bien souvent. Ce que l’un n’aime pas faire, l’autre le fait volontiers. C’est idéal. Pour ce qui est de la BD, nous avons des esthétiques et univers très différents, mais qui s’accordent sans difficulté sur nos projets. Nous partageons la même façon d’envisager la narration. Nous avons aussi des goûts communs, et nous discutons volontiers en cas d’avis contraires. Du coup, chacun apporte à l’autre, sans forcément lui faire changer d’avis.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce roman graphique ? Quel a été le déclic ?
Delphine & Alexis : Le déclic a été les retours que nous avons eus sur « Plogoff » et « 100 maisons » (nos précédents albums). Beaucoup de gens nous demandaient si de telles actions seraient encore possibles aujourd’hui. Nous avons donc commencé à réfléchir à ce qui était possible aujourd’hui. Quelles alternatives ? Quels moyens pour se sortir de la crise actuelle et du système qui nous emmènent tous dans le mur.

© Le Lay/Horellou chez Le Lombard
Ralentir, c’est une étape de transition qui mène vers ailleurs et autre chose, non ?
Delphine & Alexis : Oui, c’est se poser un peu, faire le point, pour pouvoir faire des choix. Ceci dit, dans notre idée, il s’agit plus de parler de cette transition, que de modifier son rythme. Nous ralentissons de fait en préférant le vélo à la voiture, en prenant le temps de bricoler ce dont on a besoin avec des matériaux de récupération plutôt que d’acheter des trucs tout faits, en prenant le temps d’aller chez Emmaüs, qui n’ouvre que deux fois par semaine… Ça offre un autre rapport au temps et aux choses. Mais au-delà du simple fait de ralentir, nous pensons que ça nous prépare au monde de demain.

© Le Lay/Horellou chez Le Lombard
Naturellement, on ne ralentit pas en un coup. Ça doit s’inscrire dans la durée, non ?
Delphine & Alexis : Certains choisissent de tout changer du jour au lendemain. Ils disent que le changement ne peut pas se faire en douceur. Qu’à un moment, il y a un déclic, et on change tout. Nous sommes plutôt (pour l’instant ?) dans un changement progressif, à notre rythme, selon nos moyens d’action.
Travailler en couple, à l’heure où des scénaristes et dessinateurs travaillent à distance, par Skype, parfois sans même se rencontrer, ça change la donne ? Vous laissez-vous penser à votre histoire à n’importe quel moment, ou mettez-vous le holà ?
Delphine & Alexis : Pour nous, c’est un confort. Travailler avec des gens à distance (ça nous arrive), c’est souvent contraignant. Nous remarquons que beaucoup ne répondent pas rapidement aux mails, coupent régulièrement leur téléphone… Il y a une forme de saturation pour certains à être joignable en permanence.

© Le Lay/Horellou
Le côté positif de se parler en face-à-face c’est aussi de dénouer tout de suite les incompréhensions. Par mail, ça peut vite monter en épingle et pourrir la relation de travail.
Concernant la deuxième partie de la question, nous pensons à nos projets et en discutons à tout moment, lorsque nous sommes à deux. Lorsque nous sommes en famille, nous privilégions les discussions avec les enfants.
David, Emma, deux personnages qui s’opposent entre triste routine et changement perpétuel. Vous vous êtes reconnus dans ces deux personnages ?
Delphine & Alexis : Non, pas vraiment. Emma est vraiment casse-pied. Si on la rencontrait, il est probable qu’elle nous fatiguerait assez vite. Quant à David, nous n’avons jamais rêvé, ni l’un ni l’autre, d’un parcours bien tracé, sans risque, d’être le meilleur, de courir après une reconnaissance sociale.

Recherches pour le personnage d’Emma © Le Lay/Horellou
La couverture donne le la, Ralentir fera œuvre de contraste ?
Delphine & Alexis : Nous souhaitions mettre en présence deux façons de vivre très différentes, sans pour autant que l’un ait tort et l’autre raison. Car il n’y a pas de vérité absolue. Il y a des points de vue et des choix.
Preuve en est : la couleur et le rouge, notamment. Parcimonieux au début, il enveloppe de plus en plus l’album. Pourquoi cette couleur ? Le traitement des couleurs est très inspiré, comment vous est-il venu ?
Alexis : La couleur est assez instinctive. Je travaille habituellement avec peu de couleurs. J’ai choisi des ambiances colorées par rapport aux ambiances de l’histoire. Je voulais quelque chose de sobre.

© Le Lay/Horellou chez Le Lombard
Graphiquement, comment avez-vous envisagé les choses ?
Alexis : J’ai fonctionné de façon différente dans l’album. Il y a des planches entières, et il y a aussi des dessins isolés, que j’ai monté ensuite sur ordinateur pour en faire des pages. J’ai cherché une justesse dans le trait, ce qui m’a amené à refaire plusieurs fois certaines cases.
Vous le dites en postface, Ralentir devait initialement s’appeler « À contre-courant », mais les deux ne sont-ils pas intimement liés, surtout par les temps qui courent ?
Delphine & Alexis : Oui, c’est lié. Ralentir peut être un début pour entamer des changements concrets. Mais ça ne peut pas suffire. On peut vivre autrement avec un rythme soutenu, et on peut vivre plus lentement en consommant à outrance des produits de mauvaise qualité.

© Le Lay/Horellou chez Le Lombard
Ralentir, au propre comme au figuré. Vous en exploitez les deux sens, si bien que vous en faites un road-movie partagé par deux personnages ayant tous deux une vision des choses très différentes. Il vous a fallu du temps pour décanter vos idées et trouver le fil conducteur ?
Delphine & Alexis : Oui, il nous a fallu du temps, d’autant plus que toutes les réflexions que nous avons menées et toute la documentation que nous avons abordée ont nourri non seulement l’histoire, mais aussi notre propre vie. Nous avons porté un regard critique sur nos propres comportements, et nous avons pris conscience que le mur que nous allons nous prendre tous ensemble se rapproche à toute vitesse. C’est un livre qui nous a bien brassés, mais qui nous a aussi permis de franchir des caps.
Une histoire qui a nourri de nombreux échanges pour dépasser la BD et nourrir votre propre vie. Quelles ont été les rencontres marquantes ? Qu’avez-vous appliqué dans votre BD ? Mais aussi dans votre vie de tous les jours ?
Delphine & Alexis : Nous avons rencontré des gens qui avaient fait le choix de tout changer du jour au lendemain : quatre murs, un toit, produire son électricité et donc réduire sa consommation au maximum, chauffer son eau, ne filtrer que ce qui est nécessaire à filtrer, créer un jardin permaculturel, retaper la maison sans argent, avec de la récupération… Leur autonomie nous a fait rêver, elle nous a rassurés. Comme s’ils étaient la preuve que, le jour où tout se sera effondré, nous aurons encore la possibilité de vivre. Malgré tout, ils mangeaient encore parfois du Nutella. Ça aussi c’était rassurant. Parce que tout bien faire d’un coup, c’est impossible.
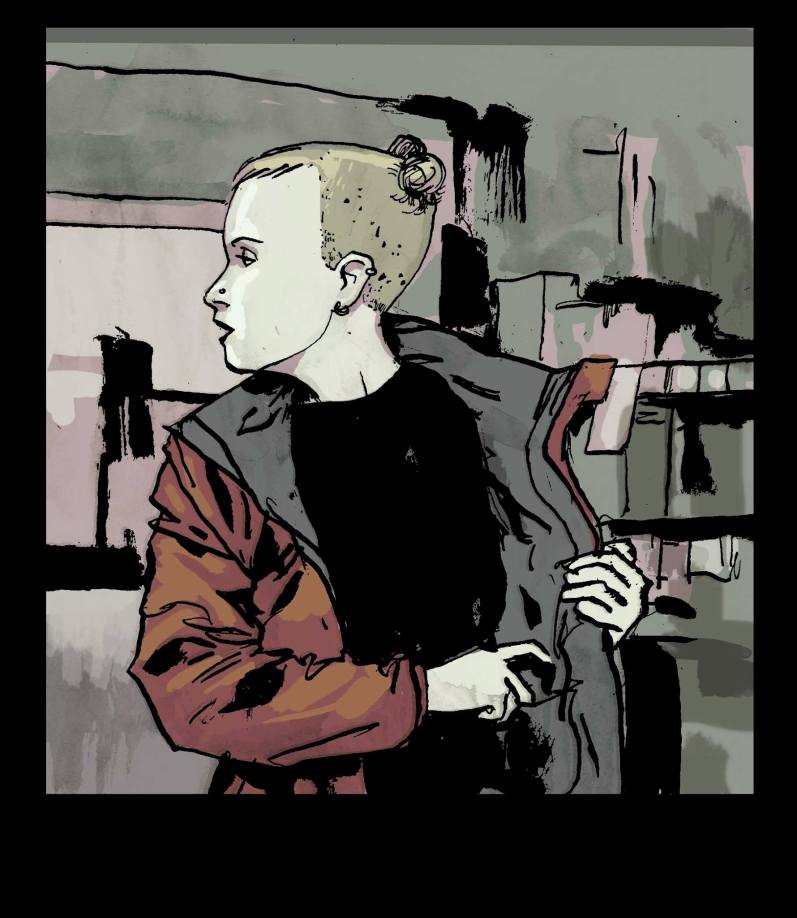
Recherche de couleurs © Le Lay/Horellou
Nous avons aussi rencontré des gens qui étaient plutôt dans un cheminement et c’est sans doute ces gens-là qui nous ont donné la motivation de passer à l’acte. Le discours « changer quelque chose vaut mieux que de ne rien changer ». Ce qui est pris est pris. Et on commence par quelque chose qui ne nous coûte pas trop, voire qui nous fait plaisir.
Nous avons créé, dans notre village, un petit lieu de convivialité. Nous dédions deux pièces de notre maison à un petit café culturel, que nous ouvrons, bénévolement, quatre fois par semaine. Le reste du temps, c’est notre cuisine. Nous avons fabriqué, avec des voisins, un manège à vélo pour les enfants de passage. Nous avons une petite boutique, dans laquelle nous proposons des livres et objets créés par des artistes professionnels qui ne sont pas présents dans les gros réseaux de distribution. Un pourcentage des ventes va à notre association, pour financer ses actions. Nous nous essayons aussi à la permaculture. Nous préférons le vélo à la voiture dès que possible, nous avons changé de système de chauffage, et appris à se couvrir quand il fait un peu frais…
Ces derniers temps, on a vu un engouement pour des œuvres comme En quête de sens ou Demain, ces documentaires ont nourri des vocations. Sont-ils entrés dans votre processus ?
Delphine & Alexis : Nous n’avons pas vu « En quête de sens », et nous avons découvert « Demain » il y a quelques semaines…
Mais n’est-on pas souvent frileux au changement ?
Delphine & Alexis : Nous avons voulu regarder « Demain», car certaines personnes, qui l’avaient vu au cinéma, en étaient sorties démoralisées, avec l’impression que le chantier est trop grand, qu’il faut changer trop de choses. D’autres continuent à se demander si c’est utopique.
Au final, c’est peut-être une façon de se protéger du changement, qui, effectivement, est souvent craint et fini par être subit. Ce qui est certain, c’est qu’un changement aura lieu, inévitablement, d’ici quelques décennies. Nous pensons qu’il vaut mieux s’y préparer tant qu’on en a la possibilité plutôt que de le subir violemment.

© Le Lay/Horellou
L’époque actuelle semble toujours en demander, exiger même, plus. Le moment est idéal pour ne pas se laisser faire et tenter autre chose ?
Delphine & Alexis : Le moment idéal n’est pas le même pour tous, et ce n’est pas à la société de nous donner le top. Le moment idéal est celui où une personne se sent mouvementée, sans pouvoir retrouver son équilibre. C’est le moment où on prend le temps de s’écouter, de se reconnecter à soi-même et de tenir compte de ce qu’on ressent.
Vous parlez de « retour à la terre », quel sens revêt pour vous cette expression ?
Delphine & Alexis : C’est le retour aux choses simples, aux éléments qui permettent d’être en vie et d’en profiter pleinement et simplement.

© Le Lay/Horellou
« On perd sa vie parfois à devoir la gagner» chantait Johnny (excusez-moi). Ici, il y a toute cette tension paradoxale dans le dialogue des deux personnages. Le nerf de la guerre, c’est toujours l’argent, qui mène à « gagner sa vie ». Quelles alternatives y voyez-vous ?
Delphine & Alexis : L’argent est incontournable parce qu’il est devenu indispensable de consommer des biens et des services. Consommer moins demande presque plus d’effort que de travailler pour consommer.
Si on veut se passer d’argent, il faut apprendre à consommer autrement. Se déplacer à vélo, manger ce qu’on peut produire, créer des réseaux d’entraide, avec des partages d’outils, de savoir-faire, de temps… Mais pour ça, il faut avoir du temps : pour cultiver, pour apprendre, pour se rencontrer. Il faut travailler moins, car plus on travaille, plus on a besoin d’argent : on n’a pas le temps de produire son alimentation, ni de cuisiner, donc on achète des choses faciles souvent plus chères; on met nos enfants à la garderie ou à l’accueil de loisirs, donc on travaille pour gagner de quoi les faire garder ; on travaille pour gagner de quoi partir en vacances pour décompresser parce qu’on a beaucoup travaillé; on travaille pour acheter une voiture, parce qu’on n’a pas le temps de circuler à vélo, parce qu’entre le travail et les enfants, il faut être aux quatre coins de la ville dans le même quart d’heure…
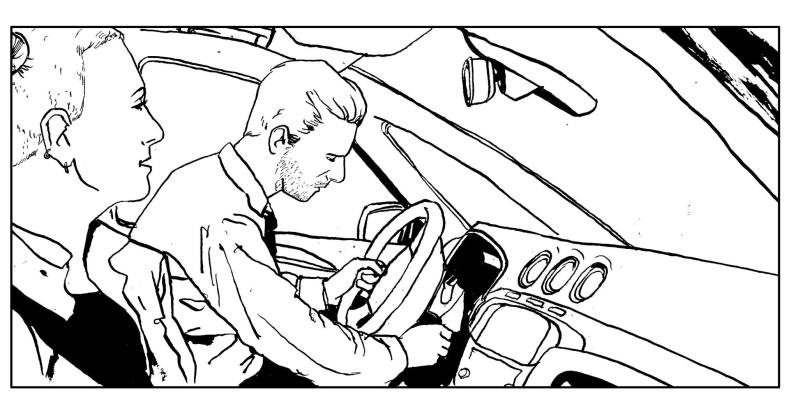
© Le Lay/Horellou
Je vous ai connu avec Plogoff, l’une des premières bandes dessinées que j’ai lues en vue de mon mémoire sur le BD-reportage et, plus largement, la BD du réel. À partir de quel moment, avez-vous pris conscience tous les deux que la bande dessinée pouvait jouer un rôle non-négligeable dans la compréhension du monde qui nous entoure ?
Delphine & Alexis : Nous avons pris conscience de cela au moment de la parution de « Plogoff », grâce notamment à un échange avec Nicole et Félix Le Garrec (qui signent la préface de « Plogoff »), qui estimaient que la BD était un bon moyen de transmission auprès des jeunes générations. Depuis, nous avons eu des témoignages de lecteurs qui aiment s’intéresser à des sujets historiques, sociologiques, ou politiques par la BD, moins rébarbative qu’un essai, plus ludique peut-être.
Quels sont les albums qui vous ont conforté en ce sens ? Pourquoi ? Des coups de cœur récent ?
Delphine & Alexis : Paradoxalement peut-être, nous lisons peu de BD dites « documentaires ». Nos coups de coeurs en BD : Blast (Larcenet), Panthère (Brecht Evens), Le roi des mouches (Mezzo), Zaï zaï zaï (Fab Caro), Lartigues & Prévert (Benjamin Adam), Patience (Daniel Clowes).
Vous citez aussi Bouli Lanners dans vos remerciements. Que vous a-t-il apporté ? Vous l’avez rencontré ?
Delphine & Alexis : Nous ne l’avons jamais rencontré, mais ses films nous touchent beaucoup. L’humanité, la sobriété, la mélancolie et parfois l’espoir qui s’en dégage. Nous aimons sa façon de rythmer ses histoires, le temps qu’il accorde aux paysages, aux personnages, aux silences.

© Le Lay/Horellou chez Le Lombard
En lisant vos remerciements, on constate que vous ne laissez pas grand-chose au hasard, vrai ? Vous vous documentez beaucoup ? Et notamment sur la manière dont les pompiers procèdent pour aller sur un accident. Vous nous expliquez ?
Delphine & Alexis : Ça nous paraît naturel. On ne sait pas comment ça se passe, et pourtant on choisit de le montrer… Et puis c’est une histoire encrée dans le réel, avec un trait assez réaliste… nous n’imaginons pas poser des images qui ne correspondraient pas à la réalité.
Ralentir, c’est un projet qui tient à cœur à Nathalie Van Campenhoudt, aujourd’hui en partance vers Casterman. Quel fut son rôle dans cette aventure ? Elle est venue vous chercher ? Éditorialement, comment cela s’est-il passé ?
Delphine & Alexis : Ce projet a été refusé partout. Seule Nathalie a été intéressée. Nous nous sommes rencontrés pour échanger sur la façon dont nous imaginions traiter cette histoire. Nous sommes tombés d’accord. Elle a senti le projet, a cru en ce propos et l’a défendu. La réalisation ensuite n’a pas été facile, nous sommes passés par d’importantes périodes de doutes et de remise en question. Nathalie (et toute l’équipe qui a travaillé sur cet album) s’est montrée très à l’écoute, bienveillante, motivante, et critique à la fois. Nous avons senti un réel accompagnement de la part d’une équipe soudée à nos côtés. C’est une chance d’avoir pu travailler de cette façon.

Recherche de couleurs © Le Lay/Horellou
Quelle est la suite, pour vous ? Vos projets ?
Delphine & Alexis : Pas de « BD du réel » pour le moment… un retour à fiction. Une histoire de gens, de couples, et d’engagement les uns envers les autres, quelque part entre « Faux-semblants », « Lune froide » et « Six feet under »… mais nous n’en sommes qu’au projet.
Propos receuillis par Alexis Seny

Une épopée dans une page de l’Histoire et des relations internationales très méconnue. C’est ce que nous propose le fantastique trio que forment Laurent-Frédéric Bollée, Alcante (qui ne s’arrête pas entre Dark Museum et Starfuckers) et Xavier Besse avec Laowai. Ou comment un soldat français va se retrouver en pleine guerre de l’opium entre trois empires qui s’affrontent. Cela valait bien une interview avec Alcante et Xavier Besse sur les terres pacifiques de la Foire du Livre de Bruxelles mais toujours sous l’oeil du dragon.
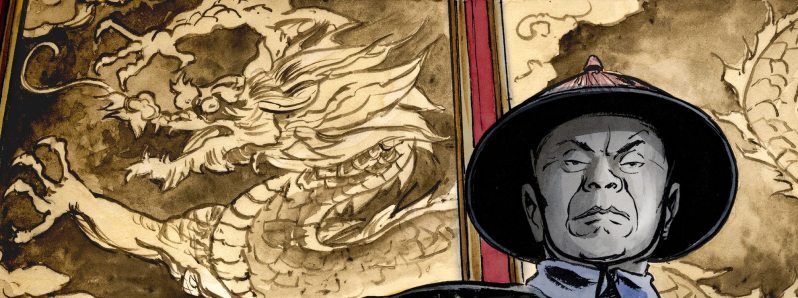
© Bollée/Alcante/Besse chez Glénat
Bonjour à tous les deux. Xavier, vous êtes un jeune auteur de BD, finalement. Amour de jeunesse, ça ne fait pas si longtemps que vous y êtes revenu?
Xavier : C’est vrai, il n’y a pas si longtemps, je travaillais au Musée des arts asiatiques Guimet, j’étais spécialiste de la porcelaine et de la céramique. Ce qui est assez troublant, c’est que certaines pièces venaient directement du Palais d’été de Pékin, l’un des hauts-lieux de la guerre de l’Opium. Esthétiquement, j’ai donc retrouvé ce monde tout en renouant avec le Neuvième art dont j’avais pris mes distances, à mon grand regret. En fait, on peut dire que je suis un jeune auteur, j’ai commencé la BD en 2010, à 39 ans. Il faut dire qu’à 25 ans, j’avais l’impression que l’aboutissement de ma vie serait de faire un livre sur la céramique et que je devrais me battra pendant très longtemps pour ce faire. Résultat, à 33 ans, je publiais ce livre. Plus tôt que prévu. Je n’avais plus de but et je trouvais que j’avais fait le tour. Et la bande dessinée m’est revenue en pleine poire alors que je n’avais plus fait ça depuis dix ans. C’est Jean-David Morvan qui m’a remis sur les rails. Il m’a coaché en quelque sorte, il trouvait mon travail nul au début, il me faisait recommencer. Et, au final, ça a payé.

Une des premières recherches d’ambiance © Xavier Besse
Lao Wai me permettait de pas mal combler mes envies graphiques : des paysages, la ville mais aussi ces pontons en bois dans tous les sens, en pouvant garder une certaine liberté par rapport au scénario de Didier qui était complet et détaillé mais où rien n’était fixe. Si ça marche, tant mieux.
Quelle est la genèse de cet album, alors?
Alcante : Je nourrissais cette envie de Chine, depuis quelques années, déjà. L’étincelle était venue lors d’un voyage en Chine en 2011, à Pékin, Hong Kong… Si j’étais naturellement attiré par cette culture, c’était la première fois que je m’y rendais, invité avec ma femme par une de ses amies. Une fois qu’on y met les pieds, on sent assez vite son Histoire, la force d’un empire millénaire qui redevient une force économique ultra-moderne et n’a plus vraiment besoin d’aides au développement.

© Bollée/Alcante/Besse chez Glénat
Mon intérêt pour l’histoire m’a amené dans pas mal de musées qui réservaient souvent une section à la guerre de l’opium. Une guerre que je ne connaissais pas tant elle est restée en travers de la gorge des Européens : les Anglais mais aussi les Français. Ceux-là qui bombarderont Pékin et iront jusqu’à dégrader ce que l’on peut appeler le Versailles chinois. Dans ce récit, il y avait de la tension, de la passion, des guerres totalement méconnues de par les raisons peu glorieuses qui les ont menées. Les Anglais se sont comportés comme des véritables narcotrafiquants.
Une fois de retour, j’en ai parlé à Laurent-Frédéric Bollée qui est incollable sur pas mal de sujet. Même lui n’avait jamais entendu parler de cette période de l’histoire pas si lointaine, dans les années 1860, et prenant pourtant place dans un décor phénoménal. Nous sommes allés vers Glénat, l’éditeur historique par excellence et ils ont commencé à chercher un dessinateur d’origine chinoise.

© Xavier Besse
Pas vraiment le type de Xavier !
Alcante : C’est vrai, Glénat avait dans l’idée qu’un dessinateur originaire de Chine manierait plus facilement les ambiances et les idéogrammes. Je n’étais pas très chaud parce que cela signifierait qu’il faudrait communiquer via un traducteur et un malentendu est si vite arrivé. Alors, j’ai imposé une condition, que le dessinateur parle un minimum d’anglais…
Xavier : … ce que je fais pas trop mal. (rires). On ne se connaissait pas. Bien sûr j’avais lu le XIII Mistery de Didier et le Deadline de Laurent-Frédéric, mais ça s’arrêtait là. Et c’est Jean-David Morvan, encore lui !, qui a suggéré mon nom. J’ai soumis quelques dessins à l’éditeur et à Didier et l’aventure a pu commencer : j’ai reçu une réponse de Didier dans l’heure, il était dithyrambique. C’était un moment un peu magique. Et dès que j’ai lu le scénario, j’ai eu plein d’images en tête.

© Bollée/Alcante/Besse chez Glénat
Comment avez-vous travaillé ensemble ?
Xavier : J’ai repris le découpage sur certains points, Didier et Laurent-Frédéric n’étaient pas contre du tout. Je pense que j’ai bien réussi le personnage du sergent Marais, sinon… Je l’avais déjà dessiné quelques fois quand j’ai trouvé le visage qu’il lui fallait. Dans une case, je lui fais faire une grimace, et c’est ce visage que je voulais…
Alcante : Du coup, j’ai envie qu’il apparaisse dans plus de scènes, ce sergent ! De mon côté, je ne m’estime pas être un très bon dialoguiste mais je lui ai mitonné un de ces dialogues. Xavier est très fort et il progresse encore.
Xavier : Les intérieurs, je ne sais pas trop les faire.
Alcante (qui n’en revient pas) : Arrête, tu les fais super bien. Le volet. La scène où le vieux se suicide.
Xavier : C’est le tapis qui donne cet effet.
Alcante : Puis, il y a le lustre…
Xavier : C’est un lustre hollandais, ils en avaient partout, là-bas, à l’époque.
Alcante : Au final, c’est beaucoup de travail, mais ça ne se sent pas. Xavier a un réalisme et un niveau de détails qui nous plonge directement dans l’histoire, dans l’époque qu’il fait revivre. C’est un voyage dans le temps et géographique. Après coup, on peut caler trente minutes sur une case.

© Bollée/Alcante/Besse chez Glénat
Alors, l’histoire commence doucement, nous ne sommes pas encore en Chine, ce n’est pas encore la guerre.
Alcante : Oui, en général, c’est comme ça. On se prépare doucement, il y a des tractations, c’est l’incertitude. Mais dans le tome 2, ça va vraiment bien éclater. L’idée est de plonger ce jeune Français, François Montagne. Un soldat d’infanterie parti de Toulon (une infanterie qui a réellement existé, on en a retrouvé un carnet de bord) qu’il fallait rendre vivant et de manière à ce que le lecteur s’y attache. C’est un soldat qui n’obéit pas aveuglément aux ordres, un gars bien quoi, sur un champ de bataille que vont se disputer trois empires. Comment va-t-il s’en sortir ? Comment va-t-il s’arranger avec sa conscience alors que tout le pousse ailleurs ? Son visage sur la couverture, c’est pile-poil ce qu’il fallait. On devine son courage, qu’il est costaud mais aussi indigné et scandalisé.
Xavier : Pour le coup, il y a eu beaucoup d’allers-retours sur l’expression à lui donner.
Alcante : On part d’un brouillon mais tant que le dessin n’est pas finalisé, on ne voit pas comment il va se concrétiser. Il faut rendre l’expression au bout du dessin.
Comment l’avez-vous créé ce personnage. Je me disais qu’il avait un petit quelque chose de Clint Eastwood ?
Alcante : On nous l’a dit aussi mais en écrivant ce scénario, j’ai pensé à un autre acteur. J’ai envoyé sa photo à Xavier au moment de commencer l’histoire. C’était…
Xavier : Alex Pettyfer, le gars dont je m’inspirais pour mon histoire… précédente. Comme quoi !
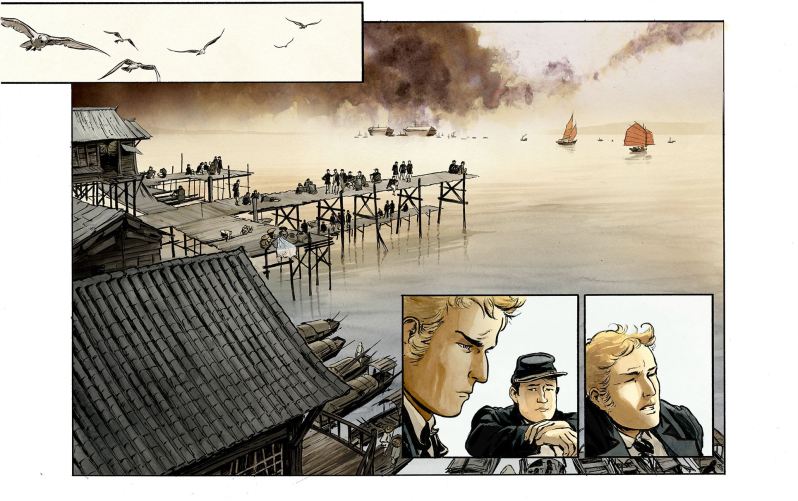
© Bollée/Alcante/Besse chez Glénat
Vous avez rencontré des difficultés ?
Xavier : La principale fut de restituer le Shanghai de 1860. Il n’existe aucune photo, aucune documentation le montrant. Pour plus tard, 1890, oui, mais ça n’a plus rien à voir. J’ai eu vraiment du mal à trouver de la documentation.
Puis, dans la partie française, il y a la séquence de montagne, en haut d’un piton rocheux. Les soldats sont à l’entrainement et doivent émerger d’un parcours dangereux, une sorte de via ferrata de tous les dangers. Imaginer ce parcours, ça m’a bien pris quinze jours.

© Bollée/Alcante/Besse chez Glénat
Alcante : On a souffert de la limite des 46 planches. Il manquait deux planches.
Xavier : On aurait dû les demander ! Du coup, j’ai dû mettre neuf cases en une seule planche. Ça fait beaucoup et c’est un travail de dingue.
Et au niveau des couleurs ?
Xavier : La technique est simple, je fais mes couleurs avec des encres aquarelle. Je les fais sur des pages imprimées en haute définition pour récupérer tous les détails de l’encrage original. De fait c’est de la quasi-couleur directe. Ensuite je scanne, et je nettoie. J’ajuste aussi quelques éclairages et certains contrastes et voilà…
Sur combien de tomes s’étendra cette histoire ?
Alcante : Trois et… demi. (rires). On a pensé à le faire sur quatre mais l’attente aurait été trop longue. Du coup, le troisième sera un gros album et conclura le premier cycle.

© Bollée/Alcante/Besse chez Glénat
Le deuxième tome ?
Alcante : La pression va augmenter. Le sergent veut faire la peau à François. On voulait le faire déserter, mais on s’est rendu compte que ça n’aurait pas été réaliste. Puis, concernant ces empires qui s’affrontent, on ne voulait pas faire de camps. Ils devaient être ni bons ni méchants. Car les motivations des Anglais ou des Français ne sont pas nobles, mais les Chinois ne sont pas pour autant des victimes. Encore moins sous la gouverne d’un empereur cinglé, obsédé sexuel et opiomane. La guerre va se décider par un empereur planqué.
La première version de l’histoire se rapprochait d’un Danse avec les loups ou d’un Avatar qui se serait passé en Chine. Mais François ne passera pas d’un camp à l’autre. Nous nous sommes imposé de rester réaliste, de voir comment notre héros va se comporter tout en sachant qu’il n’inverserait pas le cours de la guerre.
Propos recueillis par Alexis Seny
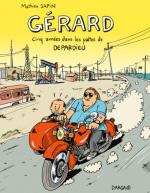
La dernière fois que nous avions rencontré Mathieu Sapin, il nous parlait de François Hollande et de son Château, essayant de dépasser le protocole pour mieux saisir le personnage. Chassez le naturel, il revient au galop, et, sans protocole aucun, le dessinateur-reporter s’est glissé dans l’ombre de Gérard Depardieu. Un monstre sacré aux facettes bien plus riches et profondes que l’image que nous renvoient les médias et la presse people. De Lisbonne au Caucase, Mathieu Sapin nous propose un voyage à pas de géant, souvent paradoxal, toujours fascinant.
Bonjour Mathieu. La première fois que vous avez rencontré Gérard Depardieu, il était torse-nu. Forcément, ça marque.
Oui, mais c’est son état naturel, presque. Il est très souvent torse-nu. Même là, en ce moment, il se pourrait bien qu’il soit aussi légèrement vêtu… Enfin, peut-être pas, comme il est au Viêt Nam, je ne sais pas quelle il peut bien être. Mais donc, ce n’était pas un effet, pas une image insolite dont je me servais. Gérard est comme ça.
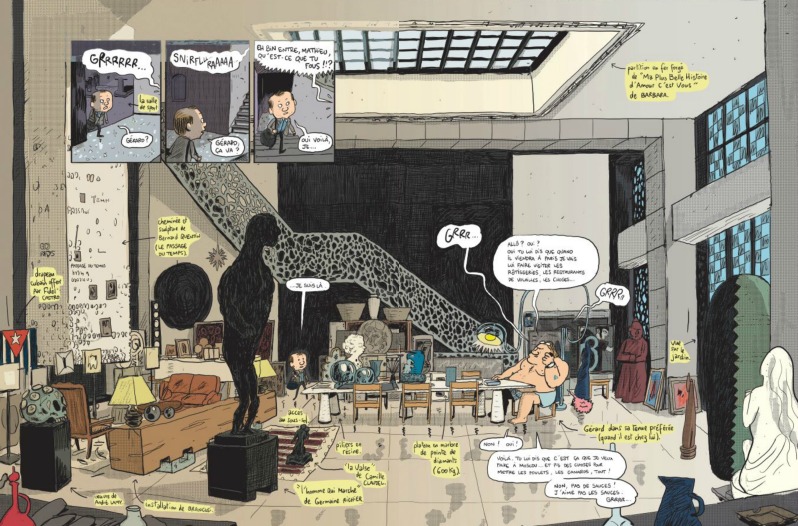
© Mathieu Sapin chez Dargaud
Aux prémices de ce projet, il y a un documentaire qu’Arte qui vous faisait intervenir aux-côtés de Gérard Depardieu lors d’un voyage dans le Caucase. Qu’est-ce qui a fait déclic pour que vous prolongiez l’aventure pendant cinq ans?
Je suis arrivé sur ce documentaire d’Arte, par hasard, sur une proposition un peu insolite. Plusieurs collègues, Loustal, Delisle ou encore Blain, avaient décliné. Moi, j’ai sauté sur l’occasion. Mais je ne pensais pas que ce serait aussi passionnant. Participer à ce documentaire fut assez mémorable, je dois dire. Mais quand je lui ai proposé de faire réellement un album sur lui, il n’a pas vraiment compris. « Moi, la Bande dessinée, je la vois sur les murs de la cuisine de mon restaurant. » Il ne pensait pas que la démarche pourrait être intéressante. Mais il me disait : « Je vais me barrer« . Il parlait de la Belgique, bientôt ce serait la Russie. Je ne le prenais pas au sérieux, ce n’étaient que des paroles et, néanmoins, je ne voulais pas le lâcher, pas le laisser partir comme ça.
Puis il y a eu l’emballement médiatique, l’hystérie et Gérard Depardieu qui y répondait toujours un cran au-dessus et je l’ai finalement suivi.
Gérard Depardieu, on le connaît forcément acteur, mais ce n’est pas non plus la première fois qu’il apparaît en BD. Tout récemment, Gess le faisait ainsi apparaître dans « La malédiction de Gustave Babel ».
C’est vrai qu’il est souvent dessiné. Ou, en tout cas, utilisé physiquement, pour sa présence. Sergio Salma en avait fait un album très rigolo chez Bamboo tout en puisant dans sa biographie et en en utilisant des détails. Le dessiner est assez facile, en fait, il est agréable à dessiner, tout en rondeur. On pourrait tout à fait l’intégrer dans un dessin animé comme on l’a fait pour les Jackson Five ou Arnold Schwarzeneger.
Ou Jackie Chan !
Ah oui, tiens, ça m’était sorti de l’esprit. C’est comique. Mais Gérard, en fait, il n’a pas d’équivalent, on le reconnait directement. Il correspond assez bien à une sorte de figure moderne. Même s’il est lui-même, il est dépassé par ce qu’il véhicule.
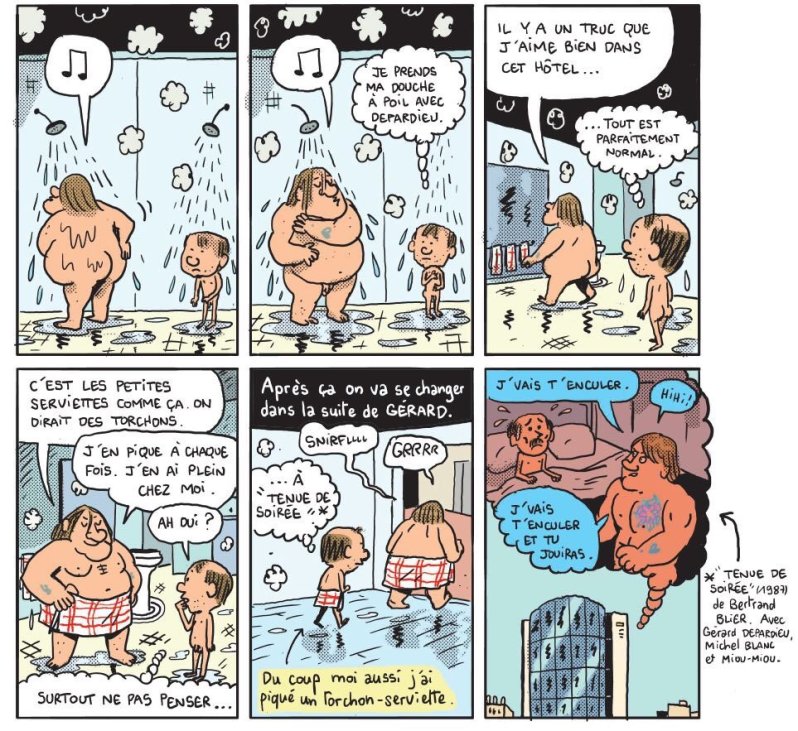
© Mathieu Sapin chez Dargaud
Récemment, j’ai d’ailleurs été sollicité pour un documentaire, « Depardieu, mythe moderne » également pour Arte, sur base de témoignages de diverses personnes et qui devrait moins s’attacher à l’acteur qu’à ce qu’il représente dans ses discours, ses rapports à l’argent, à l’état… France 3, a aussi réalisé une émission-rencontre d’une heure avec Gérard Depardieu à propos de la BD.
Ce qui marque le lecteur dans pas mal d’albums, c’est votre sens de l’observation, cette capacité à saisir une quantité invraisemblable de détails. Pourtant, pour le coup, vous étiez tombé sur plus fort que vous : Gérard Depardieu ne rate pas une miette.
Il voit tout. C’est presque un animal, il a quelque chose d’instinctif en lui. Dans l’album, je me compare même à un observateur de grands fauves. Et, s’il ne dit pas tout, rien ne lui échappe.

© Mathieu Sapin chez Dargaud
Il y a quelques jours je parlais avec Renaud Dillies, pour son album « Loup », du rapport qu’on a aux idoles, des êtres isolés à qui on ne parle jamais qu’en déférence par rapport à leur popularité. Comment avez-vous fait le chemin vers Depardieu ?
C’est totalement ça. Et sachant cela, j’étais obligé de ne pas me dissimuler, d’être le plus naturel possible. J’ai compris assez vitre qu’il me fallait me comporter normalement. En fait, c’est reposant pour lui qu’on lui parle comme à n’importe qui. D’autant plus que je n’avais jamais vu certains de ses grands films comme La Chèvre. Je ne venais pas comme un fan, en mode « je vous ai adoré dans tel film ».
Par contre, lors d’une soirée à Lisbonne, qui ne prend qu’une case dans l’album, l’équipe du documentaire n’en pouvait plus et ils m’avaient demandé de m’en occuper. Nous nous sommes retrouvé dans un restaurant de Lisbonne avec ma belle soeur qui elle est fan et n’a pas arrêté de lui parler de ses films. À un moment, Gérard a explosé : « Parle-moi de ta machine à café, quoi ! »

© Mathieu Sapin chez Dargaud
Contrairement aux idées reçues, Gérard parcourt ses albums sans (quasiment) une goutte d’alcool. Qu’est-ce qui lui a pris?
Il se connaît et il est bien conscient que s’il commence il va écluser tout, alors il ne commence pas. Il est donc sobre la plupart du temps et non bourré, comme on le croit la plupart du temps.
Aussi, à la sortie d’un avion, on le retrouve en… chaise roulante. Qu’avait-il?
Ce n’est pas récent. Les chutes en moto successives ont laissé ses jambes en mauvais état. Puis il y a son poids qui ne rend pas les longs déplacements aisés. Si bien que dans les kilomètres des aéroports internationaux, il préfère la chaise roulante.
D’ailleurs, un jour, Gérard Depardieu s’est retrouvé dans un aéroport avec Alain Delon qui s’est demandé pourquoi cet acteur qui a près de quinze ans de moins que lui se déplaçait ainsi. Depardieu lui a répondu qu’il n’avait aucun souci avec son image et que c’était bien plus pratique. Mais, en effet, on n’imagine pas un Alain Delon faire pareil.
Pour tout dire, j’ai même voulu ne pas dessiner cette scène. C’est Gérard qui m’a encouragé à le faire, il ne voyait aucun inconvénient à ce que les gens le voient dans ce que certains pourraient considérer comme un aveu de faiblesse. Il m’a dit « vas-y », il ne cherchait pas forcément à ce que cet album le valorise.
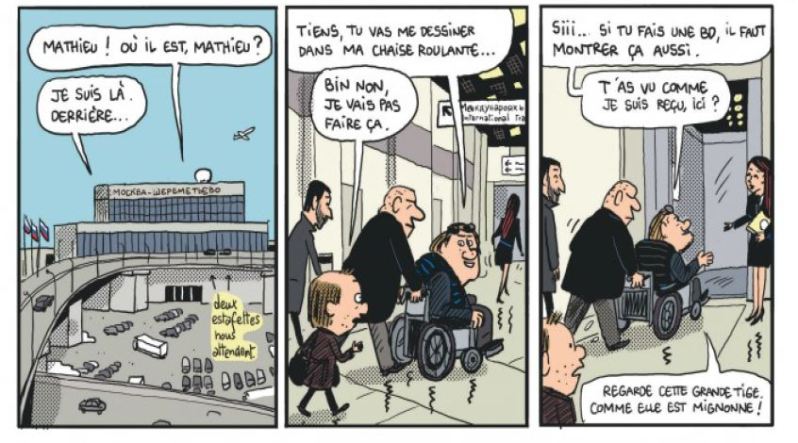
© Mathieu Sapin chez Dargaud
Il est forcément question des médias qui s’agitent dès que Depardieu prononce une phrase un peu provocante. Ça vous est aussi arrivé au moment où vous vous y attendiez le moins, en 2014, quand des journalistes BD de Casemate sont que venus vous suivre chez Gérard et l’interviewer. Le mot d’ordre : pas de questions politiques. Sauf que… Et les mots Gérard Depardieu auront sur François Hollande, « petit bolchévique de l’Élysée », seront vite repris partout, dans la presse people en premier. Sans contextualisation.
C’est clair, à notre époque, le moindre mot exagéré est très vite repris de sites en sites. Cette mésaventure m’a mis en difficulté : dans ces articles, Gérard Depardieu était bien évidemment cité, mais moi aussi. Et j’étais encore à l’Élysée en train de suivre François Hollande. Forcément, j’étais dans mes petits souliers.
De son côté, Gérard Depardieu n’est pas du genre à atténuer les choses, il préfère souffler sur les braises pour qu’elles reprennent de plus belle.

© Mathieu Sapin chez Dargaud
Outre le nombre incalculable de selfies auxquels Gérard se prête aux quatre coins du monde, il y a aussi quelques paparazzis qui se terrent dans vos planches. Ce qui vous amène à une réflexion : ne suis-je pas, moi aussi, un voleur d’images ?
Oui, je ne peux pas faire l’impasse sur ce raisonnement. Et je crois que je le suis. Ça ne me met pas à l’aise, quand j’y pense, d’autant plus que je me suis imposé, Gérard m’avait dans les pattes, il était tolérant de ma présence.
Avez-vous dû censurer certains passages ?
Je me suis autocensuré. Notamment lorsqu’il était question des petites copines de Gérard ou des histoires de cul avec certaines comédiennes. Il y a prescription mais ces comédiennes sont toujours en activité. C’était de l’ordre de l’intime et ça ne me semblait ni très élégant ni nécessaire à ce que je voulais raconter.

© Mathieu Sapin chez Dargaud
Néanmoins, vous prêtez l’épilogue de votre album à Gérard pour qu’il puisse désamorcer certaines choses « qu’il n’aurait pas dites ».
J’aime assez bien l’idée de montrer les coulisses. Ici, c’était aussi l’occasion de montrer, si besoin était, à quel point Gérard peut être contradictoire. Dire quelque chose, puis revenir dessus en disant qu’il n’a jamais dit ça. Mais, de manière générale, rares sont les gens qui peuvent être univoques. Et je trouve qu’il y a un avantage à montrer les deux facettes.
D’autant plus que Gérard Depardieu est paradoxal, capable de s’exprimer par clichés puis d’avoir un discours scient, de parler à l’emporte-pièce tout en étant hyper-bien informé, en témoigne la chaîne TV5 qui, où qu’il soit, est quasiment allumée 24h/24 dans sa chambre d’hôtel. C’est dingue.

© B-Tween
Il est difficile à suivre ! C’est pourquoi je notais tout. De temps en temps, je sortais aussi mon enregistreur. Gérard Depardieu se répète souvent. Puis, classique, il y a des phrases qu’il ne finit même pas.
Finalement, êtes-vous devenu ami avec ce monstre sacré ?
Ami, c’est fort comme terme. Mais disons qu’on a lié une relation très amicale, c’est sûr.
La suite, pour vous, ça se passera encore un peu plus au cinéma.
Exact, en juin, sortira Macadam Popcorn de Jean-Pierre Pozzi. J’y joue mon propre rôle, celui d’un dessinateur qui va faire le tour de France des cinémas et de leurs exploitants, dans ce qu’ils ont de plus varié. Une manière de s’approcher de ce drôle de métier de l’ombre et de l’interroger dans son rapport à la culture et à la société d’aujourd’hui.
Mais ce n’est pas qu’un documentaire, c’est aussi une transposition, une mise en abîme. D’ailleurs, je suis en train de terminer un carnet qui accompagnera le film et lui donnera une histoire supplémentaire. Comment s’arrange-t-on avec la fiction ? Et avec la réalité ? Pour arriver à un docu-fiction. C’est un sous-genre tellement en vogue qu’il y a des choses à en dire, de même que sur le médium. Je veux prendre du recul sur la manière dont on donne l’info. Finalement, je ne sors pas vraiment de ce que je viens de faire avec l’album sur Gérard Depardieu.
Vous nourrissez d’autres rêves de cinéma, aussi, non ?
Oui, et ça va se concrétiser à l’automne. Un film, Le Poulain, avec Alexandra Lamy dans le rôle d’une femme politique retors et avec Finnegan Oldfiel. Une incursion avec un débutant dans une équipe de campagne électorale.
Pas de Gérard à l’horizon ?
Ah, non, pas sur ce coup-ci, je ne pense pas, ce n’est pas facile de l’intégrer à un film, il prend vite de la place. Mais j’ai d’autres projets et, forcément, l’envie de le faire tourner.
À suivre, donc. Merci beaucoup Mathieu.
Propos recueuillis par alexis Seny
Titre : Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu
Récit complet
Scénario et dessin : Mathieu Sapin
Couleurs : Clémence Sapin
Genre : Reportage, Biographique
Éditeur : Dargaud
Nbre de pages : 160
Prix : 19,99€

Après avoir fréquenté le bayou avec Alvin et Régis Hautière, Renaud Dillies a suivi les notes et la musique qui l’ont amené à errer et aider une autre âme en peine: Loup. Ou comment un amnésique anonyme va trouver sa voie en posant ses mains et sa voix sur une guitare. Mais le succès fait-il oublié qui l’on est et qui l’on est pas ? Interview avec Renaud Dillies qui met de bien belle façon des dessins sur la musique, avec la complicité de Christophe Bouchard aux couleurs.

© Cécile Gabriel
Bonjour Renaud, vous nous revenez avec Loup, que vous avez, écrit, dessiné, colorisé et, j’allais dire… « composé » tellement la musique y a encore une place primordiale. Seriez-vous aussi musicien ?
Oui, et guitariste, notamment. C’est vrai que la musique tient une place particulière dans mes albums. J’ai du un peu délaissé ma guitare pour m’investir dans le dessin. Elles sont chronophages, ces choses-là.

© Dillies/Bouchard chez Dargaud
Cela dit, votre album donne l’impression d’avoir été mis en musique. Vous en écoutez durant votre phase de création ?
Énormément. Je me fais des playlists et, pour chaque album, je pense pouvoir dire ce que j’écoutais comme musique. Pour Loup, c’était une bande-son plutôt jazzy, plus ou moins rock. Il y avait énormément de Charlie Haden, ce grand contrebassiste de jazz, mais aussi du Pink Floyd. Comme quoi… Je cultive et écoute de toutes les musiques. Rien que dans les guitaristes, il y en a plein qui m’inspirent. Comme Pat Metheny, encore plus en acoustique, Django Reinhardt ou Eric Clapton. Je n’en cite que trois, c’est déjà pas mal, mais il y en a tellement pour qui l’amour que je porte à leur égard n’a d’égal que mon admiration. Ils me captivent, ils m’envoient tellement d’images.
Quand j’écoute de la musique, j’ai très vite des images qui me viennent en tête. Je pense même pouvoir dire qu’en général, le personnage s’impose à moi.
Votre héros, c’est ce loup musicien, amnésique, dans une posture dont on n’a pas l’habitude pour ce genre d’animal, fragile et perdu. Pourquoi ?
Prendre ce loup, c’était prendre un contrepoint marquant. Un loup solitaire, sans mémoire, qui ne sait plus où il est ni qui il est. C’était aller au-delà des apparences.

© Dillies/Bouchard chez Dargaud
Quels sont les loups de fiction qui vous ont marqué ?
Il y a celui de Dancette et Calvo dans la Bête est morte qui est sorti en 1944 et qui relatait de manière animalière et satirique la deuxième guerre mondiale. Ce n’est pas vraiment une BD, plus un livre d’illustration.

© Dancette/Calvo chez Gallimard
Puis, comment ne pas penser au loup de Tex Avery. Celui-là, je l’ai apprivoisé durant mon enfance et il m’a marqué à vie !
Encore un album de BD avec animaux. Vous êtes devenu un spécialiste dans ce domaine !
Disons que j’aime faire intervenir des animaux, c’est très ludique et ça me permet de faire passer pas mal de choses tout en bénéficiant du recul tel qu’on peut en avoir face à un conte ou une fable. Si dans Loup, j’avais choisi de faire évoluer des hommes dans cette histoire, je pense que celle-ci aurait été plus lourdingue et aurait procuré moins de détachement au lecteur. C’est pourtant paradoxal car, finalement, je ne parle que de l’Homme et mon propos essaie d’être sincère et profond, tout en ayant du recul sur les sentiments humains. C’est une sorte mise en abîme sans ôter les sensations ou les ressentis. Les animaux me permettent d’aller plus loin. Puis, leur grand avantage, c’est que physiquement, il symbolise très vite quelque chose. Un renard futé, par exemple.

Recherches pour le personnage de Miss Ti ©Renaud Dillies
Quelle est la genèse de cette histoire, alors ? Un encrage bien humain ?
Oui, un fait divers, il y a quelques années. Je ne sais plus dans quoi je l’avais lu mais il m’avait marqué. L’histoire d’une personne qu’on avait retrouvée totalement amnésique : Andreas Grassl. Sauf qu’en la mettant devant un piano, cette personne sans mémoire apparente avait commencé à jouer de manière virtuose. Tout en ignorant qu’elle avait appris à en jouer.
Cette histoire véridique, je l’ai laissée trotter dans ma tête pendant longtemps. Il fallait que je la sente. Une fois que ce fut le cas, tout le teste est venu rapidement, de manière évidente. Je mets beaucoup de notes de côté et si, une fois le stade de décantation arrivé, il en reste quelque chose, ça peut faire une histoire. C’est très bête mais juste une impression peut nourrir une réflexion menant à une histoire.
Un personnage amnésique, ça alimente l’imagination, non ?
C’est forcément intéressant à exploiter. Comment peut-on bien voir le monde sans souvenir ? Qu’est-ce que ça fait ? Si chaque jour était le premier jour ? Puis, cela questionne l’art aussi. Comment assisteriez-vous à un vernissage de peinture absurde sans aucun bagage concernant l’histoire de l’art ? Comment réfléchiriez-vous ?

© Dillies/Bouchard chez Dargaud
Puis, vous mettez en valeur l’importance du masque.
Oui, être amnésique a à voir avec l’anonymat. Et ce masque, quand Loup va devenir célèbre et remplir des salles de concerts, ses fans vont lui faire ce qu’ils pensent être une bonne surprise : accueillir Loup en portant tous un… loup. Ce qui va faire office de choc identitaire à notre héros qui va recevoir en pleine figure cette image de ce qu’il est lui, de ce qui l’isole.
Notre rapport à nos idoles est fascinant. Eux qui sont si connus, on pense qu’ils n’ont aucun secret pour nous, alors qu’en réalité ils sont isolés. On les voit de manière tronquée. C’est valable pour les musiciens mais aussi pour les acteurs et les artistes en tous genres. Ils sont si connus qu’on ne peut plus discuter avec eux normalement, alors qu’au final on ne les connaît pas du tout. Ça part de beaucoup d’amour, mais certains n’ont pas tenu la barre, c’est ainsi qu’on en arrive à des destins très rock’n’roll.

© Renaud Dillies
Il y a rupture, en quelque sorte. Et ça tombe bien, entre des cases épurées et d’autres surchargées (de notes de musique, notamment), Loup fait oeuvre de rupture.
En effet, et si le procédé est très simple, je ne pense pas que ce soit si classique que ça. J’adore m’amuser avec les espaces et entre eux, entre la retenue et la surcharge. Mais toujours en gardant en vue que c’est la sensation, la mienne et celle du lecteur, qui prime plus que le dessin. Et par-dessus tout, je veux garder la pleine capacité de ma liberté d’expression. J’essaie de me détacher, de casser le dessin. Plus par souci d’expression que par velléité artistique.

© Dillies/Bouchard chez Dargaud
Sans oublier, que le silence est aussi important. Et si j’écoute pas mal de musique en travaillant, elle agit comme un réel moteur et me fait parvenir des images, j’ai de temps à autre besoin de la couper pour me concentrer sur ce que je fais. Mais c’est vrai qu’en faisant de la BD en musique, ça donne des envies d’aller plus loin dans la démarche.
Comme certains artistes qui, comme Romain Renard ou The Hyènes avec Au vent mauvais de Thierry Murat, montent sur scène et transpose l’art graphique en art musical ?
C’est un peu ce que j’ai fait en clôture de la Foire du Livre en compagnie de Michel Castillano. Un concert autour de Loup et son univers graphique. On renouvellera certainement ça, en essayant de jumeler les deux, de créer un objet double, sans reprise mais avec une bande originale propre pour un concept total, hors-format.
Quels sont vos projets ?
J’ai écrit la suite de Saveur Coco, le découpage est fini, il me faut trouver le temps de le dessiner. Sinon, j’ai un scénario sous le coude mais je ne le dessinerai pas car il ne s’agira pas de dessin animalier ! Puis, on va remettre le couvert avec Régis Hautière. On s’est tellement amusés avec Abélard et Alvin, puis les retours nous ont tellement touchés. Mais on ne jouera pas les prolongations de cette histoire : on va faire tout autre chose.
Merci beaucoup Renaud et pourvu que ce beau mariage entre les mots, la musique et le dessin soit long.
Propos recueillis par Alexis Seny

C’est vrai, c’est fou, il y a quelques années, on n’aurait jamais pensé que, de ses savoyardes et enneigées hauteurs, le redoutable Félix Meynet avait des envies d’aride et de désert, de ces virilités testostéronés qui font les westerns qui soulèvent la poussière et soufflent l’aventure. Sans pour autant oublier une touche féminine sexy mais toujours tempétueuse. Cette aventure-là, sur les bons mots de Yann (qui, décidément, est de tous les bons coups), c’est Sauvage. Le deuxième tome vient de sortir chez Casterman et, même si la saison est aux skis, nous ne pouvions pas ne pas glisser quelques questions à l’attention du papa de Fanfoué. Interview (illustrée par les magnifiques bonus dont Félix n’est pas avare sur sa page Facebook).

© Félix Meynet
Bonjour Félix, on vous connaissait perché sur vos montagnes enneigées, ça doit vous changer de goûter au désert, non ? Aviez-vous envie de changer d’horizons ?
Exactement. Il y a toujours une envie de western chez un dessinateur de BD. C’est le mythe absolu qui autorise toutes les libertés. Et c’est un moyen de satisfaire l’enfant qui rêvait à la lecture de Blueberry tout en essayant d’en recopier laborieusement les cases. Ceci dit, lorsque je lisais « l’Homme au poing d’acier », j’avais l’impression tenace que mes montagnes étaient peuplées de guerriers Sioux ! C’était très jouissif à douze ans de vivre dans un décor de BD. Il y avait aussi Buddy Longway de Derib qui renforçait cette sensation. Derib m’a avoué qu’il n’avait jamais mis les pieds dans le Wyoming mais qu’il s’était inspiré des paysages de ses alpages, à deux pas des miens, derrière la frontière suisse. Voilà pourquoi je me sentais chez moi dans le western !
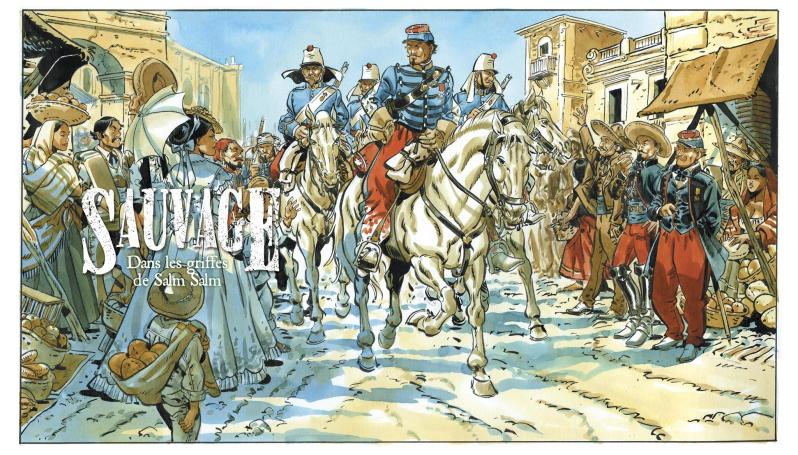
©Yann/Meynet chez Casterman
Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure mexicaine ?
J’avais envie d’épopée en costumes. Aussi, j’ai proposé à Yann de réaliser une aventure épique sous le premier empire, en Espagne. Le décor, la guérilla, les hommes en uniformes fatigués, la violence, etc. Yann, fin renard, m’a proposé de changer de Napoléon en faisant un bond de 50 ans dans le XIXème siècle. Napoléon III avait envoyé un corps expéditionnaire au Mexique pour tenter de créer un empire catholique qui aurait contrebalancé la puissance montante des Etats-Unis alors en pleine guerre civile.
Pour vous, c’est aussi bien plus qu’un changement de paysage, c’est un changement d’époque et de genre. Vous avez réfléchi avant de vous lancer ?
Oui car il a fallu aussi changer de technique de dessin. La couleur directe impose une discipline stricte et des nerfs solides. Mais cette expédition sous les cieux fréquentés par d’illustres dessinateurs qui maîtrisent cette technique a été une vraie aventure épique ! Avec plein pièges remplis de serpents à sonnettes sournois et de vrais découragements tout au long de la réalisation de ces albums. Une véritable expédition aux limites de ce que je pouvais faire !

©Yann/Meynet chez Casterman
En remerciements de ce deuxième tome, vous parlez « d’une mission difficile », quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Cela a-t-il ralenti votre progression ?
J’ai eu un souci à l’épaule qui m’a empêché de dessiner pendant 18 mois avec toutes les remises en question que ça implique. Le changement de technique ainsi que la station debout lors de l’élaboration des planches m’ont permis de retrouver un geste moins douloureux. Avec parfois des rechutes pénibles. Et puis, il y avait le challenge. Je m’étais mis en tête de proposer quelque chose de différent, plus exigeant. Tout cela additionné a retardé la sortie du T.2. Toutefois, je suis très heureux que les lecteurs aient patienté et soient au rendez-vous après 3 ans d’attente.
Comment se passe une collaboration avec Yann ? Est-il directif ou avez-vous votre mot à dire ?
Yann est un saint. Patient et dévoué jusqu’au sacrifice ! Il m’a soutenu à bout de bras durant ces longs mois d’hésitations et de remise en question. Son propos est toujours au service du dessinateur et il a à cœur de lui donner ce qu’il attend, voire même ce qu’il espère secrètement. Ce qui demande, avouez-le, une bonne dose de générosité et de pertinence !
Sur votre page Facebook, les « followers » auront remarqué votre documentation. Des photos mais aussi des objets. Vous avez besoin de toucher ces objets historiques, de les ressentir, pour les dessiner ? Ne laissez-vous rien au hasard dans la reconstitution ?
Le problème des objets du passé, c’est qu’ils sont difficiles à appréhender graphiquement si on n’a pas la documentation suffisante. De plus, ils engendrent des gestes adaptés qui ne font plus partie de notre quotidien. Il faut réinventer des postures, des attitudes de cette époque. Merci les tableaux et les photos d’antan ! Pour ce qui est des armes, hors de question de recopier dans Blueberry ! J’ai effectivement des pistolets (notamment un Lefaucheux d’ordonnance de l’armée française sous le Second Empire), des sabres, des éléments d’uniforme afin de pouvoir les observer sous tous les angles pour en comprendre les volumes et ainsi les dessiner plus aisément.
J’essaie d’être le plus juste possible mais il est vrai que le Second Empire ne bénéficie pas de l’engouement du Premier et il y a encore pas mal de choses sujettes à interprétation, même après dix visites au musée de l’armée. Après, si je m’aperçois d’une erreur en cours de route, je corrige, bien entendu. Et si un lecteur me fait une remarque sur un képi, un galon ou un calibre en dotation, je fais mon mea culpa et j’essaie de le convaincre d’avoir fait de mon mieux pour éviter les erreurs. À titre d’exemple, pour la première page, il s’agissait de montrer Notre Dame au temps de Napoléon III. En juillet 1863, plus précisément. Je ne parvenais pas à savoir si la flèche de la cathédrale avait été érigée par Viollet-Leduc à cette date. Je l’ai donc dessinée en me disant que je l’ôterai avec photoshop au cas où elle aurait été achevée plus tardivement. Avant de livrer les planches, j’ai finalement eu la confirmation qu’elle était bien présente à cette date. Ouf !
D’autant que c’est une fresque que vous nous offrez là, avec beaucoup de détails, non ?
Le diable est peut-être dans les détails en tout cas, je préfère crédibiliser mon récit avec tous ces éléments même si c’est un enfer. Puisque cela me permet de croire au récit que je dessine, j’ose penser que le lecteur y croira lui aussi.
En matière de western, quelles sont vos références, vos œuvres (cinéma, bd…) cultes ?
Le western a été la matrice de l’imaginaire des gamins de ma génération. La science-fiction et le fantastique sont arrivés plus tard, au milieu des années 70. Quand j’étais enfant, il y avait partout du western : à la télé, dans les pockets bon marché, dans les beaux livres illustrés. Même les petits soldats en plastique étaient des cowboys ou des indiens. Sans parler de la panoplie avec colt à amorces et étoile de shériff qui faisait rêver tous les mômes. Quand j’ai découvert « Il était une fois dans l’Ouest » au cours d’une projection dans mon collège de montagne, ce fut pour moi la révélation d’une dimension visuelle, musicale mais aussi mythologique du genre. On passait à autre chose de plus grand, de l’ampleur d’un opéra qui délivrerait des émotions incandescentes. Et puis Blueberry fournissait sur papier la continuité de cet opéra avec tout le baroque, la flamboyance et la sensualité nés du crayon de Giraud et de l’imagination de Charlier.
Ici, j’ai retrouvé une atmosphère très « Le bon, la brute et le truand », une inspiration ?
J’ai découvert plus tard les autres Leone qui m’intriguaient fortement. Je sentais bien qu’il y avait là une source d’inspiration et de grandes sensations à recevoir. Pour l’album, j’ai revu les classiques Major Dundee ou encore Vera Cruz.
Sauvage, c’est le nom du personnage, mais cela caractérise assez bien la violence de cet album et une cruauté qu’on ne vous connaissait peut-être pas. Vous vouliez expérimenter cette veine ?
C’est vrai que j’ai un dessin que l’on qualifie de « gentil » voire sympathique. J’aime les personnages enjoués et débonnaires comme Fanfoué (François en savoyard) que j’anime chaque semaine dans les journaux de ma région. Même les Éternels qui parfois avaient un propos dur, gardaient ce côté plaisant de par le dessin et les couleurs. Là, j’avais envie d’aller vers plus de réalisme. Ça passe donc par plus d’âpreté sans toutefois chercher à devenir antipathique !

©Yann/Meynet chez Casterman
« Il faut que les figurants jouent bien… » lisais-je sur Facebook, cela veut-il dire que vous mettez autant d’énergie et d’attention sur les personnages secondaires que sur les principaux ?
J’aime bien me dire qu’à la relecture, le lecteur puisse s’arrêter sur certaines scènes comme lorsque je pouvais moi-même le faire quand je m’attardais sur des vignettes d’Uderzo ou de Giraud. Si la vie frémit dans les recoins de l’image, c’est une bonne vibration pour le lecteur et pour l’histoire aussi.
Et parmi ces personnages, c’est un univers très masculin auquel vous donnez vie et traits. Marre des femmes ? (rire)
Je suis marié et père de trois filles. Donc un univers entièrement féminin au quotidien dans lequel j’ai l’impression d’apprendre en permanence. J’aime bien les trognes mal rasées, contrairement à mes filles qui râlent quand j’essaie de ressembler moi-même à un ours. Alors j’ai choisi de dessiner ces personnages virils pour pouvoir faire tous ces petits traits qui donnent du volume à un visage. C’est très agréable !
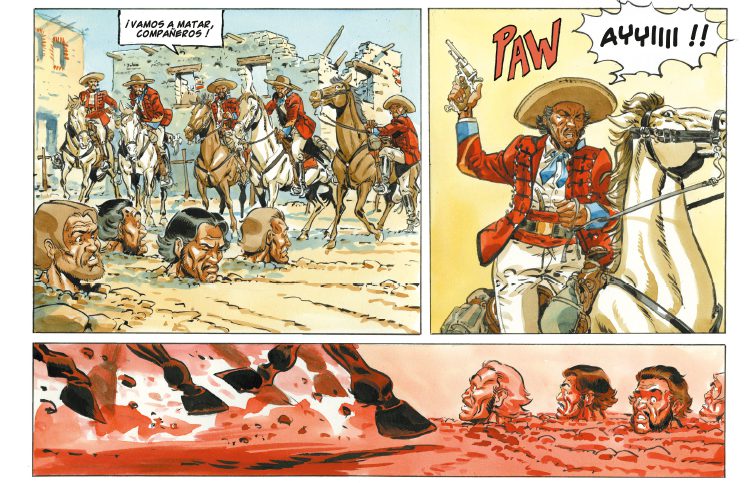
© Yann/Meynet
Dans Sauvage, les héroïnes se comptent sur les doigts de la main. Mais elles rivalisent de caractère et de charme. Comme la très sexy Agnès. Vous ne pouvez donc pas vous empêcher de faire tomber le lecteur amoureux le lecteur dès le premier coup, hein ?
Ce personnage, comme de nombreux personnages de Yann, a vraiment existé. Une aventurière yankee qui a épousé un prince européen, mi-espionne, mi-courtisane. Un personnage fort qui s’habillait en homme sans que ça ne choque grand monde à la frontière (cf Calamity Jane et consœurs) mais qui portait la crinoline comme pas deux à la cour de Maximilien. Après, le côté sexy lorgne plus du côté de Chihuahua Pearl que d’Uma des Eternels. Si le lecteur apprécie, je suis comblé.
D’où vous vient cette passion pour les femmes ? Vous y excellez, mais cela ne vous a-t-il jamais enfermé dans cet univers ?
On en a jamais fini avec son enfance et les filles étaient déjà un grand mystère pour le fils unique que j’étais au temps où les écoles n’étaient pas mixtes. Et en famille, comme je vous l’ai dit, je suis toujours certain d’être surpris au quotidien et j’en profite pour combler mes lacunes sur la gent féminine. En dessiner toute la journée puis les soumettre au verdict familial implacable m’aide à progresser. Sur tous les plans !

Un dessin du portfolio From Paris with love ©Meynet chez Bruno Graff
Puis, il y a les couleurs, directes, que vous signez seul. C’est nouveau ça non sur un 46 planches ? Ça vous a plu ?
Enormément ! Même si c’est un véritable stress de mettre en couleurs la planche sur laquelle on a déjà sué avec l’appréhension d’avoir à tout recommencer en cas d’erreur… car impossible de corriger sans faire des pâtés désastreux ! C’est un saut dans le vide et un challenge à chaque page. Ça forge le caractère ! Mais c’est très déprimant et épuisant quand ça foire. Et c’est arrivé, hélas ! Heureusement, quand l’album est terminé, ces sensations disparaissent et on a tendance à oublier ces angoisses. Jusqu’à ce qu’on recommence le suivant !
Le troisième tome sortira donc cette année ? Que nous réserve-t-il ?
Ce sera la conclusion de cette histoire de bague de l’Aiglon, le fils de Napoléon1er, mort jeune à la cour de Vienne. Et aussi la vengeance de Sauvage. Un petit air de Monte Christo, exactement ce que j’avais demandé à Yann. Nous sommes en train de discuter de la suite à envisager à ce triptyque.
À côté de cette trilogie, on vous voit signer beaucoup d’hommages et couvertures de réédition d’albums rares ou oubliés ? Comment expliquez-vous que votre trait soit aussi prisé ?
Aucune idée. On peut maîtriser toutes les techniques du monde, il y a dans le dessin une part qui échappe totalement au dessinateur mais que le lecteur reçoit et qui le séduit ou non. Le désir du lecteur dépend donc de quelque chose qu’on ne maîtrise absolument pas mais qui est propre à la sensibilité de chaque auteur. C’est très frustrant car on ne peut en aucun cas susciter ce désir volontairement, même en multipliant les effets et les prouesses graphiques. Impossible de séduire avec ces artifices. C’est beaucoup plus profond. Donc, je me contente d’essayer de maîtriser le côté technique en espérant que ce que je ne contrôle pas continue à plaire au lecteur.
À l’heure où beaucoup de séries sont relancées et trouvent repreneurs, un exercice du genre vous plairait ? Avec quels héros ?
Je trouve l’exercice brillant quand l’auteur est un vrai aficionado de la série qu’il reprend. Il essaie d’y injecter tout l’amour et toutes les émotions qu’il a éprouvées en tant que lecteur. Voire même, si cette série a été fondatrice de son désir de dessiner, là, je suppose qu’il doit être dans une transe qui le porte à vouloir remercier, honorer cette série pour toutes ces émotions reçues. Ça devient un sacerdoce, une mission exaltante. Je l’espère de tout coeur. Si ça devient étouffant, pesant, ça peut faire très mal ! En ce qui me concerne, ce que je dois à la bande dessinée m’amène en permanence à essayer de créer en puisant dans mes émotions de lecteur. Pas de reprise en vue, donc. Je crains que cela ne m’écrase et me bloque dans ma créativité.
Jamais lassé de Fanfoué ? Vous trouvez toujours des gags pour ce vieillard hilarant toujours bien accompagné ?
C’est un exercice que j’apprécie d’autant plus qu’il est immédiat. Le mardi, je dessine le strip qui sera publié le jeudi dans les journaux. L’après-midi même, j’ai des retours des gens alentours qui me font part de leur impression et me parlent de Fanfoué comme d’un personnage réel. Ils se fichent bien de savoir si je fais des albums, ce qui compte, c’est ce personnage qu’ils se sont appropriés et qui fait partie du paysage de ma région. C’est une vraie fierté d’avoir touché ces gens qui ne lisent pas de BD mais sont tout contents d’avoir un personnage local !

©Meynet
On vous voit aussi beaucoup vous charrier avec Enrico Marini. Un complice ? Un pote ? Pourriez-vous collaborer un jour ensemble ?
On en parle parfois. Ça serait super ! Il est très brillant et c’est vrai que j’ai appris beaucoup avec lui. Il a une perception à la fois élégante et hyper efficace de la narration et de la mise en scène. Moi qui ai démarré la bd à la trentaine passée, j’étais fasciné par la maîtrise de ce jeune qui, à 25 ans était capable de faire un western de la trempe de l’Etoile du Désert en bousculant tous les codes du genre. A la fois iconoclaste, surprenant, riche et posant les bases d’un style flamboyant toujours à l’œuvre, vingt ans après. C’est le Scorpion de la BD : virevoltant, drôle, piquant et plein d’une énergie généreuse. La grâce et le talent, quoi !

Les Aigles de rome très féminins ©Meynet
Quels sont vos prochains projets ? On vous a vu à Little Big Horn, de la suite dans les idées et les westerns ?
J’étais allé en repérages dans le Wyoming, le Montana et aussi les réserves indiennes alentours. J’avais envie de relater des faits qui se sont produits dans ces collines : un détachement US avait été anéanti par les Sioux et les Cheyennes, dix ans avant Little Big Horn en plein hiver. J’ai storyboardé les deux albums. Il me faut juste le temps de les dessiner à présent. Le titre : Absaraka. Let’s see !
Propos recueillis par alexis Seny

Sans peur et sans reproche face à une montagne de boulot qui aurait bien nécessité les bras musclés d’un Hulk ou d’une Chose, Mickaël Géreaume et Alain Delaplace n’ont écouté que leur courage et leur passion pour célébrer comme il se doit le centenaire qu’aurait fêté le géant de la bande dessinée américaine : Jack Kirby. Pas seuls, loin de là, dans l’aventure, les deux compères se sont démenés et ont réuni une large communauté : plus de 150 artistes, commentateurs, éditeurs de tous les bords et de tous les coins du globe. Le titre de ce pavé formidable ? Kirby&Me. Il vous reste quelques heures pour le financer et le mettre dans votre bibliothèque quand l’heure sera venue (l’opération finit le 28 février à minuit), courrez-y. Pour vous donner envie, nous avons interviewé les deux initiateurs de ce projet unique et phénoménal.
Avant toute chose, vous êtes à l’origine de Komics Initiative, kézaco ?
Mickaël : En des temps anciens et reculés, une idée folle apparut, celle de se mobiliser autour d’une passion : la bande dessinée et plus particulièrement les comics pour moi et Alain. Je suis, depuis dix ans maintenant, rédacteur en chef « comics » du site PlanèteBD et depuis presque autant animateur d’une émission spécialisée sur Radio Béton à Tours. C’est lors d’une interview de Jul (pas l’apprenti rappeur hein !) pour la radio que j’ai croisé Alain et depuis, flashforward, il m’a rejoint sur PlaneteBD.
Komics Initiative est le nom de l’association qui doit nous servir à donner un cadre juridique pour sortir le livre Kirby&Me puis, par la suite, organiser d’autres projets. Mais je ne dirais rien ! Sauf contre 500 précommandes de Kirby&Me !
Alain : Et on est capables d’y arriver, à ces 500 ! Kirby&Me, c’est l’occasion de réunir toute la crème des comics et de la BD pour rendre hommage à Jack Kirby et à son œuvre. On a ainsi pu rassembler plus de 150 participants avec de célèbres créateurs comme Klaus Janson ou Olivier Vatine, des personnes clés moins connues en particulier dans nos contrées comme Diana Schutz, ancienne éditrice chez Dark Horse ou des spécialistes de la culture « geek » comme Jean-Pierre Dionnet ou encore des fans anonymes mais pas moins talentueux…
Tous ont contribué à l’ouvrage par le biais d’illustrations inédites, de textes écrits pour l’occasion rendant hommage à Jack, à son œuvre. Il y a des souvenirs d’enfance, des analyses plus techniques… On a aussi rassemblé des témoignages et illustrations surprenants comme des tatouages, un extrait d’une pièce de théâtre, etc. Tout cela a un point commun : un amour et une admiration indéniables pour le King of Comics. Point non négligeable : l’ensemble des bénéfices sera reversé à Hero Initiative, une association américaine venant en aide aux créateurs de comics en difficulté, mais on va y revenir plus tard.
Quelle est la genèse de ce projet ?
Mickaël : L’origine de Kirby&Me remonte à une session d’interview que l’on avait réalisée à Paris Manga & Sci-fi Show, un salon dans lequel nous avons croisé plusieurs artistes dont la plupart était fan de Jack Kirby, dont un certain Mauricet d’ailleurs ! Sur le chemin du retour, on a échangé des idées et les bases de Kirby&Me étaient nées.
Alain : Mauricet avait réalisé un joli dessin de Jack avec ses fameux « Kirby Crackles » autour des poings. Dans la voiture, j’ai dit que ce serait cool d’avoir une sorte de grande vente d’illustrations de Kirby en tant que sujet, d’hommages… Et les choses ont vite dégénéré !
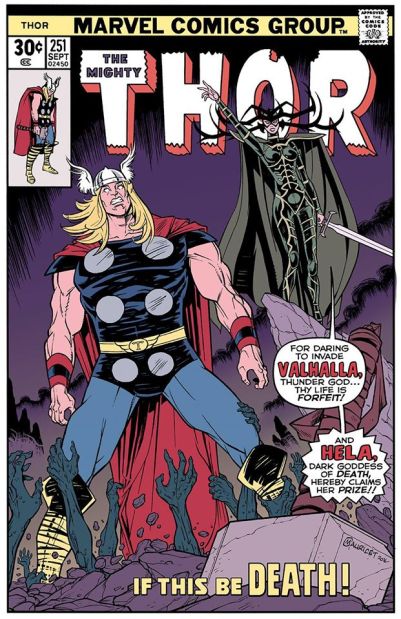
La vision de Mauricet de la couverture de Thor #251
Un gros pavé, non ? Vous n’avez pas fait les choses à moitié…
Mickaël : Dès le départ, on voulait que l’ouvrage marque les fans par ses dimensions et le nombre de pages. On voulait que les souscripteurs en prennent plein les yeux et ressortent de la lecture de Kirby&Me ravis, un peu comme s’ils avaient passés un super moment à évoquer leur Dieu en compagnie d’artistes qui le vénèrent également. Et très vite, nous avons eu de nombreux artistes qui nous ont dit oui, certains n’ont finalement pas eu le temps mais globalement plus de 150 ont déjà envoyés leurs contributions. Le dernier d’entre eux ? Paul Pope ! Comme nous avons un contenu varié et qui n’est pas composé que de dessins, 300 pages c’était le minimum.
À quel moment, Jack Kirby est-il entré dans votre vie ? Le virus du comics qui ne s’est jamais démenti chez vous, c’est grâce à lui ?
Mickaël : D’une certaine façon, Jack Kirby a conditionné nos esprits de lecteurs de comics et de BD tout court. Si, plus jeune, j’appréciais les histoires ou les personnages, je n’ai vraiment domestiqué l’approche visuelle du King qu’au fil des ans. Tout ça pour qu’il ne sorte jamais de ma vie depuis !
Alain : À mesure que l’on a reçu les témoignages, je me suis rendu compte que nombre d’entre nous n’ont pas immédiatement été séduits par le style de Jack. Pour la bonne et simple raison que lorsque nous étions enfants ou adolescents, ses comics n’étaient déjà plus en kiosques et le style du moment avait carrément changé. Pour tout dire, je trouvais ça assez moche, quand j’étais petit.
Puis, au fur et à mesure, comme pour tout, d’ailleurs, on s’est fait une culture et on a commencé à trouver des défauts à ce qu’on lisait et de plus en plus de qualités à ce que faisait Jack. Donc non, Jack Kirby ne m’a pas amené à aimer les comics mais c’est plutôt le fait d’aimer les comics qui m’a graduellement amené à admirer Jack Kirby.
Plus précisément, avez-vous le souvenir d’une planche, d’une case qui vous a fait comprendre que Jack était bien le « King » ?
Alain : Oui, deux à vrai dire. La première, c’était la confrontation entre Thor et Hercule. Comme pour l’autre exemple, c’était grâce aux Strange Spécial Origines des éditions Lug (ça ne nous rajeunit pas !). Les types avaient vraiment l’air d’en baver, on sentait la force qui débordait de chaque case.

kirbyme-interview-combat-thor-et-hercules-par-jack-kirby
L’autre exemple, c’était Iron Man vs Namor. Un combat d’anthologie. Le pauvre Tony en a pris plein la tête, dans celui-là. Namor était alors pour moi une sorte de pauvre type qui passait son temps à essayer d’emballer Sue Storm mais là, avec cette histoire, il avait gagné en galons !
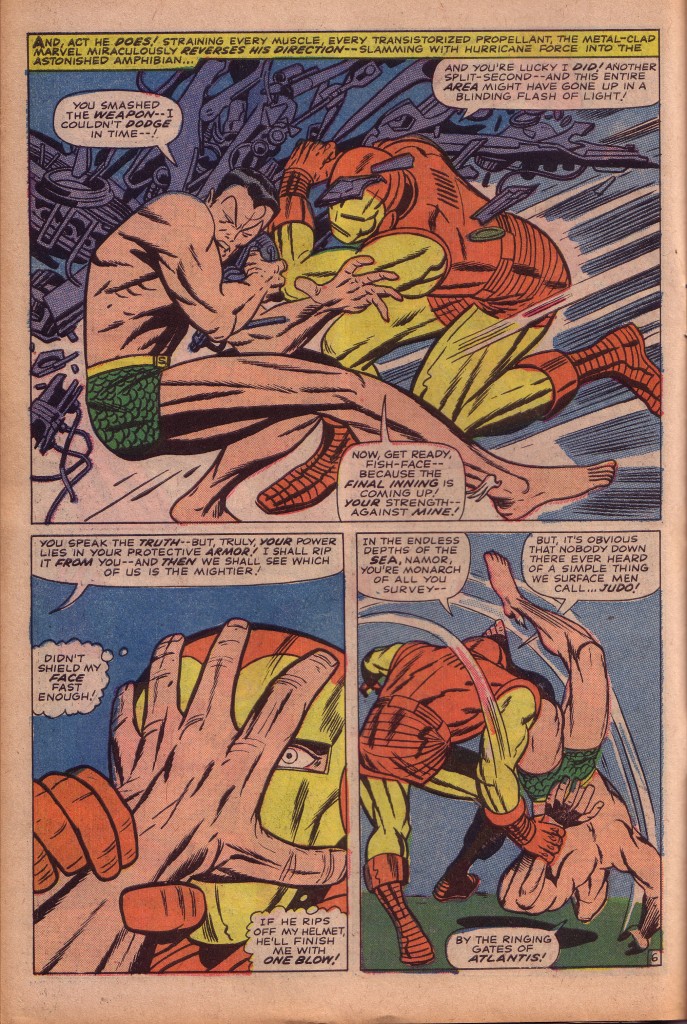
kirbyme-interview-combat-ironman-namor-par-jack-kirby
Mickaël : Impossible de répondre pour moi car cela dépend du moment où l’on me pose la question. En ce moment, je pourrais te citer du Fantastic Four et demain te redire que Captain Victory c’est génial ! Peut-être le moment où Galactus apparaît pour la première fois… ça me fait toujours autant vibrer.

kirbyme-interview-quatre-fantastiques-apparition-galactus-jack-kirby
Ainsi, il a participé à la renommée du comics tel qu’on le connaît actuellement ? Il a imposé des codes ?
Mickaël : Sans lui, plus de 90% des super-héros n’existeraient pas. Donc oui, il a participé à la renommée du comics mainstream mais n’a jamais eu le succès populaire d’un Stan Lee, un parfait communiquant et éditeur visionnaire… mais pas un pur créatif selon moi. La narration de Kirby a influencé des générations entières, ses découpages étaient d’une efficacité redoutable. On retrouve son influence chez des artistes majeurs comme Frank Miller, Mike Mignola etc. De nombreux auteurs français de bande dessinée ont grandi en lisant les revues des éditions Lug dont ont bénéficié eux aussi des bienfaits du génie de Kirby.
Alain : Il a su insuffler les codes de la mythologie classique dans les comics. Les super-héros sont devenus des dieux hyper puissants et tourmentés alors qu’ils n’étaient que des justiciers gadgetisés. On est passé de l’ère de Zorro (que j’adore) à celle du surhomme.
Verra-t-on encore un jour l’émergence d’un monstre comme Kirby ? Ou est-il justement arrivé au bon moment, quand tout (ou quasi) restait à faire ? Comment expliquez-vous qu’il soit passé de main en main, de génération en génération ?
Mickaël : Non, il n’y aura probablement jamais de génie comme lui. Déjà, il était capable de tomber 80 pages par mois et l’a fait durant quasiment toute sa carrière. Qui le peut aujourd’hui ? Je pense que la force de Kirby venait de sa personnalité et de son parcours. Il a grandi dans un quartier difficile, a participé à la seconde guerre mondiale… Il y a forcément une part de chance mais c’était surtout un travailleur acharné et un vrai passionné du dessin en général. Ses nombreux personnages ont toujours des comics en cours de parution et sont même devenus des héros de films. Cela permet à la jeune génération et au grand public de voir un nom « Jack Kirby » et s’interroger sur qui est ce type…
Alain : Pour ça, il faudra que cette personne invente ou réinvente un genre et se l’approprie entièrement. Est-ce que ce sera possible sur le plan des super-héros ? Je ne sais pas. Une bonne part de l’admiration des fans pour Jack vient du fait qu’il était à la fois auteur et illustrateur de ses histoires. Aujourd’hui, l’industrie est tellement compartimentée qu’un tel exploit paraît difficile. La majeure partie des lecteurs sont très très exigeants sur les deux plans et les rythmes de production sont tels que le prochain Kirby devra certainement être une intelligence artificielle. Brrr…
Quel est votre personnage emblématique créé par Jack Kirby ? Pourquoi ?
Mickaël : En ce moment, je dirais Ben Grimm alias la Chose. C’est celui qui symbolise le plus Jack Kirby et sa propre personnalité. Une apparence rude mais une générosité immense.

© Laurent Lefeuvre
Alain : Captain America. Pas de compromis possible avec Cap’. Même des géants comme Brubaker, s’ils ont complexifié le personnage et l’ont inscrit dans la modernité, n’ont pas fondamentalement changé ce qu’il était, ce qui le définissait. C’est quasiment le deuxième drapeau américain.

kirbyme-interview-captain-america-par-jack-kirby
En demandant à des dizaines d’auteurs de s’approprier l’univers de Jack le temps d’un hommage, avez-vous été étonné des choix de certains ? De voir des personnages plus prisés que d’autres ?
Mickaël : Oui, évidemment. Le Silver Surfer et Galactus sont largement plus présents que les X-Men par exemple. Il y a eu de vraies surprises et, la majeure partie du temps, des excellentes !
Alain : J’avoue avoir été surpris par la popularité du Surfer qui ne m’a jamais vraiment branché, comme personnage. Je l’ai toujours vu comme une sorte de chouineur intergalactique avec la poisse collée aux baskets ! Galactus, par contre, rien à dire. Imaginez voir Galactus pointer le bout de son casque à travers les nuages alors que vous regardez par la fenêtre. Wow.
On ne compte plus les noms qui s’ajoutent à ce projet. Comment avez-vous fait pour convaincre tout ce petit monde ? D’autant plus qu’il ne se limite pas à la francophonie, on croise des Sienkiewicz, des Victor Santos et, en dernière minute, Paul Pope… Certains sont venus d’eux-mêmes ?
Mickaël : Nous non plus, on ne sait plus combien il y a d’artistes d’ailleurs ! Il y en a du monde entier, en effet. Pour convaincre, je pense surtout qu’il faut un bon projet et montrer que nous sommes sérieux. Je pense le faire au quotidien sur Planète BD, cela m’a permis de rentrer en contact avec plein d’auteurs. Du coup, j’ai pu rapidement inviter plus d’une centaine d’auteurs à nous rejoindre, pour peu que Kirby leur parlait. D’autres sont venus parce qu’un participant l’avait averti ou grâce à l’aide de personnes bien intentionnées. C’est néanmoins plus d’un an et demi de travail, de relance et de fatigue cumulée, de joie, etc.
Alain : On a procédé graduellement en commençant par les auteurs que l’on connaissait personnellement et ensuite on a remonté la pelote, graduellement. Le fait est qu’on serait presque près à se donner une année supplémentaire pour en décrocher encore plus mais je crois qu’on peut être fiers de ce qu’on a réussi à accomplir. Depuis quelques mois, oui, on a des participants et pas des moindres qui nous ont contactés directement et ça, ça fait sacrément plaisir.
Avec des anecdotes de certains auteurs ayant eu la chance de côtoyé Kirby?
Mickaël : Oui mais là, on va laisser les lecteurs les découvrir dans le livre.
Votre activité de chroniqueurs en toute objectivité n’a pas été un frein auprès d’auteurs peut-être froissés ? (rires)
Mickaël : Franchement, on ne me l’a jamais reproché. En même temps, comme je suis quelqu’un de courageux, j’ai contacté uniquement les artistes que j’aime (rires). À ce jour, je n’ai jamais froissé personne, en tout cas pas volontairement et ce n’est pas le but lorsque l’on écrit une critique. C’est juste un avis indiquant si l’on conseille ou non la lecture, si l’on a trouvé du plaisir à lire l’ouvrage etc.
Alain : J’ai tout fait avec un pseudo. Non, c’est pas vrai ! On n’a jamais eu en tous cas de quelconque remarque vis-à-vis d’une de nos critiques.
Puis, j’imagine que, comme lorsqu’on doit faire un discours de remerciements, on passe toujours à côté de certaines personnes… qu’on regrette, par après, de ne pas avoir contacté ?
Mickaël : Evidemment ! Mais globalement, il faut dire que je n’ai pas fait de mails groupés pour proposer le projet. Je l’ai fait un par un et à chaque fois avec un message personnalisé. Parfois j’ai eu des refus, d’autres ont voulus réfléchir et souvent j’ai eu un « oui ». Et puis, il faut dire la vérité, je n’ai pas les contacts de tout le monde. Tout comme, il y a des baleines blanches, des artistes que l’on a essayé d’avoir mais c’était peine perdue d’avance.
Alain : On a toujours essayé, en tous cas. On a frappé à quasiment toutes les portes mais on n’en n’a jamais voulu à ceux qui nous répondaient non parce que pas intéressés ou par manque de temps. Il faut savoir respecter l’agenda professionnel des gens. D’autant plus que, parmi ceux ayant refusé, la quasi-totalité se démène aussi, le reste du temps, pour Hero Initiative. Mais, clairement, on va faire super attention à n’oublier personne car certains se sont démenés pour Kirby&Me alors qu’on n’avait rien demandé de plus.
Au-delà des contributions de ces auteurs, il y aura aussi du texte, la traduction de la toute dernière interview de Jack et des dessins du maîtres… dont certains rares. Comment deux Frenchies comme vous se les sont-ils procurés ?
Mickaël : Oui il va y avoir des textes. La dernière interview de Jack Kirby n’y figurera pas car elle est déjà disponible ici. Il va y avoir des témoignages des dessinateurs eux-mêmes, des moments de passion racontés, des interviews, une pièce de théâtre reproduite partiellement et oui, il y aura aussi du Kirby dedans. La majeure partie émane de nous et de nos échanges avec auteurs mais pour se procurer certains éléments comme les illustrations de Lord of Light, notre gentillesse et notre sincérité ont suffit. Nous ne sommes pas là pour paraître, on s’en fiche, on veut juste faire un livre que les fans et nous seront fiers d’avoir.
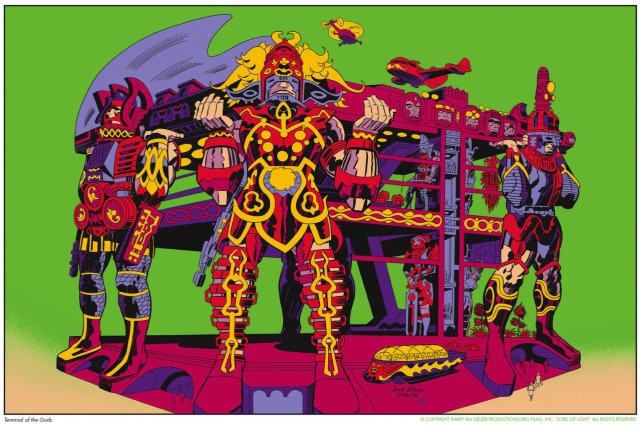
lord-of-light-jack-kirby
Alain : Il n’y a pas que des dessins, en effet. On a en premier lieu les témoignages des artistes qui prennent quelques lignes pour expliquer en quoi Kirby les a marqués et aussi pourquoi et/ou comment ils ont réalisé leur contribution. Mais ce n’est pas tout, des auteurs livrent des témoignages plus longs, on a des analyses de points techniques ou sur des personnages particuliers, des photos, des tableaux… C’est un peu dingue mais hormis ajouter des pop-ups pour les enfants, je ne sais pas ce qu’on aurait pu mettre de plus.
C’est vrai que c’est incroyable mais il y a eu un effet boule de neige. Au fur et à mesure que des gens nous ont fait confiance, plus le reste c’est fait facilement. La bonne approche a été de procéder graduellement et de ne pas tenter immédiatement d’approcher les plus grands auteurs, au risque de passer pour des profiteurs. On s’est construit un socle de relations et on a aussi appris à présenter les choses, ce qui était le plus apprécié.
Vous avez eu des contacts avec la famille de Kirby ?
Mickaël : Oui avec Neal, le fils de Jack. On lui a évoqué notre projet, ce que l’on voulait faire et s’il avait dit que cela ne lui plaisait pas, on aurait arrêté aussitôt.
Alain : À quoi bon rendre un hommage si c’est pour faire grincer des dents ? C’eut été malhonnête, non seulement vis-à-vis de la famille mais aussi des participants au projet. Il fallait que chacun sache exactement dans quel cadre et à quelles fins on allait employer leur travail. Et pour graver ça dans le marbre, oui, on a établi une sorte de contrat moral avec Neal Kirby. Et on n’a pas bougé d’un iota depuis.
Aussi, vous donnez à ce projet, une dimension caritative ?
Mickaël : Dès le départ, nous aurions été malhabile de réclamer gagner de l’argent sur le dos des auteurs et in fine de Jack Kirby lui-même. Nous ne sommes pas une structure mercantile mais à but non lucratif. Notre objectif est de reverser l’ensemble des bénéfices à Hero initiative.

kirbyme-interview-hero-initiative-logo
Alain : Il faut savoir que, en particulier aux USA, la patrie des comics, la vie d’un créateur n’est pas simple. Payés à la planche, pas ou peu de couverture sociale, etc. Ils sont fréquemment à la merci du moindre accident de la vie : maladie, catastrophe naturelle dévastant leur maison et/ou leur studio… Hero Initiative intervient alors pour aider à payer les soins médicaux ou les réparations. Que faire quand on est dessinateur et qu’on se met à avoir de l’arthrite dans les mains ? En France, le coût moyen d’une opération pour une appendicite est entièrement pris en charge par la sécurité sociale et, éventuellement, des mutuelles coûtant 50 euros par mois. Aux Etats-Unis, c’est 10 à 60 000$, pas de sécurité sociale et une assurance santé privée (les artistes sont freelance) coûte 250$ par mois.
Ce livre a-t-il un équivalent outre-Atlantique ? Est-il du coup plus ou moins évident de séduire le public étranger ?
Mickaël : Je pense que Kirby&Me n’a pas d’équivalent dans le monde. Dit comme cela, on pourrait croire que l’on a la grosse tête mais, en fait, l’ouvrage est un hybride entre tout ce qui existe. On a mis tellement de choses dedans et trouver le moyen d’y trouver une cohésion que l’on espère l’avoir rendu suffisamment séduisant. Le public étranger est intéressé oui et pas forcément qu’aux USA d’ailleurs.
Alain : Des ouvrages collectifs du même genre, ça existe, mais avec un contenu aussi divers, des profils aussi distingués et une vocation caritative, je n’en n’ai pas vu. Il fallait surtout trouver deux malades capables de mettre autant de temps et d’énergie là-dedans, bénévolement. C’est chose faite.

Quel est votre regard sur le monde actuel du comics ? Ne se développe-t-il pas de plus en plus en France avec une volonté d’être sous influence mais aussi, désormais, de faire influence (je pense aux créations originales de Glénat) ?
Mickaël : Je vais commencer par la fin… Des créations originales ont déjà été tentées par d’autres éditeurs par le passé. Delcourt ou Panini s’y sont essayés avec plus ou moins de succès, on espère juste que la qualité soit là avec les titres Glénat Comics, c’est l’essentiel pour un lecteur (et un chroniqueur comme moi) !
Concernant l’univers des comics, il y a malheureusement un effet de loupe et certains personnages ou titres vampirisent l’ensemble de l’attention de la masse des lecteurs et ce, au détriment d’une véritable qualité. Bien sûr, plus il y a de lecteurs, mieux c’est, mais cela signifie aussi une offre plus large de comics en magasin et plus de choix à faire, donc des séries qui, si elles ne se vendent pas assez, ne seront pas publiées jusqu’au bout. C’est le cas chez tous les éditeurs, aucun n’échappe à cette règle. Faites preuve d’ouverture d’esprit et creusez, il y a du bon chez tout le monde !
Alain : Je trouve que le climat est un peu pesant. Tout le monde y va de son avis et souhaite décortiquer ce qu’il lit. C’est bien d’être exigeant mais il faut parfois lâcher prise et, par exemple, apprécier un Batman parce qu’on aime bien Batman et que l’histoire est efficace sans chercher à tout prix à trouver un double-sens métaphysique dedans.
Il y a peut-être une sorte de mouvement hipster qui s’est formé au détriment d’une approche bon enfant qui, elle-même, a été la source de comics plus complexes. Aujourd’hui, j’ai parfois l’impression d’avoir à choisir entre Deadpool qui fait des blagues scatos, Superman qui arrache des bras et de l’indé qui croule sous le poids de ses propres références. Il faut oser les choses aussi bien en tant que créateur que comme lecteur.
Un grand merci à tous les deux et vive Jack Kirby ! Rappelons que Kirby&Me sera un ouvrage exclusivement disponible pour ceux qui le financeront sur Ulule. Plus d’informations sur la page Facebook du projet et sur son site officiel. Preview disponible ici.
Rajoutons aussi que quelques libraires tout aussi passionnés se sont joints au projet. En Belgique, à Andenne même, Atomik Strip promet d’ores et déjà que « Kirby&Me » sera l’un des événements de la prochaine Fête de la BD, les 11 et 12 novembre prochains.
Propos recueillis par Alexis Seny
 |
©BD-Best v3.5 / 2026 |